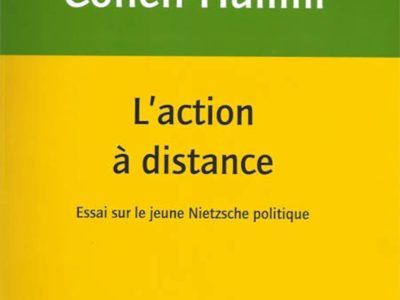Croyance et immanence dans la philosophie de Gilles Deleuze (1/2)
Croyance et immanence dans la philosophie de Gilles Deleuze (1/2)
Stéphane Lleres, Docteur en philosophie, agrégé de philosophie, chargé de cours à l’Université de Picardie Jules Verne.
Ceci est la première partie d’un article, dont la deuxième partie, publiée le 14/12/18, peut être trouvée en cliquant ici.
Résumé
La philosophie de Deleuze trace une ligne de partage stricte entre la religion, qui renvoie à une transcendance, et la philosophie, qui s’installe dans l’immanence, semblant exclure par-là même la foi du champ philosophique. Pourtant, lorsqu’en 1985, Gilles Deleuze explique en quoi consiste le problème moderne, il réclame une croyance ou une foi. Cet article cherche à comprendre comment une philosophie de l’immanence, comme celle de Deleuze, peut réclamer une croyance ou une foi, et donc, comment il est possible de penser la foi en régime d’immanence.
Summary
Deleuze’s philosophy draws a strict partition between religion, which refers to a transcendence, and philosophy, which develops in immanence, appearing to exclude faith from the philosophical field. However, when, in 1985, Gilles Deleuze explains the modern problem, he claims a belief or a faith. This paper tries to understand how a philosophy of immanence, such as Deleuze’s one, can claim a belief or a faith, and therefore, how it is possible to think faith in immanence plan.”
Mots-clés : Deleuze, croyance, foi, immanence, transcendance, image de la pensée, éthique, monde, corps.
Keywords : Deleuze, belief, faith, immanence, transcendence, picture of thought, ethics, world, body.
 Dans la perspective de Deleuze, la philosophie doit être définie comme une entreprise de démystification[1] ; et il est vrai que c’est en rupture avec le mythe que le discours philosophique apparaît en Grèce, aux VIIème et VIème siècles avant J.-C. – puisque Deleuze le fait remonter jusqu’à Empédocle. Le mythe est de nature religieuse : il explique le monde et la condition humaine en les faisant dériver de l’action de dieux ou de personnages surnaturels, c’est-à-dire transcendants au monde. Deleuze peut ainsi tracer une ligne de partage stricte entre, d’une part, la religion, qui reconduit la transcendance, et la philosophie, qui s’installe dans l’immanence[2], et d’autre part entre les sages ou les prêtres, personnages religieux concevant le monde comme instauré par une transcendance, et les philosophes qui ne pensent que sur un plan d’immanence, dont la nature de Lucrèce fournit un bon exemple[3]. Et si l’on trouve des philosophes qui semblent faire une place à la transcendance, c’est parce que, comme le suggérait Nietzsche, en milieu hostile (par exemple en milieu chrétien) la philosophie se trouve bien forcée de prendre un masque[4].
Dans la perspective de Deleuze, la philosophie doit être définie comme une entreprise de démystification[1] ; et il est vrai que c’est en rupture avec le mythe que le discours philosophique apparaît en Grèce, aux VIIème et VIème siècles avant J.-C. – puisque Deleuze le fait remonter jusqu’à Empédocle. Le mythe est de nature religieuse : il explique le monde et la condition humaine en les faisant dériver de l’action de dieux ou de personnages surnaturels, c’est-à-dire transcendants au monde. Deleuze peut ainsi tracer une ligne de partage stricte entre, d’une part, la religion, qui reconduit la transcendance, et la philosophie, qui s’installe dans l’immanence[2], et d’autre part entre les sages ou les prêtres, personnages religieux concevant le monde comme instauré par une transcendance, et les philosophes qui ne pensent que sur un plan d’immanence, dont la nature de Lucrèce fournit un bon exemple[3]. Et si l’on trouve des philosophes qui semblent faire une place à la transcendance, c’est parce que, comme le suggérait Nietzsche, en milieu hostile (par exemple en milieu chrétien) la philosophie se trouve bien forcée de prendre un masque[4].
Le partage deleuzien entre la philosophie et la religion semble se prolonger en un partage entre la croyance, vouée à la transcendance, religieuse ou mythologique, et la pensée proprement philosophique, se jouant dans l’immanence la plus stricte. Pourtant, lorsqu’en 1985, Deleuze définit la tâche de pensée qui est la nôtre, c’est la nécessité d’une croyance ou d’une foi qu’il revendique :
Le fait moderne, c’est que nous ne croyons plus en ce monde. Nous ne croyons même pas aux événements qui nous arrivent, l’amour, la mort, comme s’ils ne nous concernaient qu’à moitié.[5]
C’est que le lien de l’homme et du monde, lien sensori-moteur qui enchaîne perceptions et actions, se trouve rompu : les perceptions ne se prolongent plus en actions, et tout se passe comme si autour de nous, le monde jouait un « mauvais film ». Or, pour Deleuze, ce lien ne peut être qu’un objet de foi[6].
Cette revendication est surprenante. Cependant, elle ne doit pas être prise comme un changement ou un infléchissement de la position de Deleuze. En effet, le partage entre immanence philosophique et transcendance religieuse est constant, puisque s’il se trouve explicité de manière ponctuelle[7], il anime l’affirmation de l’immanence absolue qui marque la pensée de Deleuze. En fait, la revendication d’une foi ou d’une croyance ne contredit en rien ce partage à partir du moment où la croyance dont il s’agit est une croyance au monde tel qu’il est, c’est-à-dire une croyance immanente :
La croyance ne s’adresse plus à un monde autre ou transformé […]. La réaction dont l’homme est dépossédé ne peut être remplacée que par la croyance. Seule la croyance au monde peut relier l’homme à ce qu’il voit ou entend.[8]
La revendication par Deleuze d’une foi ou d’une croyance ne contredit pas le partage philosophie-religion ; elle fait plutôt passer la croyance ou la foi du côté de la philosophie[9], c’est-à-dire du côté de l’immanence. Ce que propose ainsi Deleuze, c’est une conversion de la foi à l’immanence. C’est la raison pour laquelle la croyance concerne tout aussi bien les athées que les croyants[10].
On aperçoit sans mal ce que l’idée d’une foi ou d’une croyance immanente peut avoir de problématique. Car si, traditionnellement, la foi ou la croyance renvoie à une transcendance (y compris, par exemple, chez Kant), c’est qu’elle ne relève pas du savoir qui, lui, se déploie dans l’immanence du champ de l’expérience possible. Je n’ai donc pas besoin de croire à ce que je sais, ou même à ce que je peux savoir, et la foi peut alors se définir comme le fait d’affirmer ce dont on est parfaitement conscient qu’on ne le sait pas, et qu’on ne peut pas le savoir. Dès lors, pourquoi faudrait-il que l’on croie en ce monde-ci, puisque ce monde-ci est justement pleinement donné à la connaissance ?[11]
C’est donc cette croyance immanente, ou plutôt l’essai par Deleuze d’une conversion de la foi à l’immanence, dont il s’agira ici de rendre raison. Pour cela, nous commencerons par demander ce que signifie une conversion de la croyance à l’immanence. Or, pour Deleuze, cette conversion se trouve liée au remplacement du « modèle du savoir » par celui de la croyance, opération ayant d’ores-et-déjà eu lieu dans l’histoire de la philosophie moderne, puisque Deleuze estime qu’elle s’est opérée « de Pascal à Nietzsche »[12]. Nous devrons donc, dans un premier temps examiner ce que signifie ce remplacement du modèle du savoir par celui de la croyance, et en quoi il constitue une conversion de la foi à l’immanence. Mais dès lors, il nous faudra aussitôt demander en quoi cette conversion de la croyance à l’immanence implique une perte de monde, une rupture de notre lien avec le monde, et en quoi elle permet de le retrouver ou de le reconstruire, et sous quelle forme. Enfin, Deleuze revendique en même temps une éthique et une foi, au point qu’il apparaît clair que la croyance immanente qu’il revendique relève de l’éthique. C’est le dernier point qu’il nous faudra éclaircir, c’est-à-dire le fait, comme le note Deleuze, que :
Nous avons besoin d’une éthique ou d’une foi, ce qui fait rire les idiots ; ce n’est pas un besoin de croire à autre chose, mais un besoin de croire à ce monde-ci, dont les idiots font partie.[13]
Croyance et pensée
Si l’on demande en quoi peut consister cette conversion de la foi à l’immanence, il faut répondre qu’il s’agit de la substitution du modèle de la croyance à celui du savoir[14] : c’est seulement lorsque le modèle de la croyance remplace celui du savoir que la croyance tend à se faire croyance en ce monde-ci, c’est-à-dire croyance immanente. C’est que le modèle du savoir, ou le modèle de la croyance, désignent ici ce que Deleuze appelle des images de la pensée, c’est-à-dire l’image que la pensée se donne « […] de ce que signifie penser, faire usage de la pensée s’orienter dans la pensée… »[15] Il s’agit d’une image plutôt que d’un concept, parce qu’elle est toujours présupposée par la pensée conceptuelle : au moment où elle élabore et articule des concepts, la pensée (philosophique) le fait selon une image de la pensée qu’elle présuppose. C’est la raison pour laquelle, dans le troisième chapitre de Différence et répétition, l’image de la pensée est définie comme un ensemble de présupposés subjectifs et implicites, c’est-à-dire « […] enveloppées dans un sentiment »[16] par opposition aux présupposés objectifs, qui sont « […] des concepts explicitement supposés par un concept donné » N’étant pas conceptuelle, mais toujours présupposée par les concepts, l’image de la pensée n’est pas non plus une méthode, qui est toujours conceptuelle[17]. Pour autant, l’image de la pensée ne doit pas être renvoyée du côté de l’opinion. Car si l’opinion est toujours un fait, historiquement situé, l’image de la pensée, elle, concerne ce qu’il en est de penser en droit, et trace donc une démarcation stricte entre les simples faits de penser, et ce qu’il en est de penser en droit[18].
Le modèle du savoir, c’est donc une image de la pensée, ni conceptuelle, ni simple opinion, selon laquelle penser, c’est chercher à connaître, et qui se trouve présupposé dans tout un pan (majeur) de la tradition philosophique de Platon à Hegel, en passant par Aristote ou Descartes ce en quoi on voit ce qui distingue l’image de la simple opinion : si l’opinion est toujours celle d’une époque historique déterminée, l’image de la pensée, elle, les traverse. Substituer le modèle de la croyance à celui du savoir, c’est donc substituer une image de la pensée selon laquelle penser, c’est croire, à une autre, selon laquelle penser c’est savoir. Cette image de la pensée comme activité qui cherche à connaître (qu’on appellera image traditionnelle par commodité, tant elle est la plus représentée dans la tradition philosophique), Deleuze en a produit une description détaillée dans le troisième chapitre de Différence et répétition, dont on peut retenir les traits principaux :
D’abord, connaître, c’est être en mesure de penser ou dire le vrai. En ce sens, si penser est l’activité qui vise à connaître ou à savoir, c’est donc l’activité qui vise le vrai. Il y a donc une destination naturelle de la pensée, une nature droite qui la voue au vrai, pour autant que le penseur la laisse s’exercer selon sa tendance naturelle – ce qui peut nécessiter une éducation, ou l’application d’une bonne méthode. L’image de la pensée comme connaissance, c’est donc l’image d’une pensée comme Cogitatio natura, qui se comprend selon le double aspect d’une nature droite de la pensée et d’une bonne volonté du penseur[19]. Or, le vrai, c’est, traditionnellement, ce sur quoi tout le monde doit pouvoir s’accorder, en droit. Aussi, si la pensée est naturellement vouée au vrai, elle se comprend comme l’exercice d’un sens commun naturel. Celui-ci peut être envisagé objectivement aussi bien que subjectivement : objectivement, le sens commun peut être envisagé comme le fait d’imposer à une diversité la forme d’identité de l’objet, ce qui ne serait pas possible si, subjectivement, les facultés ne collaboraient pas dans cette opération, concourant toutes à l’unité d’un même sujet, un « Je pense ». L’exercice de la pensée comme sens commun naturel, c’est donc la représentation, compris comme processus par lequel un divers est identifié, c’est-à-dire rassemblé en une unité, sous la Forme du Même. Penser, c’est alors reconnaître. C’est la récognition qui fournit le modèle de ce que c’est, en droit, de penser. La récognition se définit en effet par « […] l’exercice concordant de toutes mes facultés sur un objet supposé le même […] »[20], puisque reconnaître quelque chose, c’est identifier ce que je vois avec ce dont je me souviens, ce que j’entends, ce que j’imagine, etc. Descartes reconnaît le même morceau de cire après le passage à la flamme :
[…] c’est le même que je vois, que je touche, que j’imagine, et enfin c’est le même que j’ai toujours cru que c’était au commencement.[21]
Selon l’image traditionnelle, penser, c’est connaître, et connaître, c’est toujours reconnaître. Elle ne risque donc rien d’autre que l’erreur, comprise comme fausse récognition. L’erreur, par conséquent, ne conteste pas l’image de la pensée, elle lui appartient pleinement comme sa confirmation en négatif ou en creux.
La pensée comme exercice naturel d’un sens commun voué au vrai, procédant par représentation et prenant pour modèle la récognition : c’est toute cette image traditionnelle qui bascule lorsque lui est substituée une autre image, selon laquelle penser, c’est croire. Cette substitution, Deleuze la voit à l’œuvre « de Pascal à Nietzsche », mais c’est Kant qui est produit comme exemple paradigmatique[22]. Chez Kant en effet, le champ du connaissable se trouve limité à la nature sensible ; la nature suprasensible, elle ne peut être connue. Elle peut néanmoins être pensée. Dès lors, la connaissance n’est plus qu’un cas de la pensée[23]. C’est donc, comme le remarque Deleuze, que « [L]a connaissance n’est qu’une manière de penser, donc elle est subordonnée à des fins plus hautes que la pensée. La connaissance n’est plus la fin suprême de la pensée[24]. » Penser, ce n’est donc plus connaître. Cela ne signifie pas que la connaissance ne pense pas, mais plutôt que la pensée ne s’accomplit plus dans la connaissance, mais dans quelque chose de plus haut. Or, si l’on veut apercevoir en quoi consiste ce nouvel exercice de la pensée, c’est encore dans le kantisme qu’on trouvera une piste. Car ce que la pensée pense sans pouvoir la connaître, c’est l’Idée. Or, l’Idée est en elle-même problématique : elle l’est non seulement en ce qu’elle donne lieu à de faux problèmes (les antinomies)[25], mais aussi dans son usage régulateur[26]. Celui-ci consiste en effet dans le fait de rassembler, autour de l’Idée, les démarches de l’entendement qui sans elles resteraient diverses et sans lien. Mais elle ne les rassemble pas comme un concept, c’est-à-dire de manière collective. Elle n’est en effet déterminable qu’après-coup, par analogie avec les rapports que ces démarches entretiennent[27]. Soit l’Idée de monde comme totalité : elle rassemble les démarches de la physique quantique et de la physique classique. Elle est donc problématique en elle-même, le problème ne désignant pas un aspect contingent ou purement subjectif, propre à une connaissance inachevée, mais prend ici une valeur objective. Selon cette nouvelle image, penser ce n’est plus connaître, mais d’abord avoir affaire à des problèmes ; la pensée se joue maintenant dans le problématique.
Le problème se définit par la coexistence de dimensions hétérogènes, ou incompossibles, c’est-à-dire de dimensions qui ne sont pas différentes relativement mais absolument : chaque terme du problème n’est rien d’autre que sa différence avec les autres (le problème définit donc un système dans lequel les relations sont premières et extérieures à leurs termes ; ceux-ci sont définis par celles-là). Or, chaque terme n’étant rien d’autre que sa différence avec les autres, il rejoue, répète toutes les autres en même temps qu’il se trouve répété, rejoué dans tous les autres. Chaque terme constitue donc une perspective et le champ problématique est donc un champ constitué de perspectives hétérogènes, divergentes ou incompossibles pourtant compliquées les unes dans les autres : c’est une multiplicité, que Deleuze définit comme suit :
[…] la multiplicité ne doit pas désigner une combinaison de multiple et d’un, mais au contraire une organisation propre au multiple en tant que tel, qui n’a nullement besoin de l’unité pour former système.[28]
On voit donc en quoi cette image diffère radicalement de l’image traditionnelle : la pensée n’est rien qui s’exerce naturellement. Au contraire, la pensée ne naît que sous l’effet d’une violence qui force à penser. À propos d’Artaud, Deleuze rappelle que son problème n’est pas tant d’ordonner sa penser que d’arriver seulement à penser quelque chose[29]. Penser n’est donc pas l’exercice d’une faculté naturelle : on est forcé à penser du dehors[30]. Cette formulation – toute pensée est pensée du dehors – est reprise par Deleuze à Maurice Blanchot, à travers Foucault[31]. Le dehors ne se réduit pas seulement à l’extériorité. Il est au contraire « plus lointain que toute forme d’extériorité »[32]. Ce qui se donne comme extérieur, c’est le donné empirique (c’est une chaise, c’est une main, c’est mon ami Pierre), qui est simplement objet d’une récognition, en vue de laquelle les facultés collaborent un sens commun. Le donné empirique extérieur est incapable de faire naître une pensée, puisqu’il est déjà élaboré par elle – selon son image traditionnelle. Aussi, comme le note Deleuze, commentant un passage de La République[33], les objets empiriques extérieurs « laissent la pensée tranquille », puisque celle-ci « n’y est remplie que d’une image d’elle-même, où elle se reconnaît d’autant mieux qu’elle reconnaît les choses. »[34] Face au monde extérieur, la pensée n’a encore affaire qu’à elle-même. Si la pensée doit être engendrée, ce ne peut pas être simplement de l’extérieur mais du dehors. Le dehors est donc ce que la pensée ne peut pas penser, ce qui est en droit impensable. Mais puisqu’il doit engendre la pensée, il est du même coup au cœur même de toute pensée. C’est pourquoi Deleuze donne à la définition du dehors – « plus lointain que tout monde extérieur » – sa réciproque : « plus proche que tout monde intérieur »[35], car il est, au cœur même de toute pensée, l’impensé – et même l’impensable – qui la fait penser.
Ainsi comprise, la pensée ne naît que par la rencontre d’une dimension hétérogène ou incompossible. Deleuze prend l’exemple de la rencontre amoureuse, telle que Proust la décrit :
L’être aimé apparaît comme un signe, une « âme » : il exprime un monde possible inconnu de nous. L’aimé implique, enveloppe, emprisonne un monde, qu’il faut déchiffrer, c’est-à-dire interpréter. Il s’agit même d’une pluralité de mondes ; le pluralisme de l’amour ne concerne pas seulement la multiplicité des êtres aimés, mais la multiplicité des âmes ou des mondes en chacun d’eux. Aimer, c’est chercher à expliquer, à développer ces mondes inconnus qui restent enveloppés dans l’être aimé. C’est pourquoi il nous est si facile de tomber amoureux de femmes qui ne sont pas de notre « monde », ni de notre type (…)[36]
Mais comment peut-il y avoir rencontre, justement, entre deux dimensions définies par leur hétérogénéité absolue ? C’est ce que permet de comprendre le concept de signe, tel qu’il apparaît d’abord dans Proust et les Signes, avant de recevoir son plein développement dans Différence et Répétition. Le signe est ce qui fulgure à la faveur des hétérogènes, ou rencontre[37]. Il est la manière dont le différent apparaît dans le différent, dont l’hétérogène surgit dans l’hétérogène. Sa différence empêche qu’il se donne en lui-même ou en personne, sous peine de disparaître comme différence. Le monde de l’aimé ne m’est pas donné en personne, ou, si l’on veut, de manière claire et distincte, car alors il serait le mien. Au contraire, il m’est donné de manière obscure, enveloppée, comme ce monde qui n’est pas le mien et auquel je n’ai pas accès : il ne peut que faire signe. Aussi ce qui fait signe n’est-il pas sensible au sens où il ne se donne pas en personne à la sensibilité ; mais il éveille la sensibilité : il est l’insensible qui donne à sentir ou qui force à sentir. Il force la sensibilité à s’exercer à sa propre limite, pour sentir ce qu’elle ne peut pas sentir. Par le signe, une sensibilité nouvelle est engendrée, accouchée dans la sensibilité, qui sent ce que la sensibilité ne pouvait pas sentir. Mais cette violence qui fait naître une sensibilité à même la sensibilité se communique aux autres facultés, qui se trouvent alors dans la même situation : cas de l’imagination, de la mémoire et de la pensée, qui se trouve contrainte d’engendrer une nouvelle pensée en elle-même.[38] Ainsi, Cinéma 1 & 2 doivent être compris, non pas comme un essai d’histoire du cinéma, mais comme « une taxinomie, un essai de classification des images et des signes »[39] – en référence au projet de C.-S. Peirce. C’est que l’image cinématographique, par son caractère automatique, permet de « produire un choc sur la pensée, communiquer au cortex des vibrations, toucher directement le système nerveux et cérébral »[40] – c’est-à-dire, fait entrer la pensée dans son exercice transcendant, ou permet d’engendrer la pensée.
On comprend alors que penser, c’est entrer dans un devenir de pensée. Ou, comme le dit Foucault : penser, c’est penser autrement[41]. On comprend dès lors que penser n’est plus reconnaître. La pensée est éveillée par la violence du signe, qui se donne à penser sans pouvoir être pensable, c’est-à-dire sans pouvoir être reconnu. Car le signe est l’irruption de l’hétérogène qui ne peut donc être identifié. La pensée qui naît dans la pensée ne reconnaît rien. Elle est encore moins un sens commun, qui procèderait par représentation, une concorde des facultés sur un objet supposé le même, car la pensée n’a affaire à rien qui soit le même, mais seulement à l’irruption du différent. Les facultés n’entrent plus, face à lui, dans une concorde, mais bien plutôt dans une discorde, chacune communiquant aux autres la violence qu’elle reçoit – ce que Deleuze appelle l’exercice transcendant des facultés.
En quoi cette pensée se déployant alors dans un champ problématique, a-t-elle à voir avec la croyance ? Si penser n’est plus essentiellement connaître, cela signifie-t-il que la pensée n’aurait plus rien à voir avec le vrai ? Traditionnellement le vrai et le faux concernent les propositions, dans leur rapport aux états de choses qu’elles désignent. Comme telles, les propositions sont les solutions de problèmes : la proposition « Dieu existe » est une solution d’un problème constitué par la coexistence de la possibilité de son existence et de celle de sa non-existence. Que la pensée se joue dans le problème ne signifie pas que les solutions n’importent plus : elles sont engendrées à partir du problème. Le champ problématique a une puissance génétique que Deleuze trouve exprimée dans le calcul différentiel : dy et dx ne sont rien en eux-mêmes, mais se déterminent réciproquement: c’est le rapport dy/dx qui est déterminant : les valeurs de dy/dx sont des cas de solution. Le rapport différentiel, c’est-à-dire le problème, engendre ses cas de solutions. C’est donc en travaillant le problème que les solutions se trouvent produites. Celui-ci apparaît donc comme ce qui donne sens à une proposition : si celle-ci se comprend comme solution, on comprend qu’une solution qui ne serait solution d’aucun problème n’aurait, à proprement parler aucun sens. Mais si le problème est le sens de la proposition qu’il engendre, on comprend que la charge problématique ne disparaît pas dans les solutions qu’elle produit : dans le cas contraire, si seule restait la proposition, elle n’aurait plus de sens. Il faut donc que le sens, ou le problème, ne disparaisse pas dans les solutions qu’il engendre, mais insiste en elles. Dès lors, si la pensée se joue dans l’élément problématique, on comprend que celle-ci remonte de la proposition à son sens, c’est-à-dire au problème qui insiste dans la proposition. Deleuze peut alors considérer, avec Nietzsche, qu’une « […] nouvelle image de la pensée signifie d’abord ceci : le vrai n’est pas l’élément de la pensée. L’élément de la pensée est le sens et la valeur. »[42]
Cependant, plutôt que d’une évacuation pure et simple de la vérité il s’agit plutôt d’une nouvelle construction, c’est-à-dire d’une nouvelle vérité, comme il arrive à Deleuze de la réclamer[43]. Cette nouvelle vérité concerne moins les propositions dans leur rapport à un état de choses (désignation) que le problème qui en constitue le sens : non pas supprimer le vrai et le faux, mais porter le vrai et le faux dans les problèmes eux-mêmes.
Que signifie qu’il y ait de faux problèmes ? Dans l’élément problématique, la pensée est exhortée, forcée à s’engendrer au-delà de ce qu’elle peut déjà, par la violence de l’irruption du différent. On comprend ce que cette violence peut avoir de créatrice, mais elle peut aussi être vécue de l’intérieur comme agression ou outrage, c’est-à-dire comme négation de ce que je suis. Pour autant, cette négation vécue n’est rien d’essentiel, elle est seconde : c’est la conséquence seulement de l’irruption de l’hétérogène, c’est-à-dire d’une rencontre qui n’est, en soi, rien de négatif. Par conséquent, n’envisager le problématique qu’à partir du négatif, ou comme élément négatif, revient à confondre principe et conséquence, l’essentiel et l’accidentel. Une telle confusion définit, selon Deleuze, l’esprit faux[44]. S’il arrive à Deleuze de définir la bêtise comme la faculté des faux problèmes[45], c’est que le faux problème est le problème mal posé, c’est-à-dire celui qui est posé à partir d’une confusion entre le principal et le secondaire : le problème envisagé du point de vue du négatif (un scandale nécessaire qui n’attend que d’être supprimé dans ses solutions). Le faux problème est le problème nié ou refusé comme tel. Dans ce cas, le problème « vrai » ou bien posé, est celui qui se trouve affirmé : l’irruption du différent dans la rencontre, et la genèse d’une nouvelle pensée dans la pensée comme objets d’affirmation.
C’est par là que la pensée, selon cette nouvelle image, est croyance. C’est le cas chez Kant lui-même : l’Idée est ce qu’on ne peut que penser et non connaître, elle est donc indéterminée du point de vue spéculatif, mais déterminable du point de vue pratique, la loi morale requérant, pour se soutenir, que soient affirmées l’existence de Dieu, du libre-arbitre et l’immortalité de l’âme. Mais cette affirmation est un postulat, qui n’ajoute rien à nos connaissances[46]. Ce que je crois, c’est ce que je postule, c’est-à-dire ce que j’affirme, sur un autre mode que celui de la connaissance. Ainsi la pensée, selon cette nouvelle image, se comprend comme croyance puisqu’elle se joue dans le problématique en tant que celui-ci est objet d’affirmation.[47]
Que penser signifie croire et non plus connaître ne signifie donc pas la soumission ou la conformité à une révélation extérieure, c’est-à-dire transcendante. Le dehors auquel la pensée à affaire ici n’est pas un donné auquel elle n’aurait qu’à se plier ou se conformer : c’est la pensée elle-même qui naît dans cette irruption du Dehors ou de la différence. Elle naît en engageant un devenir de la pensée, mais en aucun cas ce devenir n’est une imitation ou une simple copie. C’est en ce sens que la pensée est croyance : elle ne se conforme pas à une Révélation qui la transcende ; elle est l’affirmation de l’élément problématique dans lequel elle se trouve exhortée, forcée à s’engendrer, en son sein même.
Croire à ce monde-ci.
Cette substitution d’image de la pensée a des conséquences qui ne concernent pas seulement la philosophie. Elle entraîne en effet une perte de monde, qui se constate aussi bien sur le plan théorique que pratique. L’image traditionnelle de la pensée comme connaissance supposait en effet une complicité de l’homme et du monde, voire une isomorphie de la connaissance et du monde en tant qu’il peut être connu. Ainsi chez Aristote : si la perception est la capacité à recevoir les formes sensibles, l’intellect est celle de recevoir les formes intelligibles : l’esprit, recevant la forme de ce qu’il connaît, se fait semblable à son objet. Cette appréhension purement intellectuelle est en fait l’actualisation d’une puissance propre de l’esprit : l’esprit est puissance de connaissance, c’est-à-dire puissance de se faire semblable à son objet – la forme intelligible – qu’il reçoit[48]. Il y a donc bien isomorphie entre l’esprit qui connaît et le monde connu, et c’est cette isomorphie que rend la connaissance possible. Mais elle se fonde en dernier lieu sur un intellect agent, seul capable de l’assurer : l’intellect étant pure puissance il ne connaît rien par lui-même (« […] sans l’intellect agent, rien ne pense. »[49]) ; les formes intelligibles sont d’abord mêlées aux sensations ou aux images, il faut donc les dégager, les produire de sorte à ce que l’intellect patient puisse les recevoir et ainsi actualiser sa puissance – tel est le rôle de l’intellect agent, qu’Aristote compare à la Lumière : « […] car, en un certain sens, la lumière, elle aussi, convertit les couleurs en puissance, en couleurs en acte[50]. » On retrouve cette isomorphie de l’esprit qui connaît et du monde connu chez Descartes : si, comme l’avait postulé Galilée, le monde est connaissable à l’aide des mathématiques et de la géométrie[51], c’est que d’une part la matière créée par Dieu est une étendue purement géométrique, dont les mouvements sont exprimables mathématiquement et géométriquement, et d’autre part, Dieu a déposé dans l’esprit humain, au moment de sa création, les idées adéquates[52]. Dans les deux cas cette complicité de l’homme et du monde, de l’esprit qui connaît et du monde connaissable requiert un troisième terme qui la garantisse : intellect agent d’Aristote, Dieu vérace cartésien, mais aussi l’art caché du schématisme transcendantal kantien. C’est que l’image traditionnelle de la pensée-connaissance s’applique aussi à un second degré, lorsqu’il s’agit de penser la connaissance elle-même : car si la connaissance procède par représentation – c’est-à-dire par l’unification d’un divers sous la forme du Même, alors cette complicité de l’homme et du monde relève d’une représentation, par laquelle l’homme connaissant et les objets connaissables sont ramenés comme les parties diverses à l’unité d’un même monde, par un principe garantissant cette unité et cette identité. C’est ce que pointent Deleuze et Guattari lorsqu’ils décrivent un livre selon cette image traditionnelle :
Le livre imite le monde, comme l’art, la nature : par des procédés qui lui sont propres, et qui mènent à bien ce que la nature ne peut pas ou ne peut plus faire. La loi du livre, c’est celle de la réflexion, le Un qui devient deux.[53]
Cette complicité est aussi bien théorique que pratique. L’image traditionnelle de la pensée concerne aussi l’action. Celle-ci, dans cette perspective, se conçoit selon les impératifs de la représentation, et doit donc toujours être relative à une situation à partir de laquelle elle se comprend. Cette situation doit être comprise en termes d’espace hodologique, tel que Kurt Lewin l’a défini[54]. L’espace hodologique, c’est l’espace vécu du point de vue de l’action et structuré en fonction d’elle : puisque l’action vise quelque chose comme à réaliser, l’espace hodologique est celui dans lequel certains éléments apparaissent comme exigeant d’être atteints[55]. De ce fait, ils renvoient à d’autres comme aux moyens de leur réalisation, qui apparaissent à leur tour comme exigeant d’être réalisés, etc. L’espace hodologique est donc structuré par des voies ou des chemins de réalisation allant au plus court (selon un principe d’économie de l’action), d’un moyen à un autre et des moyens à la fin. C’est donc un espace représenté, ou selon la représentation, puisque des parties ou régions s’y distinguent, mais se trouvent coordonnées ou subordonnées les unes aux autres comme les moyens aux fins ; elles se trouvent donc ramenées à l’unité d’un même espace ou d’une même situation. Cependant, dans l’espace hodologique apparaissent perpétuellement des tensions entre, d’une part, l’exigence de ce qui est à réaliser, et d’autre part des obstacles, qui peuvent rendre les voies de réalisation impraticables. Ces tensions mettent en péril l’unité de la situation L’action est alors ce qui résout ces tensions et par là sauve ou restaure l’unité de la situation, c’est-à-dire sauve ou restaure la situation comme représentation. L’action ainsi conçue consiste donc dans la réaction à une situation, qui en restaure l’unité. On voit ainsi en quoi l’action marque la complicité de l’homme avec le monde, puisqu’elle est justement ce par quoi le monde – incluant l’homme – sauve son unité. C’est précisément ce lien que Deleuze appelle le schème sensori-moteur, selon une expression empruntée à Bergson[56], qui décrit la manière dont la perception – ici la perception de la tension à l’œuvre dans le monde – se prolonge en action – qui résout la tension.
La substitution de l’image de la pensée comme croyance à l’image traditionnelle de la pensée comme connaissance affecte du même coup le rapport de l’homme et du monde : elle implique une rupture de cette complicité, théorique et pratique, de l’homme et du monde. Cette rupture ne signifie pas que l’homme serait hors nature ou n’en serait plus une partie, mais bien plutôt que les parties de la nature – dont l’homme – sont devenues indifférentes entre elles ; comme telles, elles ne peuvent plus être rapportées à l’unité d’un même Tout, ni ramenées sous la Forme du Même, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent plus être représentées. C’est ce que note Deleuze dans le cours de novembre 1984 :
Et qu’est-ce que ça veut dire la rupture de l’homme et du monde ? […] Evidemment, ça ne veut pas dire que l’homme, il est hors de la nature […]. Qu’on fasse partie de la nature, ça change rien. C’est plutôt les parties de la nature qui sont indifférentes les unes aux autres. […] Rupture de l’homme et du monde ça ne veut donc pas dire : l’homme a un destin exceptionnel dans le monde ; non, ça veut dire au contraire que l’homme est une partie de la nature mais que les parties de la nature restent indifférentes les unes aux autres.[57]
C’est selon l’image traditionnelle que les parties de la nature devaient être représentées, c’est-à-dire rassemblées sous la Forme du Même, en un même Tout : comme telles, elles participaient à un Tout, ce par quoi elles entretiennent un lien ou une complicité. Mais si penser, ce n’est plus connaître, alors la pensée se joue essentiellement dans le problématique, c’est-à-dire dans la multiplicité, qui fait système sans avoir jamais recours à une Forme du Même ou de l’Un. Le monde n’est plus alors, une unité du divers, mais une coexistence d’hétérogènes. Pour l’illustrer, Deleuze recourt à la reconnaissance attentive, telle qu’elle a été décrite par Bergson, dans Matière et Mémoire[58]. Celle-ci consiste dans le retour perpétuel sur un objet singulier qu’il s’agit de reconnaître (le goût, chez Proust, de la madeleine dans le thé, par exemple). Elle procède donc par une série de tentatives : elle cherche dans le passé une image qui s’adapte à la perception présente ; mais puisqu’elle s’attache à saisir l’objet dans sa singularité, elle ne peut trouver dans le passé une image qui le recouvrirait parfaitement. Chacune des images tirées du passé ne peut convenir que partiellement à l’objet, dont elle ne recouvre que quelques traits. Il faut une nouvelle plongée dans le passé pour en ramener une autre image, toute aussi imparfaite, qui marquera d’autres traits ; mais ceux-ci ne complètent pas les premiers, ils les recoupent partiellement, les remplacent, les intègrent ou les déplacent, et dans certains cas les contredisent. La reconnaissance attentive n’a plus affaire à une synthèse d’aspects divers sous la Forme d’un Même objet, mais à la coexistence d’aspects hétérogènes, incompossibles. On n’objectera pas qu’il s’agit seulement d’un état provisoire de notre connaissance, c’est-à-dire d’un état seulement subjectif. Bergson insistait sur l’extrême solidarité entre l’objet et le processus d’attention : à mesure que l’attention s’approfondit, que ses circuits plongent de plus en plus profondément dans le passé, l’objet lui-même s’enrichit[59], et c’est donc l’objet qui est problématique en lui-même. Les parties ne pouvant plus être ramenées à la Forme du Même, elles ne sont plus, à proprement parler, des parties. Ce sont des dimensions ou aspects coexistants, sans lien les uns avec les autres. Ainsi l’homme n’a plus de complicité avec le monde, telle qu’elle était impliquée dans l’idéal de connaissance, mais qui sous-tendait aussi l’action. Le lien sensori-moteur est rompu. Il n’y a plus d’unité du monde qu’il faudrait restituer ou sauver, c’est-à-dire qu’il n’y a plus d’action possible – du moins, telle qu’elle a été conçue jusqu’ici. La rupture du lien de l’homme et du monde, c’est l’impossibilité de l’action : nous nous trouvons alors dans une situation optique et sonore pure. C’est dans le cinéma d’après-guerre que, selon Deleuze, se forme ce nouveau type d’image. Le cinéma d’avant-guerre était un cinéma d’image-action, c’est-à-dire d’une image qui se prolongeait en action, suivant ainsi le schème sensori-moteur. L’image y était bien optique et sonore, évidemment. Mais les personnages s’y trouvaient dans une situation à laquelle ils pouvaient répondre par une action, et le spectateur y participait indirectement, par identification avec les personnages.[60] La situation optique et sonore pure est donc une perception disjointe de l’action, qui ne se prolonge pas en elle, ou à laquelle aucune action ne peut répondre[61] : le personnage est devenu spectateur de ce qui lui arrive. L’exemple le plus évident concerne Le Voleur de Bicyclette, de De Sica. Le père a beau s’agiter pour retrouver son voleur, rien de ce qu’il entreprend n’aboutit, pas même lorsqu’il se risque à voler lui-même une bicyclette. Il ne peut agir, il ne peut qu’être spectateur de ce qui lui arrive – raison pour laquelle le film est tourné du point de vue de son fils enfant : impuissant dans le monde des adultes, il est d’autant plus à même de voir et d’entendre.[62] Or, déconnectées de l’action, l’image optique et sonore dessine un espace tout différent de l’espace sensori-moteur : les milieux s’y trouvent déconnectés, dispersés plutôt que subordonnés à l’action dans l’espace hodologique[63]. Si c’est au cinéma que Deleuze voit apparaître les situations optiques et sonores pures, ce changement de régime ne concerne pas que le cinéma. C’est un changement d’image de la pensée : l’homme est devenu « voyant », selon un mot que Deleuze emprunte à Rimbaud. C’est pourquoi dans cette situation, rien de ce qui arrive – ou même nous arrive – ne nous concerne vraiment. Tel est le « fait moderne », selon Deleuze : nous ne croyons plus au monde[64].
[1] Cf. Nietzsche et la philosophie, Paris, P.U.F., 1962, III, 15.
[2] Deleuze et Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, éd. de Minuit, 1991, I, 2 : « Il y a religion chaque fois qu’il y a transcendance […], et il y a philosophie chaque fois qu’il y a immanence. »
[3] « Bref, les premiers philosophes sont ceux qui instaurent un plan d’immanence […]. Ils s’opposent en ce sens aux Sages, qui sont des personnages de la religion, des prêtres, parce qu’ils conçoivent l’instauration d’un ordre toujours transcendant, imposé du dehors par un grand despote ou par un dieu supérieur aux autres […] », Qu’est-ce que la philosophie ?, I, 2, p. 45. Cf. aussi Logique du sens, Appendices, p. 323 : « Le premier philosophe est naturaliste. Il discourt sur la nature au lieu de discourir sur les dieux. »
[4] Cf. Qu’est-ce que la philosophie ? I, 2, p. 46 : « Il se peut que les premiers philosophes, et surtout Empédocle, aient encore l’air de prêtres ou même de rois. Ils empruntent le masque du sage, et, comme dit Nietzsche, comment la philosophie ne se serait-elle pas déguisée à ses débuts ? Cessera-t-elle-même d’avoir à se déguiser ? »
[5] Cinéma 2. L’image-temps, Paris, éd. de Minuit, 1985, 7, p. 223.
[6] Ibid. : « C’est le lien de l’homme et du monde qui se trouve rompu. Dès lors, c’est ce lien qui doit redevenir objet de croyance ; il est l’impossible qui ne peut être redonné que dans une foi. »
[7] Par exemple en 1962 dans Nietzsche et la philosophie, en 1967 dans un article consacré au naturalisme de Lucrèce, et, de manière plus systématique, dans Qu’est-ce que la philosophie ? en 1991.
[8] Cinéma 2, p. 223.
[9] De ce point de vue, la position effective de Deleuze nous semble à l’opposé d’un renoncement à la philosophie au profit « de la croyance et de la foi qui sont les figures subjectives de l’opinion et de la religion », comme l’affirme A. Gualandi dans Deleuze, Paris, éditions Perrin, 2009, p. 153. Cette position nous semble, par ailleurs, faire l’impasse sur la lecture détaillée des textes concernant cette question.
[10] Ibid. : « Chrétiens ou athées, dans notre universelle schizophrénie, nous avons besoin de croire en ce monde. »
[11] On se souvient en effet que Kant voyait l’affirmation d’une immanence absolue de la nature comme l’objet d’un intérêt seulement spéculatif de la raison : « En revanche, l’empirisme offre à l’intérêt spéculatif de la raison des avantages qui sont fort attrayants et qui surpassent de beaucoup ceux que peut permettre le docteur dogmatique des idées rationnelles. En le suivant, l’entendement reste toujours sur son propre terrain, c’est-à-dire dans le champ des simples expériences possibles ; il peut toujours en rechercher les lois et, au moyen de ces lois, étendre sans fin sa connaissance compréhensible et sûre. » Kant, Critique de la raison pure, Dialectique transcendantale, livre second, chap. II, 3ème section : « De l’intérêt de la raison dans ce conflit avec elle-même. »
[12] Cf. Cinéma 2, 7, p. 224.
[13] Ibid., p. 225.
[14] Ibid. pp. 222-223 : « C’est toute une conversion de la croyance. C’était déjà un grand tournant de la philosophie, de Pascal à Nietzsche : remplacer le modèle du savoir par la croyance. Mais la croyance ne remplace le savoir que quand elle se fait croyance en ce monde, tel qui est. »
[15] Deleuze et Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? I, 2, pp. 39-40.
[16] Deleuze, Différence et répétition, III, p. 169.
[17] Cf. Qu’est-ce que la philosophie ? I, 2, p. 40 : « ce n’est pas une méthode, car toute méthode concerne éventuellement les concepts et suppose une telle image. »
[18] Ibid. : « L’image de la pensée implique une sévère séparation du fait et du droit : ce qui revient à la pensée comme telle doit être séparé des accidents qui renvoient au cerveau, aux opinions historiques. […] L’image de la pensée ne retient que ce que la pensée peut revendiquer en droit. »
[19] Cf. Différence et répétition, III, p. 170 : « Cet élément consiste seulement dans la position d’une pensée comme exercice naturel d’une faculté, dans le présupposé d’une pensée naturelle, douée pour le vrai, en affinité avec le vrai, sous le double aspect d’une bonne volonté du penseur et d’une nature droite de la pensée. »
[20] Ibid., p. 174.
[21] Descartes, Méditations métaphysiques, II.
[22] Par exemple dans le cours du 13 novembre 1984.
[23] Ibid. : « Pourtant il y a un monde suprasensible. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi le dire puisque nous ne le connaissons pas et ne pouvons pas le connaître ? Parce que nous pouvons et devons le penser. Conséquence formidable : la pensée excède la connaissance, il y a des choses qui ont pensées et qui ne constituent aucune connaissance. Connaître n’est qu’un cas. Connaître n’est qu’une espèce de la pensée. »
[24] Ibid.
[25] Cf. Kant, Critique de la raison pure, Dialectique transcendantale, Livre second, chap. II, 1ères et 2èmes sections.
[26] Ibid., 8èmes et 9èmes sections, et Appendice. Sur ce point, cf. Deleuze, Différence et répétition, IV, p. 220.
[27] Ibid.
[28] Différence et répétition, IV, p. 236.
[29] Ibid., III, p. 191 : « Artaud dit que le problème (pour lui) n’est pas d’orienter sa pensée, ni de parfaire l’expression de ce qu’il pense, ni d’acquérir application et méthode, ou de perfectionner ses poèmes, mais d’arriver tout court à penser quelque chose. »
[30] A. Artaud, Correspondance avec Rivière, cité par Deleuze, Différence et répétition, III, p. 192 : « Sous la grammaire, il y a la pensée qui est un opprobre plus fort à vaincre, une vierge beaucoup plus rêche à outrepasser quand on la prend pour un fait inné. Car la pensée est une matrone qui n’a pas toujours existé. »
[31] Cf. Maurice Blanchot, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1968, et L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955 ; Michel Foucault, « La Pensée du Dehors », in Critique, n°229, juin 1966, pp. 523-546, repris dans Dits et Ecrits I, 1954-1975, Paris, Gallimard, 2001, texte n°38, pp. 546-567. Cf. aussi Gilles Deleuze, Foucault, Paris, éditions de Minuit, 1986 (essentiellement le chapitre intitulé : « Les stratégies et le non-stratifié : la pensée du dehors (pouvoir) », et le cours du 29 avril 1986.
[32] Cours du 29 avril 1986, op. cit.
[33] Platon, République, VII, 523b. Cf. Deleuze, Différence et Répétition, III, p. 181.
[34] Ibid.
[35] Cours du 29 avril 1986, op. cit.
[36] Deleuze, Proust et les signes, Paris, P.U.F., 1964, I, 2, p. 32.
[37] Cf. sur ce point Logique du sens, appendice I, p. 301, ou Différence et répétition, introd. p. 31 ou V, p. 286.
[38] Cf. la remarque de Deleuze à propos d’Artaud dans Différence et répétition, III, p. 192 : « Il sait que la difficulté comme telle, et son cortège de problèmes et de questions, ne sont pas un état de fait, mais une structure en droit de la pensée. Qu’il y a un acéphale dans la pensée, comme un amnésique dans la mémoire, un aphasique dans le langage, un agnosique dans la sensibilité. Il sait que penser n’est pas inné, mais doit être engendré dans la pensée. »
[39] Deleuze, Cinéma 1. L’Image-mouvement, Paris, Editions de Minuit, 1983, avant-propos, p. 7.
[40] Deleuze, Cinéma 2, 7, p. 203.
[41] Cf. Michel Foucault, L’Usage des Plaisirs, Paris, Gallimard, 1984, pp. 15-16.
[42] Nietzsche et la philosophie, III, 15, p. 119.
[43] Ibid., pp. 120-121, ou Cinéma 2, 6, p. 191.
[44] Cf. Différence et répétition, IV, p. 245 : « L’esprit faux, la bêtise elle-même, se définit avant tout par ses perpétuelles confusions sur l’important et l’inimportant, l’ordinaire et le singulier. » Cf. aussi la remarque de Deleuze au ch. III, pp. 198-199 : « Déjà les professeurs savent bien qu’il est rare de rencontrer dans les « devoirs » (sauf dans les exercices où il faut traduire proposition par proposition, ou bien produire un résultat fixe) des erreurs ou quelque chose de faux. Mais des non-sens, des remarques sans intérêt ni importance, des banalités prises pour remarquables, des confusions de « points » ordinaires avec des points singuliers, des problèmes mal posés ou détournés de leur sens, tel est le pire et le plus fréquent, pourtant gros de menace, notre sort à tous. »
[45] Ibid., III, p. 207.
[46] Cf. Kant, Critique de la raison pratique, Paris, P.U.F., 2000, trad. F. Picavet,Première partie, Livre deuxième, IV : « Car nous ne connaissons par-là ni la nature de notre âme, ni le monde intelligible, ni l’Être suprême, quant à ce qu’ils sont en eux-mêmes, nous n’avons fait que réunir leurs concepts dans les concepts pratiques du souverain bien. »
[47] C’est la manière dont Deleuze, dans le cours du 13 novembre 1984, lit Kant, marquant sa différence par rapport aux tenants d’une religion révélé : « En d’autres termes, il y a des croyances de la pensée en tant que pensée. Voyez en quoi là aussi c’est très nouveau, parce que les partisans d’une religion révélée ne le disent pas. En effet la révélation implique quelque chose de plus haut que la pensée. La révélation me fait croire, fait que ma pensée croit à quelque chose. Mais Kant, ce n’est pas ce qu’il veut dire. C’est la pensée qui, en tant que pensée engendre ses propres croyances. Elle a des croyances, elle est inséparable des croyances, et finalement c’est la connaissance qui est un cas spécial de croyance et pas du tout l’inverse. ».
[48] Cf. Aristote, De l’âme, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1995,III, 4, 529a : « Il faut donc que cette partie de l’âme soit impassible, tout en étant susceptible de recevoir la forme ; qu’elle soit en puissance, telle que la forme, sans être pourtant cette forme elle-même, et que l’intellect se comporte par rapport aux intelligibles de la même façon que la faculté sensible envers les sensibles. »
[49] Ibid., III, 5, 430a.
[50] Ibid.
[51] « La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l’Univers, mais on ne peut le comprendre si l’on ne s’applique d’abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d’en comprendre un mot. », Galilée, L’Essayeur, 1623, trad. C. Chauviré, Paris, Belles Lettres, 1989.
[52] Cf. Descartes, Le Monde, chap. VI et VII, et Discours de la méthode, V : « […] j’ai remarqué certaines lois, que Dieu a tellement établies en la nature, et dont il a imprimé de telles notions en nos âmes, qu’après y avoir fait assez de réflexion, nous ne saurions douter qu’elles soient exactement observées, en tout ce qui est et se fait dans le monde. »
[53] Deleuze et Guattari, Mille plateaux, Paris, éd. de Minuit, 1980, p. 11.
[54] Le concept est introduit par Kurt Lewin en 1917 dans « Kriegslandschaft », Zeitschrift für Angewandte Psychologie, 12, 440-447.
[55] C’est la manière dont Sartre, par exemple, lit les travaux de Lewin, dans Esquisse d’une théorie des émotions, Paris, Le Livre de Poche, 1995, ch. III.
[56] Cf. Bergson, Matière et Mémoire, par exemple au ch. III, Paris, P.U.F., 1999, p. 153 : « Mon présent est, par essence, sensori-moteur. »
[57] Cours du 13 novembre 1984.
[58] Cf. Matière et Mémoire, II, op. cit., pp. 113-116.
[59] Cf. Matière et Mémoire, op. cit., p. 115 : « On voit que le progrès de l’attention a pour effet de créer à nouveau, non seulement l’objet aperçu [c’est nous qui soulignons] mais les systèmes de plus en plus vastes auxquels il peut se rattacher […] »
[60] Cf. Cinéma 2, 1, p. 9 : « Car les personnages, eux, réagissaient aux situations […]. Ce que le spectateur percevait, c’était donc une image sensori-motrice à laquelle il participait plus ou moins, par identification avec les personnages. »
[61] Ibid., p. 29 : « Une situation optique et sonore ne se prolonge pas en action, pas plus qu’elle n’est induite par une action. »
[62] Ibid., p. 10.
[63] Ibid., p. 13 : « Les situations optiques et sonores du néo-réalisme s’opposent aux situations sensori-motrices fortes du réalisme traditionnel. La situation sensori-motrice a pour espace un milieu bien qualifié, et suppose une action qui la dévoile, ou suscite une réaction qui s’y adapte ou la modifie. Mais une situation purement optique ou sonore s’établit dans ce que nous appelions « espace quelconque », soit déconnecté, soit vidé […] »
[64] Cf. Cinéma 2, 7, p. 223 : « Le fait moderne, c’est que nous ne croyons plus en ce monde. Nous ne croyons même pas aux événements qui nous arrivent, l’amour, la mort, comme s’ils ne nous concernaient qu’à moitié. Ce n’est pas nous qui faisons du cinéma, c’est le monde qui nous apparaît comme un mauvais film. »