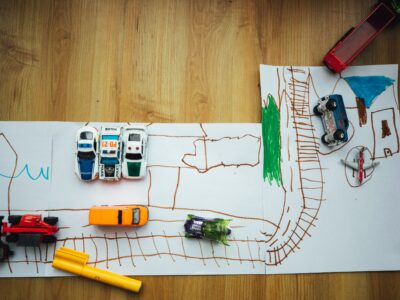Hans Blumenberg et les frontières du monde de la vie
Alban Stuckel, doctorant à l’École Normale Supérieure (Archives Husserl, Pays germaniques – UMR 8547).
Résumé
La thématique du monde de la vie traverse l’œuvre de Hans Blumenberg et ses rapports critiques à la phénoménologie de Husserl. En interrogeant le problème central du franchissement empirique ou transcendantal de la frontière du monde de la vie, les analyses de Blumenberg permettent de reculer les frontières internes de la méthode phénoménologique et d’abolir ses frontières externes avec une phénoménologie de l’histoire et une anthropologie phénoménologique.
Mots-clefs : Blumenberg, Husserl, phénoménologie, monde de la vie, frontière.
Abstract
The theme of the lifeworld runs through Hans Blumenberg’s work and his critical relationship to Husserl’s phenomenology. By addressing the problem of the crossing of the lifeworld borders from both an empirical and a transcendental point of view, Blumenberg secures the means to underline the internal frontiers of the phenomenological method and to abolish its external borders with a phenomenology of history and a phenomenological anthropology.
Keywords : Blumenberg, Husserl, phenomenology, lifeworld, borders.
Introduction
Cet article se propose de contribuer à l’exploration de la thématique du monde de la vie (Lebenswelt) chez Hans Blumenberg en partant du problème de sa frontière. Pour Husserl, le monde de la vie désigne formellement l’univers des évidences prédonnées qui fournit le fond prémodal et antéprédicatif sur lequel se détache tout acte de signification. Mais son approche pâtit de ce qu’en termes kantiens l’on pourrait nommer une amphibolie du monde de la vie – c’est-à-dire une confusion entre l’usage transcendantal et l’usage empirique de son concept. Cela tient notamment au manque de détermination historique et anthropologique de ce qu’est le monde de la vie. C’est pourquoi Blumenberg s’attache à reprendre cette thématisation husserlienne du monde de la vie au triple sens où il en hérite, la corrige et la coud à d’autres disciplines aux frontières desquelles Husserl l’avait arrêtée, en particulier à une philosophie de l’histoire et à une anthropologie phénoménologique. Le problème central qui émerge alors est celui du franchissement de la frontière du monde de la vie. Si la sortie hors du monde de la vie relève d’un événement historique voire anthropogénétique, peut-on en identifier les ressorts empiriques ? S’agit-il d’un événement unique – un commencement, voire une décision selon Husserl – ou bien d’une genèse répétée au cours de l’histoire marquée par une succession d’époques ? Auquel cas il faudrait considérer le monde de la vie non comme le commencement historique de la conscience, mais comme sa condition de possibilité métahistorique. Se dégage alors une conception transcendantale du monde de la vie comme « concept-frontière », comme valeur limite de la coïncidence de la conscience avec elle-même à partir de laquelle – et contre laquelle – se déploie son activité intentionnelle. La détermination du statut de la limite du monde de la vie comme horizon ou comme frontière, individuelle ou collective, passée ou future, anhistorique ou métahistorique, empirique ou transcendantale entraîne finalement avec elle la définition même du monde de la vie. Poser le problème du franchissement des frontières du monde de la vie, qui parcourt tout le corpus de Blumenberg comme une série de variations sur un même thème, c’est donc suivre le détour historique (I) et anthropologique (II) qu’il imprime à la phénoménologie husserlienne pour souligner à la fois le recul des frontières de sa méthode et l’abolition de ses frontières disciplinaires.
I. Les frontières de l’histoire
I.1. L’historicité du monde, frontière de la méthode de la réduction
Dès sa thèse d’habilitation de 1950, Blumenberg fait ressortir un certain nombre de « points critiques », au sein de la phénoménologie husserlienne, qui font d’elle un symptôme de la crise qu’elle diagnostique dans le mouvement moderne de la pensée. Blumenberg définit la « crise » en général comme le fait que ce qui allait de soi ne va plus de soi (1950 : 5), comme l’effondrement du sol d’évidences inquestionnées sur lequel se tenait une époque : c’est la perte du monde de la vie. C’est pourquoi, dans ce travail d’inspiration heideggérienne sur « l’historicité de l’histoire de la philosophie », Blumenberg revient aux origines de la crise propre à la modernité et les trouve dans le présupposé d’une « distance ontologique » entre le sujet qui se pose lui-même et les objets qui lui font face (1950 : 10). Or la méthode phénoménologique de la réduction serait comme la dernière manière de ce présupposé cartésien, et encore plus radicale qu’elle dans la mesure où elle annihile le sol même de la réalité en concentrant toute l’essence sur le seul pôle du sujet. Mais quelque chose surgit, dans la modernité, qui remet en question ce présupposé ontologique et par conséquent la manière dont le sujet moderne se comprend : c’est l’historicité de l’histoire de la pensée, la prise de conscience de ce que la modernité, qui se comprenait elle-même comme définitive et polarisait sur son propre présent les époques qu’elle découpait dans le passé, n’est à son tour qu’une époque de l’histoire et qu’à ce titre elle est elle-même transitoire et finie. Le sol d’évidences sur lequel se tenait la modernité s’effondre lorsqu’elle prend conscience de sa contingence historique et tombe ce faisant dans un abîme de perplexité : c’est la définition même de l’expulsion hors de l’assurance du monde de la vie.
Car si l’historicité du monde surgit ici comme la frontière de la méthode de la réduction phénoménologique, c’est parce que le monde n’est pas un objet parmi les autres que l’on pourrait à loisir transformer en phénomène et transposer dans le mode hypothétique du peut-être. Il est au contraire l’unité de sens présent de l’être et se caractérise à cet égard à la fois comme effectivité historique et comme totalité (ce que permet de saisir le concept d’horizon). Ainsi, l’épochè peut certes mettre en suspens la croyance en la réalité comme en un objet, mais elle ne peut viser le monde en tant que tel. Par conséquent, l’homme ne peut pas non plus atteindre la subjectivité absolue dont l’effectivité de l’existence serait le produit. Plutôt qu’un recours au sujet transcendantal, cette topologie onto-historiciste indique que chacun fait l’expérience du présent historique comme de l’unité de sens de l’horizon de la vie qu’il partage avec d’autres. C’est « un “dedans (In)” qui ne se laisse édulcorer en aucun “sur (Über)” » (1950 : 153) – ce « à quoi, en quoi et par quoi (Woran, Worin und Wodurch) » renvoie tout étant (1950 : 164). L’homme se trouve donc d’emblée pris dans une telle unité de sens et son existence s’oriente en fonction des données et des structures de ce « monde » dans lequel il vit, dont la disposition d’ensemble n’est l’effet d’aucune constitution. C’est le « monde de la vie » que, dans une perspective historique, l’on peut aussi appeler une « époque ». Car si le champ est néanmoins structuré, c’est précisément en raison de son caractère historique, de la sédimentation des produits de l’activité symbolique antérieure dans le sol de l’évidence toujours contemporaine. La croyance dite naïve en l’existence du monde – cela même que la méthode de la réduction imposait de suspendre – n’est donc pas qu’une thèse générale : elle s’élargit désormais aux dimensions d’un monde doté d’un horizon de sens et d’une historicité dont il faut justement explorer l’histoire pour savoir en quoi consiste cette évidence que l’on croyait pouvoir commencer par mettre en suspens.
Cette critique entraîne deux conséquences. La première, déjà aperçue par Husserl, le conduit à amender la méthode de la réduction du monde naturel au profit d’une méthode du retour au monde de la vie. Blumenberg souligne à cet égard le lien entre le tournant génétique que prend la phénoménologie à partir des années 1920 et la thématisation du monde de la vie. La logique génétique de Husserl cherche en effet à décrire la genèse des opérations logiques à partir de vécus intuitifs, c’est-à-dire à fonder les évidences prédicatives sur les évidences antéprédicatives de l’expérience originaire prédonnée dans le monde de la vie – « c’est-à-dire un monde dans lequel nous vivons toujours déjà et qui constitue le sol de toute opération de connaissance et de toute détermination scientifique » (1970 : 47). Husserl cherche par exemple à décrire la genèse de la négation et de la modalisation au sein la sphère antéprédicative de l’expérience réceptive (1970 : 102). La négation « biffe » rétrospectivement le sens que les phases antérieures d’un acte de perception prescrivent protentionnellement (l’objet n’est pas x mais y) : elle présuppose donc le sol de la certitude de croyance. De même la modalisation, née d’un conflit entre deux saisies perceptives possibles (l’objet peut être x ou y), modifie par des présomptions de croyance (noématiquement : d’être) le mode originaire de la validité certaine. Négation et modalisation, en tant que modifications de la conscience, présupposent donc toutes deux la perception normale qui constitue l’objet de sorte à satisfaire l’intérêt perceptif en lui présentant l’objet dans une certitude de croyance (il est, et il est tel). Or le sol de cette certitude de croyance – le fondement de cette validité originaire – n’est rien d’autre que le monde de la vie. Ce sont là autant d’analyses auxquelles Blumenberg attribue le mérite d’avoir aboli la divergence moderne entre le monde de la vie et le monde de la science qui en explicite le sens. Le tournant génétique permet à la phénoménologie de repousser les frontières de sa prétention au réalisme en substituant à la déduction de l’intuition catégoriale la description du monde de la vie comme le fond(s) d’où surgissent les vécus qui fondent les procédés prédicatifs. En ce sens, le monde de la vie dessine la valeur limite ou la frontière de la génétisation des problèmes de la phénoménologie, qui montre ainsi par quelles performances de la conscience la transcendance provient en fait de l’immanence. Toute la difficulté – et pour ainsi dire la frontière de la méthode déployée – consiste alors non plus en ce que la chose résiste à la réduction, mais en ce qu’elle échappe à la description dont la valeur limite est, derechef, l’évidence.
I.2. Vers une phénoménologie de l’histoire
Mais Blumenberg se démarque clairement de Husserl par la prise en compte de la seconde conséquence de ce point critique : il lui apparaît non seulement possible mais nécessaire, d’établir une « phénoménologie de l’histoire » qui porte sur la « métacinétique des horizons de sens et des manières de voir historiquement déterminées » (2006 : 12), c’est-à-dire sur la façon dont les arrière-plans de signification se métamorphosent les uns dans les autres à mesure que ce qui semble aller de soi – le monde de la vie – évolue. En d’autres termes, il s’agit de scruter ce que l’on pourrait appeler les mues de l’évidence au cours de l’histoire, tout en prenant en compte le fait que nos outils et nos méthodes d’investigation sont eux-mêmes nécessairement pris dans le mouvement de l’histoire. On peut se représenter le plan de l’évidence comme une vitre de verre à travers laquelle l’on perçoit non seulement ce qui est réel mais d’abord ce qu’est la réalité elle-même (dont le concept évolue au cours de l’histoire). D’abord, le verre est un « milieu » à première vue invisible pour celui qui regarde à travers lui mais également pour celui qui prétend l’observer directement, du moins tant que n’apparaissent pas à sa surface des traces d’éclats ou de rayures qui en attestent la présence telles que la « biffure » que produit le phénomène originaire de la négation selon Husserl. Mais le verre se définit en outre, ainsi que Blumenberg aime à le rappeler, comme « un fluide refroidi de très haute dureté, doté d’une vitesse d’écoulement qui pratiquement est infiniment réduite » (2017 : 39) : il faut donc nécessairement le recul de l’historien – ou du métaphorologue qui étudie les mutations d’une métaphore au cours de l’histoire – pour apercevoir rétrospectivement la dynamique qui affecte les évidences elles-mêmes. Or cela suppose plus fondamentalement encore de disposer d’un cadre constant de référence – par analogie : d’une définition générale du verre – afin de saisir le caractère de nouveauté de chacune de ces mues de l’évidence ou, d’un point de vue historique, de chaque « tournant d’époque ». Pour Blumenberg, l’époque n’est en effet qu’une « frontière (limes) imperceptible » (1999 : 533) : pour rendre manifeste le seuil que représente la réforme copernicienne, il propose par exemple dans la quatrième partie de La Légitimité des temps modernes une analyse différentielle des indices de ce seuil en comparant l’horizon historique de possibilité propre à Nicolas de Cues et celui qui est propre à Giordano Bruno. Or, sous leurs oppositions de part et d’autre de ce seuil, il s’avère que leurs manières de percevoir le réel s’insèrent encore dans des cadres congruents dans la mesure où elles répondent à des questions homologues. C’est la permanence de ce cadre de référence, le maintien d’une identité minimale sous le tumulte des événements, que désigne le concept de « réinvestissement (Umbesetzung) » des questions relativement constantes à travers l’histoire. Mais ces questions que l’on trouve toujours déjà posées, et auxquelles les « métaphores absolues » apportent autant de réponses qui ne peuvent être résorbées en concepts, traduisent à leur tour l’embarras dans lequel l’homme se trouve plongé au sortir du monde de la vie, alors qu’il quitte la sphère des évidences prédonnées (exempte de toute structure de question/réponse), fait l’expérience de la contingence et se pose la question du sens. La constance des réinvestissements suppose la perte perpétuelle du monde de la vie qui seule confère leur sens aux questions perpétuellement reconduites.
I.3. De la frontière à l’horizon
On comprend dès lors pourquoi il faut aborder le monde de la vie en passant par ses frontières : c’est d’abord parce que l’on ne peut procéder autrement. Nous qui cherchons à concevoir l’univers des évidences prédonnées l’avons en fait toujours déjà quitté et ne pouvons plus nous y rapporter que rétrospectivement. Une « théorie du monde de la vie » doit par conséquent prendre en considération non seulement le thème du « monde de la vie » lui-même mais aussi le regard théorétique qui prétend le thématiser. Conformément à sa reformulation historiciste du questionnement kantien, Blumenberg se demande donc, dans l’appendice de la Theorie der Lebenswelt, ce que nous avons voulu savoir en interrogeant le monde de la vie. Il fournit plusieurs « possibilités de réponse » (2010 : 227) qui varient selon la perspective adoptée : en interrogeant le monde de la vie, on a pu rechercher tour à tour une origine anthropologique ou métaphysique, la base génétique d’intelligibilité du processus scientifique, la condition de possibilité du progrès historique, le critère d’évaluation de la culture contemporaine, voire l’état idyllique qui justifie sa critique. Mais, quant à lui, Blumenberg avance que si nous avons besoin d’une théorie du monde de la vie, c’est parce que nous ne vivons plus dans un tel monde ou du moins ne savons pas dans quelle mesure, pourquoi et comment nous l’avons quitté, ni ce que nous avons perdu ou gagné en l’abandonnant (2010 : 231). Il s’agit en somme d’évaluer la portée du franchissement d’une frontière.
Mais la prise en compte de la position du théoricien du monde de la vie met en question le statut de cette frontière. Car si elle apparaît bien comme telle selon le point de vue rétrospectif du théoricien qui a toujours déjà quitté le monde de la vie, il en va autrement au sein même du monde de la vie. Celui-ci se définit au  contraire comme un monde a priori sans frontières : « il ne reçoit de frontières que lorsque celles-ci sont franchies et en tant qu’elles le sont » (2010 : 84). Ce qui de l’extérieur semble une frontière n’apparaît jamais à l’intérieur que comme l’horizon du monde de la vie, c’est-à-dire comme une ligne que l’on ne peut jamais rejoindre en fait puisqu’elle recule et se redéploie indéfiniment à mesure que l’on croit s’en approcher (1996 : 9). L’horizon est ainsi la ligne que l’on a toujours encore devant soi ; la frontière celle que l’on a toujours déjà franchie. Mais, selon Blumenberg, si l’on ne peut rejoindre l’horizon en traversant le monde de la vie qui s’avère à cet égard d’une extension indéfinie, l’on peut néanmoins l’arpenter par le regard rétrospectif de la théorie en faisant précisément abstraction de son environnement immédiat. Aussi l’ambition de Blumenberg dans son ouvrage sur La Passion selon saint Matthieu est-elle de restituer le contexte théologique qui entoure l’œuvre de Bach afin de retracer l’horizon de sens sur lequel elle se découpe pour l’auditeur d’alors et d’aujourd’hui. « L’horizon devient le fond devant lequel tout ce qui est au premier plan se détache et se “déroule” » (ib.). De même que toute présence se profile sur une absence qui lui donne sens, de même l’événement historique ne devient signifiant que par rapport à l’arrière-plan sur lequel il se découpe : il s’agit donc de « sauvegarder l’ouverture vers l’absent parce que – et dans la mesure où – celui-ci n’est jamais ce qui est tout à fait absent » (1996 : 10). Cette absence à laquelle l’effet de sens assure un semblant de présence n’est autre, semble-t-il, que celle du monde de la vie que nous n’avons donc jamais vraiment cessé de quitter. Car si le monde de la vie n’a pas de frontière, comment l’abandonnerait-on ? Mais si d’autre part, le théoricien se trouve bien en dehors de lui, faut-il supposer qu’il n’y a jamais vraiment vécu ? L’ambiguïté de cette délimitation conduit à interroger la réalité même de ce qu’elle délimite. En fait, si Blumenberg parle d’unité de sens d’une époque, il est aussi question chez lui de mondes de la vie préhistorique (initial), subhistorique (quotidien) ou posthistorique (final ou utopique) (1986 : 65). Le passage de la figure d’un monde de la vie initial à un monde de la vie final se comprend dans la mesure où la déconstruction du monde de la vie n’est jamais tout à fait achevée et sa restauration toujours encore en cours (1986 : 63) : les évidences initiales détruites par la science se renouvellent de telle sorte que l’on peut à la limite penser un monde de la vie final où tout serait redevenu évident. C’est d’ailleurs ce à quoi tend le processus de la technicisation selon Blumenberg : certes, par ses fondements théoriques et économiques, elle contribue au démantèlement de ce qui allait de soi ; mais dans la mesure où elle met à notre disposition des processus qui semblent toujours déjà prêts à être déclenchés et dont nous ne comprenons ni même n’interrogeons plus le fonctionnement, elle tend à la restitution d’une nouvelle sphère d’évidence. Car la sphère dans laquelle nous ne posons plus de questions se confond avec celle dans laquelle nous n’en posons pas encore, le monde de la vie (2010 : 211). C’est à cet égard encore que le monde de tous les jours, le monde subhistorique, peut être lui aussi considéré comme un monde de la vie (2010 : 55) : notre quotidien est saturé de régulations qui dispensent de prendre des décisions et se caractérise par le « défaut de contingence » (2010 : 46) de ses objets. On ne se demande pas tous les jours s’ils pourraient être autrement qu’ils ne sont. Le monde de la vie se distingue néanmoins du monde quotidien dans la mesure où il ne se caractérise pas par la moyenne, la normalité de ce qui y a cours, mais au contraire par la valeur extrême de l’évidence, par son passage à la limite – comme « concept-frontière ». Faut-il alors renoncer à un usage empirique du terme au profit de son usage transcendantal ?
contraire comme un monde a priori sans frontières : « il ne reçoit de frontières que lorsque celles-ci sont franchies et en tant qu’elles le sont » (2010 : 84). Ce qui de l’extérieur semble une frontière n’apparaît jamais à l’intérieur que comme l’horizon du monde de la vie, c’est-à-dire comme une ligne que l’on ne peut jamais rejoindre en fait puisqu’elle recule et se redéploie indéfiniment à mesure que l’on croit s’en approcher (1996 : 9). L’horizon est ainsi la ligne que l’on a toujours encore devant soi ; la frontière celle que l’on a toujours déjà franchie. Mais, selon Blumenberg, si l’on ne peut rejoindre l’horizon en traversant le monde de la vie qui s’avère à cet égard d’une extension indéfinie, l’on peut néanmoins l’arpenter par le regard rétrospectif de la théorie en faisant précisément abstraction de son environnement immédiat. Aussi l’ambition de Blumenberg dans son ouvrage sur La Passion selon saint Matthieu est-elle de restituer le contexte théologique qui entoure l’œuvre de Bach afin de retracer l’horizon de sens sur lequel elle se découpe pour l’auditeur d’alors et d’aujourd’hui. « L’horizon devient le fond devant lequel tout ce qui est au premier plan se détache et se “déroule” » (ib.). De même que toute présence se profile sur une absence qui lui donne sens, de même l’événement historique ne devient signifiant que par rapport à l’arrière-plan sur lequel il se découpe : il s’agit donc de « sauvegarder l’ouverture vers l’absent parce que – et dans la mesure où – celui-ci n’est jamais ce qui est tout à fait absent » (1996 : 10). Cette absence à laquelle l’effet de sens assure un semblant de présence n’est autre, semble-t-il, que celle du monde de la vie que nous n’avons donc jamais vraiment cessé de quitter. Car si le monde de la vie n’a pas de frontière, comment l’abandonnerait-on ? Mais si d’autre part, le théoricien se trouve bien en dehors de lui, faut-il supposer qu’il n’y a jamais vraiment vécu ? L’ambiguïté de cette délimitation conduit à interroger la réalité même de ce qu’elle délimite. En fait, si Blumenberg parle d’unité de sens d’une époque, il est aussi question chez lui de mondes de la vie préhistorique (initial), subhistorique (quotidien) ou posthistorique (final ou utopique) (1986 : 65). Le passage de la figure d’un monde de la vie initial à un monde de la vie final se comprend dans la mesure où la déconstruction du monde de la vie n’est jamais tout à fait achevée et sa restauration toujours encore en cours (1986 : 63) : les évidences initiales détruites par la science se renouvellent de telle sorte que l’on peut à la limite penser un monde de la vie final où tout serait redevenu évident. C’est d’ailleurs ce à quoi tend le processus de la technicisation selon Blumenberg : certes, par ses fondements théoriques et économiques, elle contribue au démantèlement de ce qui allait de soi ; mais dans la mesure où elle met à notre disposition des processus qui semblent toujours déjà prêts à être déclenchés et dont nous ne comprenons ni même n’interrogeons plus le fonctionnement, elle tend à la restitution d’une nouvelle sphère d’évidence. Car la sphère dans laquelle nous ne posons plus de questions se confond avec celle dans laquelle nous n’en posons pas encore, le monde de la vie (2010 : 211). C’est à cet égard encore que le monde de tous les jours, le monde subhistorique, peut être lui aussi considéré comme un monde de la vie (2010 : 55) : notre quotidien est saturé de régulations qui dispensent de prendre des décisions et se caractérise par le « défaut de contingence » (2010 : 46) de ses objets. On ne se demande pas tous les jours s’ils pourraient être autrement qu’ils ne sont. Le monde de la vie se distingue néanmoins du monde quotidien dans la mesure où il ne se caractérise pas par la moyenne, la normalité de ce qui y a cours, mais au contraire par la valeur extrême de l’évidence, par son passage à la limite – comme « concept-frontière ». Faut-il alors renoncer à un usage empirique du terme au profit de son usage transcendantal ?
II. Les frontières de l’homme
II.1. La phénoménologie husserlienne aux frontières de l’anthropologie
Dans Beschreibung des Menschen (2006 : 813), Blumenberg montre combien la thématique du monde de la vie aurait pu permettre à Husserl de surmonter l’« indifférence » de la phénoménologie envers l’anthropologie mais aussi pourquoi, faute de prendre en considération l’être vivant dont ce monde est monde, c’est-à-dire l’homme lui-même, elle a justement échoué à le faire (Monod : 2009).
Cela tient tout d’abord à la perspective téléologique adoptée par Husserl : si l’histoire tend à la réalisation de la science et si celle-ci consiste à rendre intelligible ce qui allait de soi, c’est-à-dire à dissoudre les vestiges de l’évidence du monde de la vie, alors celui-ci ne pouvait apparaître que comme la sphère de familiarité originelle, inquestionnée, préscientifique – cela même que la science doit justement achever de démanteler pour se réaliser. De ce point de vue positiviste hérité de Mach et Avenarius, le monde de la vie n’est que le terminus a quo qui justifie la finalité historique de la phénoménologie.
Cela tient ensuite au concept formel avec lequel Husserl cherche à décrire le monde de la vie tout en faisant abstraction de l’homme. D’une part, ce formalisme conduit Husserl à une hésitation quant au statut « protologique » ou « hypologique » du monde de la vie : est-il une sorte de préhistoire de la conscience préthéorique de l’humanité, ou bien plutôt la substructure quotidienne des évidences prédonnées qui persistent pour chaque individu ou chaque communauté au sein d’une réalité mouvante ? Le seul moyen de figer cette oscillation entre « prémonde » et « inframonde », avance Blumenberg, est d’unifier ces options dans une détermination formelle du monde de la vie comme « tout ce qui, en tant que cela nous est évident, reste sous le seuil de l’attention ou sombre en-dessous » (2008 : 815). Mais, d’autre part, l’absence de détermination anthropologique de la sortie hors du monde de la vie entraîne Husserl à recourir à une interprétation volontariste de l’adoption de l’« attitude théorétique ». Cette décision, en tant qu’« institution originaire », engagerait à sa suite tout le sens de l’histoire de l’humanité européenne comme réalisation de la science, et condamnerait par conséquent l’homme à n’être jamais que le fonctionnaire de cette tâche infinie qu’est la science sans lui permettre d’en jouir lui-même en tant que sujet mondain.
Plus fondamentalement, la critique de Blumenberg porte sur l’étroitesse de l’intérêt que Husserl porte à la thématique du monde de la vie dans la mesure où il se concentre sur sa frontière et son franchissement sans vraiment prendre en compte son horizontalité. Plus précisément, l’intérêt de Husserl porte sur la rupture de la cohésion du monde de la vie, c’est-à-dire sur les processus de déception, de biffure, de réserve ou de modification attentionnelle qu’entraîne le surgissement d’événements aux marges du monde de la vie. Cette focale répond au double impératif programmatique de la génétisation et méthodique de la variation libre, car l’irruption de la modalisation au sein du monde de la vie légitime la méthode de la variation libre : celle-ci en représente comme l’étape ultime puisqu’elle consiste à soustraire au hasard le jeu des possibilités et à conserver un noyau de familiarité comme l’invariant de tout processus factuel. Or la mise en avant de la méthode de la variation libre semble motiver l’exclusion de toute considération anthropologique : le déploiement de ce jeu des possibles suppose une conscience pure, c’est-à-dire purifiée par la réduction, une conscience qui, se réfléchissant, trouve dans le cogito le point archimédien de la certitude de soi, se déduit à partir d’elle-même, se transcende, s’avère transcendantale – une conscience qui ne soit plus humaine. Mais, objecte Blumenberg, si ce passage au transcendantal repose sur une telle réflexion de la conscience, comment rendre compte de la réflexion elle-même sans prendre en considération la condition de l’homme pour qui la réflexion n’a justement rien d’évident ?
II.2. Du tournant génétique à l’anthropogenèse : genèse et paradigme du monde de la vie
Le tournant génétique de la phénoménologie aurait dû mener Husserl à franchir les frontières de l’anthropologie. C’est donc en toute conséquence que Blumenberg poursuit ce geste de génétisation du thème du monde de la vie jusqu’aux confins de ses spéculations anthropogénétiques. Le thème du franchissement de la frontière est là aussi prépondérant. Blumenberg interprète en effet l’évolution du vivant en fonction de l’événement originaire et décisif de son expulsion traumatique hors du biotope marin – hors de ce milieu fluide et constant qui le préservait par exemple des contraintes de la pesanteur et de la succession temporelle du jour et de la nuit, auxquelles il finit par être exposé sur la terre ferme. L’évolution du vivant suivrait dès lors une « tendance à la restauration des conditions intra-marines de la vie facile et protégée dans un milieu homogène » (1988 : 22). Cette hypothèse rend compte d’une part d’innovations organiques telles que l’homéothermie ou la grossesse intra-utérine, cette « miniaturisation de la mer » (1988 : 23), et d’autre part de la succession des milieux de vie de l’hominidé (sinon de leur réinvestissement successif) : la forêt lui aurait offert un abri tridimensionnel relativement homogène et protecteur en guise de substitut à la mer, mais un bouleversement quelconque (peut-être climatique) a pu le contraindre à quitter ce mode de vie arboricole pour s’aventurer dans la savane où, se redressant afin d’élargir l’horizon de sa perception, il se serait en retour retrouvé exposé à un menaçant surcroît de visibilité qui l’aurait poussé à rechercher derechef un refuge de substitution dans la caverne où l’horizon des possibles est plus restreint.
Ce paradigme ternaire (milieu initial – franchissement traumatique d’une frontière – milieu de substitution) rend compte de l’émergence de la conscience comme d’un substitut à l’absence de tout milieu auquel l’homme serait biologiquement adapté. La conscience protège l’homme, grâce à une série de médiations, d’un débordement sensoriel non-spécifique, de l’angoisse des possibles qui surgissent de toute part, de « l’absolutisme du réel ». Ces médiations composent un système de régulations qui permettent à la conscience de se préserver de l’inconnu qui point à l’horizon et qui menace de la perturber. Parmi les mécanismes de ce que Blumenberg nomme l’« intégration implicative » (2010 : 139) qui consiste à intégrer l’inconnu au sein de la sphère du déjà connu ou du familier, figurent notamment le nom, qui permet d’identifier l’objet de l’angoisse et de la transformer en peur ; le mythe, qui distribue cette puissance d’effroi entre plusieurs instances pour la neutraliser et qui aménage à l’homme, via les rituels et la magie, des moyens d’intervention dans le cours du monde (i.e. au-delà des frontières du monde de la vie (2010 : 136)) ; la métaphore, cette « technique du trafic frontalier » (2010 : 137) sur laquelle repose le fonctionnement du mythe et, au fond, l’ensemble de ce processus qui consiste à rapporter l’inconnu au connu ; le concept, qui permet de saisir ce qui est absent et prend ainsi, lorsqu’il le peut, la relève de la saisie métaphorique ; enfin la théorie elle-même qui est comme le dernier jalon de ce processus dont elle permet précisément de rendre compte – ainsi que l’atteste le corpus de Blumenberg qui enveloppe l’ensemble de ce processus dont la théorie du monde de la vie fournit comme le fil directeur. La somme de ces médiations de la conscience, que l’on peut aussi nommer des institutions symboliques, constitue ainsi la culture, de sorte que le monde de la culture naît du et comme détour du monde de la vie par lequel l’homme appréhende le réel.
Ce paradigme explique en outre la « tendance à l’évidence » qui, selon Blumenberg, caractérise le monde de la vie (2010 : 65) : il s’agit moins de l’inertie d’une sphère d’évidence prédonnée que de la « tendance à la restauration » de celle-ci, dans la mesure où, en raison de son fonctionnement intentionnel, la conscience ne coïncide jamais avec elle-même mais a toujours déjà quitté cet état liminaire qu’elle cherche à regagner. Ce détour par l’anthropogenèse de Blumenberg indique donc la nature ternaire de sa thématisation du monde de la vie en soulignant sa tendance au rattrapage de l’évidence. C’est le paradoxe même de la phénoménologie qui prétend dissoudre l’évidence en intelligibilité, transformer la Selbstverständlichkeit en Selbstverständigung, mais exige ce faisant de fonder à nouveau le concept sur l’intuition et donc sur l’évidence (Evidenz). Mais c’est aussi tout l’enjeu de la discussion théologique de la Création que livre Blumenberg au début de La Passion selon saint Matthieu, au cours de laquelle le paradigme du monde de la vie semble implicitement à l’œuvre pour expliquer comment l’on passe d’un état initial caractérisé par la toute-puissance divine à un monde caractérisé par la finitude : c’est en quelque sorte l’hyper-modalité de la toute-puissance qui suscite son « ennui », c’est-à-dire son incompatibilité avec elle-même, et la pousse à franchir la frontière du réel ; mais comme par définition, dans le monde fini où elle se met en jeu, la toute-puissance ne donne jamais assez d’elle-même, elle se trouve contrainte de surenchérir par le « rattrapage » que représente la Passion – c’est-à-dire le Verbe qui se fait chair pour connaître la souffrance humaine et rattraper la finitude par excellence. La Passion signe ainsi, selon Blumenberg, l’échec de la Création. De la même façon, l’abandon du monde de la vie par la poussée du possible et la perte de l’évidence suscite un phénomène de compensation, de rattrapage voire de restauration dont même la phénoménologie de Husserl prétend participer : tout comme la toute-puissance surenchérit sa mise pour rattraper la finitude, c’est par un surcroît de science que la phénoménologie tardive de Husserl prétend, par un questionnement en retour, rattraper le sens manqué par la modernité scientifique depuis Galilée. Dans les deux cas, le rattrapage – le salut ou la thérapie – passe donc par une répétition de la genèse, un rattrapage de l’histoire, la présence du logos.
II.3. Franchissement de la limite du monde de la vie
En quoi le recul de la frontière de la phénoménologie jusque dans l’anthropogenèse permet-il d’expliquer le franchissement des limites du monde de la vie ? Comment comprendre ce passage d’un en-deçà de l’horizon à un au-delà de la frontière ? Blumenberg souscrit aux analyses de la logique génétique husserlienne sur les phénomènes originaires de la négation et de la modalisation dont la présence au sein du monde de la vie signifie déjà sa désintégration : considérer qu’un autre monde eût été possible, se demander pourquoi il en est ainsi et non pas autrement, c’est déjà s’exposer au « déficit du sens » (2010 : 54) et à l’expérience de la contingence. Mais Blumenberg s’oppose à Husserl en ce que, pour lui, il est bien plus simple de décrire l’expérience antéprédicative de la négation que les conditions antéprédicatives de la position – de l’existence – dans la mesure où « la négation est quelque chose comme la valeur limite de la performance du concept » (1986 : 47) : le concept permet de saisir ce qui n’est pas là, ce qui est absent, tandis que la négation permet de prédiquer ce qui n’est pas du tout. À cet égard, elle est nécessaire pour faire l’expérience de la frontière en tant que telle, de la pénurie et de la mort, du fait que tout n’est pas disponible à tout jamais, bref, pour concevoir la contingence (1986 : 37). Blumenberg recule donc encore la frontière de l’enquête génétique en la faisant désormais porter sur la genèse anthropologique du concept lui-même, comme instrument de l’actio per distans de l’homme, puis sur le soubassement métaphorique de la conceptualité. Mais pourquoi l’homme cherche-t-il à saisir l’absent ? D’où cette curiosité envers ce qu’il ne perçoit pas immédiatement lui provient-elle ? Précisément du fait qu’il n’est pas adapté à la réalité mais se trouve cerné, au-delà du monde de la vie où rien ne fait problème puisque tout va de soi, par un horizon chargé d’inconnu voire de menaces dont l’illimitation suscite l’angoisse. C’est donc pour répondre à un impératif d’« autoconservation » que l’homme cherche à réduire son degré d’exposition à la surprise en franchissant, en pensée ou en acte, cet horizon d’inconnu, c’est-à-dire en adoptant une « attitude préventive » que l’on nomme la curiosité (2010 : 54) et qui permet d’effectuer comme des frappes préventives contre l’inconnu avant qu’il ne pénètre le monde de la vie. « La constitution préventive de l’homme se trouve en lien avec l’inconstance de l’horizon de son monde de la vie » (2010 : 136). Par ailleurs, lorsque l’inconnu est intégré dans le cadre familier du monde de la vie, celui-ci désamorce certes la menace mais n’en est pas moins déstabilisé par l’inconnu qu’il accueille, de sorte qu’avec le temps le monde de la vie admet un besoin d’explication et doit développer de nouveaux procédés (négation, modalisation, justification, rationalisation, explication, théorisation, systématisation, etc.). L’application du principe d’autoconservation au sein du monde de la vie signifie alors sa tendance à l’autodestruction, puisqu’il finit par devoir être défendu par les procédés mêmes qui le minent. Il n’y a là rien d’étonnant si l’on ramène cette tendance qu’a le monde de la vie à s’autodétruire au principe même de la vie qui, selon Blumenberg, mine ses propres conditions de possibilité dans la mesure où elle est toute « expansion » (1997 : 79). Au niveau organique, la vie se définit par sa double tendance à l’exigence et au renoncement (elle prétend à une croissance sans limite, mais doit renoncer à le faire sous la forme d’un seul organisme unicellulaire et même d’une seule espèce sous peine de se mettre en péril sa survie) ; ce principe persiste au niveau de la conscience comme intentionnalité dans la mesure où la raison ne peut prétendre atteindre quelque chose du monde qu’en renonçant à atteindre la totalité de ce monde – ou, en d’autres termes : « l’extinction de l’intuition au profit du concept est la loi de constitution de toute expansion par l’expérience » (1997 : 98). La conscience intentionnelle consent à ce renoncement, à son auto-réduction, afin de dépasser l’impression originaire, de franchir les frontières de la présence effective et d’atteindre le domaine de l’absent et du possible.
Mais si l’on poursuit ce mouvement de régression du seuil liminal du monde de la vie, il faut encore se demander comment l’homme prend conscience de sa vulnérabilité face à l’inconnu du monde. C’est là substituer au passage husserlien par le sujet transcendantal une réflexion sur la finitude de l’homme qui prend pour point de départ le phénomène du temps, et ce pour plusieurs raisons : parce que la structure du temps forme la sphère la plus primitive de la passivité, parce que le concept de phénomène du temps permet de dépasser les « frontières du platonisme initial et endogène de la phénoménologie » (1986 : 26) – c’est-à-dire de gagner en réalisme descriptif – et parce que la finité de notre temps de vie détermine d’autres processus qui rendent compte de la sortie hors du monde de la vie, tels que la modification attentionnelle en jeu dans l’intentionnalité, ou encore la délégation qui n’a de sens qu’en tant que l’homme n’a pas le temps de faire tout ce qu’il voudrait ou devrait faire (2010 : 153). Car le monde de la vie ne tombe pas seulement sous les coups de l’extérieur et de l’inconnu ; il se désintègre également de l’intérieur au fur et à mesure que se phénoménalise le temps. Le temps ne surgit pas sur l’horizon du monde de la vie mais se révèle progressivement en son sein jusqu’à ce qu’on le reconnaisse comme toujours déjà donné, comme toujours déjà vécu – jusqu’à ce que l’homme, au fond, remarque l’abîme de disproportion entre la durée de sa vie et le temps du monde dont il n’est aucunement la mesure. Cette « ouverture des ciseaux du temps », selon l’image de Blumenberg (1986 : 87), correspond à ce que la logique génétique décrit comme l’émergence de la modalisation et par conséquent à l’émergence de la contingence. En elle, l’homme prend conscience de sa finitude, de l’insignifiance de sa vie qui ne représente qu’un instant parmi tous les instants cosmiques. Si ce malaise se transforme en pathologie dont le symptôme socio-économique contemporain est l’empressement à gagner du temps, à accélérer les échanges, à tirer profit de sa vie (1986 : 27), la seule « consolation » que peut envisager l’homme face à l’indifférence du monde à son égard consiste à chercher à laisser une trace dans la memoria des hommes, c’est-à-dire dans l’histoire, car elle fonctionne à la fois comme « rétention intersubjective du temps de la vie » (1986 : 301) et comme « “culture” de la protention » (1986 : 303) qui permet à un souvenir de moi de perdurer au-delà de la durée de ma vie en entamant, un tant soit peu, le temps du monde.
Conclusion
Le concept de monde de la vie a donc bel et bien un usage empirique lorsqu’il se rapporte à l’histoire. Mais il ne désigne pas l’environnement naturel, puisqu’il naît justement de l’inadaptation de l’homme à quelque milieu spécifique que ce soit et que l’homme ne peut à proprement parler vivre dans ce monde de la vie qui ne cesse de se reconfigurer. C’est pourquoi, aussi fort qu’elle le désire, « c’est un mythe que de croire que la conscience puisse jamais totalement coïncider avec elle-même » (1996 : 155). Le monde de la vie est un « concept-frontière (Grenzbegriff) » au double sens de concept qui cherche à saisir le seuil entre un horizon et une frontière, et de concept transcendantal (2010 : 79) lui-même composé de deux idées-limites (Limesideen) et à ce titre inaccessible autant à l’empirie qu’à la réflexion. Il indique la valeur limite de la fonction d’évidence de la conscience si elle tendait à être en accord avec elle-même, ce que dément en fait son activité intentionnelle. En ce sens, il n’est ni une fiction ni une simple hypothèse, mais une nécessité de la théorie pour répondre au besoin de réalisme né justement de la perte du monde de la vie, ou du moins de l’instabilité de ce status naturalis de la conscience. On peut bien n’avoir jamais vécu dans cet état incapable de perdurer, le monde de la vie n’en est pas moins un réquisit de la réflexion sur la vie de la conscience dont il représente au fond le fil si ténu qu’il échappe aux ciseaux du temps. Enfin, pour éviter la confusion entre l’usage transcendantal et l’usage empirique de ce concept, Blumenberg précise qu’il ne parle de mondes de la vie historiques ou culturels qu’en un sens dérivé, comme de mondes de la vie de second degré par rapport au monde de la vie transcendantal (1986 : 86). Tout l’enjeu est alors de savoir comment ces contingences historiques se déploient à partir de cette nécessité théorétique. Blumenberg recourt à l’analogie du « trou noir » (2010 : 54) pour souligner combien le monde de la vie est empiriquement absurde, dans la mesure où il nie toutes les conditions de l’expérience possible, mais s’avère indispensable pour comprendre ce qui l’entoure et tend vers lui – vers sa singularité.
Bibliographie
BLUMENBERG Hans, Die ontologische Distanz. Eine Untersuchung über die Krisis der Phänomenologie Husserls, Université de Kiel, 1950 (thèse d’habilitation, édition à paraître en 2022).
–, « Paradigmen zu einer Metaphorologie » in (dir. Erich Rothacker) Archiv für Begriffsgeschichte, 6, 1960, pp. 7-142. Paradigmes pour une métaphorologie (tr. fr. D. Gammelin), Paris, Vrin, 2006.
–, Die Legitimität der Neuzeit, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1966. La Légitimité des Temps modernes (tr. fr. M. Sagnol, J.-L. Schlegel, D. Trierweiler), Paris, Gallimard, 1999.
–, Lebenszeit und Weltzeit, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1986.
–, Höhlenausgänge, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1988.
–, Matthäuspassion, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1988. La Passion selon saint Matthieu (tr. fr. H.-A. Baatsch, L. Cassagnau), Paris, L’Arche, 1988.
–, Die Vollzählichkeit der Sterne, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1997.
–, Beschreibung des Menschen, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2006. Description de l’homme (tr. fr. D. Trierweiler), Paris, Le Cerf, 2011.
– (éd. A. Haverkamp), Theorie der Unbegrifflichkeit, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2007. Théorie de l’inconceptualité (tr. fr. M. de Launay), Paris, Éditions de l’Éclat, 2017.
– (éd. M. Sommer), Theorie der Lebenswelt, Berlin, Suhrkamp, 2010.
– (éd. N. Zambon), Phänomenologische Schriften (1981-1988), Berlin, Suhrkamp, 2018.
– (éd. N. Zambon), Realität und Realismus, Berlin, Suhrkamp, 2020.
HUSSERL Edmund (éd. L. Landgrebe), Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik, Hambourg, Glaassen & Goverts, 1948. Expérience et Jugement. Recherches en vue d’une généalogie de la logique (tr. fr. D. Souche), Paris, PUF, 1970.
– (éd. W. Biemel), Husserliana VI. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie.Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie (1935-1937), La Haye, Martinus Nijhoff, 1954. La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale (tr. fr. G. Granel), Paris, Gallimard, 1976.
–, (éd. R. N. Smid), Husserliana XXIX. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Ergänzungsband. Texte aus dem Nachlass (1934-1937), Dordrecht/Boston/Londres, Kluwer, 1993.
–, (éd. R. Sowa), Husserliana XXXIX. Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution. Texte aus dem Nachlass (1916–1937), Dordrecht, Springer, 2008.
MERKER Barbara, « Bedürfnis nach Bedeutsamkeit. Zwischen Lebenswelt und Absolutismus der Wirklichkeit », in F. W. Wetz, H. Timm (éd.), Die Kunst des Überlebens. Nachdenken über Hans Blumenberg, Francfort/M., Suhrkamp, 1999, pp. 68-98.
MONOD Jean-Claude, « “L’interdit anthropologique” chez Husserl et Heidegger et sa transgression par Blumenberg », Revue germanique internationale,