La construction médiatique de l’aura comme enjeu philosophique de la série de télévision (I)
Olivier AÏM (CELSA-Paris-Sorbonne)
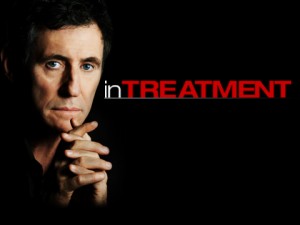 En ce qui concerne la théorie de la série télévisée, les derniers travaux qui portent sur cet objet ne laissent pas d’insister sur la dimension « transmédiatique » de son fonctionnement communicationnel. Comme nombre d’objets médiatiques, la série gagne en effet à être appréhendée en fonction de multiples circulations, hybridités et complémentarités. Que ce soit sous forme de commentaire (forums), de diffusion pirate des contenus encore non licenciés ni distribués en France (notamment par le sous-titrage bénévole amateur par les fans eux-mêmes – dit « fansubbing »), de prolongement diégétique sur le web (webséries, fanfictions, « transfictionnalité ») ou encore de promotion (teasers, annonces, etc.), la série constitue un de ces objets culturels et créatifs sans doute les plus emblématiques d’une évolution des regards au sens large. Et ce, d’un point de vue socioculturel, d’une part, à travers une légitimation progressive des pratiques, des regards, des acceptations ; d’un point de vue métaculturel, d’autre part, en fonction d’une prise en compte théorique qui ne cesse de souligner les inventions et les réinventions d’une forme en prise avec les transformations les plus actuelles : du roman-feuilleton aux formes transmédiatiques. Pour ces diverses raisons, la série de télévision constitue l’un des objets par excellence de ce que l’on pourrait appeler le cultural turn, c’est-à-dire la prise en compte des objets culturels selon une réhabilitation générale de la catégorie « culture populaire » et une réorganisation des regards en fonction des pratiques, des genres, des enjeux politiques et socio-expressifs.
En ce qui concerne la théorie de la série télévisée, les derniers travaux qui portent sur cet objet ne laissent pas d’insister sur la dimension « transmédiatique » de son fonctionnement communicationnel. Comme nombre d’objets médiatiques, la série gagne en effet à être appréhendée en fonction de multiples circulations, hybridités et complémentarités. Que ce soit sous forme de commentaire (forums), de diffusion pirate des contenus encore non licenciés ni distribués en France (notamment par le sous-titrage bénévole amateur par les fans eux-mêmes – dit « fansubbing »), de prolongement diégétique sur le web (webséries, fanfictions, « transfictionnalité ») ou encore de promotion (teasers, annonces, etc.), la série constitue un de ces objets culturels et créatifs sans doute les plus emblématiques d’une évolution des regards au sens large. Et ce, d’un point de vue socioculturel, d’une part, à travers une légitimation progressive des pratiques, des regards, des acceptations ; d’un point de vue métaculturel, d’autre part, en fonction d’une prise en compte théorique qui ne cesse de souligner les inventions et les réinventions d’une forme en prise avec les transformations les plus actuelles : du roman-feuilleton aux formes transmédiatiques. Pour ces diverses raisons, la série de télévision constitue l’un des objets par excellence de ce que l’on pourrait appeler le cultural turn, c’est-à-dire la prise en compte des objets culturels selon une réhabilitation générale de la catégorie « culture populaire » et une réorganisation des regards en fonction des pratiques, des genres, des enjeux politiques et socio-expressifs.
Bien que ces approches soient riches et largement étayées par l’observation sémiologique et sociologique des médias concernés par la sérialité, nous voudrions prendre un parti quelque peu différent de ces approches pour plaider en faveur d’un return télévisuel, si l’on peut dire. Il nous semble en effet que face à ces phénomènes massifs d’hybridation, les mouvements récents de la télévision se définissent par une hypothèse alternative de ce que nous voudrions nommer un « repli médiagénique[1] ». S’il est incontestable que les pratiques et les usages montrent une forte tendance à la constitution d’un nouveau paradigme, que l’on peut désigner par l’appellation d’« industries créatives », il reste que chacun des médias existants peut être observé en fonction d’un regard plus traditionnellement attaché à la catégorie des « industries culturelles ». Loin de verser dans quelque nostalgie, crispation ou même « effet rétro », nous posons au contraire l’hypothèse que les médias connaissent des évolutions non seulement marquées par l’hybridité, mais encore travaillées par des logiques parallèles, sinon adverses, de « re-médiation »[2].
Depuis le roman feuilleton et la dérive annoncée par un Sainte-Beuve, par exemple, d’une littérature devenue « industrielle », la forme « série » permet de sonder les états d’une écriture populaire de la culture[3]. Or, il semble qu’à l’heure de la reproductibilité numérique, du téléchargement et de la « contribution » annoncée comme forme à venir d’une nouvelle Culture, l’empirie des nouvelles séries internationales tend à envisager un mouvement de réactivation des régimes et des ressources télévisuels, suivant lesquels il devient tout de même très difficile de tenir encore la télévision comme morte, si ce n’est comme agonisante[4]. Et s’il est un horizon qui le montre de manière privilégié, c’est bien l’horizon de l’expérience sérielle que nous voudrions concevoir ici dans une approche philosophique.
L’actualité des forces sémio-médiatiques en présence, ne cesse de réaffirmer, selon nous, la pertinence d’une conceptualisation de la modernité théorique relativement à l’empirie heuristique de la Kulturindustrie. La question culturelle au fond qui nous intéresse est en apparence d’ordre oxymorique : en quoi consiste l’aura de la série de télévision ?
Mue par un apparent paradoxe, la postulation auratique de la série de télévision repose sur une lecture à nouveaux frais de la théorie benjaminienne à travers quatre lieux notionnels : l’aura, la trace, le regard et la parole récitante. Et de noter pour commencer que l’aura n’est pas seulement indexée au degré de l’expérience mais réside aussi dans le jeu entre l’unicité de l’expérience et la multiplicité des rémanences de l’inter-épisode, autrement dit dans le mode d’« aperception », comme dit Benjamin, de l’œuvre.
Notre hypothèse serait ainsi que nous avons affaire avec la série télévisée à une double écriture de la durée, celle de l’aura de l’expérience, d’un côté, et celle de la trace de l’inter-expérience, de l’autre. En cela se justifie l’importance de la prise en compte des phénomènes de traduction temporelle et durative qui permettent de voir à la fois la construction globale d’une esthétique généralisée et la multiplicité des dispositifs de son importation glocalisée[5]. Encore convient-il de prendre ici le terme dispositif dans un sens renforcé par ses coordonnées esthétiques de mise en relation et en disponibilité des produits de consommation culturelle.
Le « repli médiagénique » de la télévision : une question de regard et de temporalité
Ce que nous avons eu l’occasion de désigner ailleurs[6] comme un « repli médiagénique » de la télévision désigne un ensemble d’observations qui se sont fixées selon nous au tournant de l’an 2000 avec l’avènement de la télé-réalité. On a évidemment beaucoup glosé le contenu de ces émissions au premier rang desquelles Big Brother faisait figure de proue. Mais au-delà des combats axiologiques, c’est surtout la question optique et temporelle qui permettait d’y voir un peu clair dans l’événement que cet avènement signait. Il serait bien entendu hors de propos ici de consacrer de trop longs développements au modèle « panoptique » de Big Brother, mais disons deux choses pour poser un décor télévisuel plus large. D’une part, à l’heure où Internet s’imposait comme un nouvel espace public et médiatique – annoncé comme dominant – la télévision revenait à ses fondamentaux : la mise en observation d’individus (corps et visages) dans un « dispositif »[7] destiné à les capter, les stimuler, les surveiller et les interpréter. D’autre part, ce dispositif spatial se doublait d’une réorganisation temporelle de la télévision comme média spécifique : une triple temporalité, en fait, composée d’un flux de captation visuelle en continu, d’un flux d’émissions quotidiennes et d’un flux d’émissions hebdomadaires au terme duquel était désigné le vainqueur du jeu mis en scène.
Il nous semble, et c’est là l’hypothèse essentielle de cet article, que la série de télévision actuelle produise un même effet de remédiation symbolique, en passant notamment par un retour à cette aura temporelle de la diffusion et de la programmation télévisuelles.
On pourrait commencer par dire que l’énonciation de la série de télévision n’est faite que de rapports au temps, à la durée et à la rythmie. Certes, les séries sont construites autour de personnages, d’histoires, d’intrigues, de péripéties et de « cliffhangers ». Mais toute cette narrativité ne renvoie elle-même qu’à un immense arc de temporalités. Si, par essence, le récit est lié au temps[8], à une mise en intrigue qui articule une préfiguration, une configuration et une refiguration[9], le récit sériel redouble à l’envi cette mise en intrigue temporelle relativement à son propre medium. Que ce soit la presse, le cinéma, le web ou la télévision, le support d’inscription de la sérialité définit une rythmie, une « idiorrythmie » comme dirait Roland Barthes[10]. Ce comment vivre ensemble gagnerait, en effet, à être pensé en termes médiatiques. La télégénie pourrait ainsi être lue comme un regarder ensemble[11], qui porterait avant tout sur la recherche d’une bonne rythmie.
Prise comme récit canonique, la série de télévision repose d’abord sur la répétition[12], de type formulaire, feuilletonnesque ou mêlée. Héritier de l’art oratoire et de l’esthétique orale (le motif, le canon, la variation, la poésie orale ou, plus profondément encore, la transe), l’aspect itératif de la série combine les rythmes proprement télévisuels : journaliers, circadiens, hebdomadaires, saisonniers, etc. Ces temporalités nourrissent des phénoménologies, des imaginaires et des prédilections : le soap opera est plutôt journalier, quand la série stricto sensu est plutôt hebdomadaire. Hégémonique, le schéma américain tend à fixer ces rythmes.
Dans tous les cas, la phénoménologie fondatrice de la programmation sérielle repose sur la périodicité, l’éternel retour du rendez-vous attendu et incorporé qui définit une anthropologie mêlée du rituel (le même) et du mythe (le différent), pour reprendre les catégories de Mihai Coman[13]. Plus fondamentalement, la « saison » américaine d’une série typique est anthropologiquement soumise à une autre idiorrythmie, celle du calendrier : commençant à l’automne, la série prototypique est censée suivre le rythme intime du temps du spectateur, celui de l’année civile si l’on peut ainsi parler. De sorte qu’une saison classique contiendra un épisode tourné pour Thanksgiving, un épisode tourné pour Noël, etc. Le temps existentiel du téléspectateur se trouve ainsi en synchronie avec le temps de la diégèse et des personnages. Une série récente comme FlashForward (ABC, 2009-2010) ou très récente comme Touch (FOX, 2012) ne font qu’accentuer cet effet d’isochronie, nous y reviendrons dans la suite de l’article.
L’aura de la série-de-télévision
Il s’ensuit que toutes les implications temporelles et duratives de la réception de la série moderne désignent un téléspectateur idéal, le téléspectateur américain qui consomme le programme dans le triple temps de sa diffusion, de sa saisonnalité et de son élaboration. Ce téléspectateur est en quelque sorte institué comme l’étalon esthétique, le consommateur « idéal », identifiable comme une centralité pour la diffusion de l’aura.
Pour reprendre les termes de Lotman[14], on pourrait dire que la scène globale est ainsi reliée à différentes périphéries temporelles, largement définies par ses temps de réactions traductives. L’aura est aussi une question de cercles et de diffusions concentriques. L’aura a une valeur largement centripète qui relègue la narration à une double temporalité selon qu’elle se définit par une appréhension englobante ou englobée. Pour le comprendre, c’est tout autant le Walter Benjamin du Conteur et de sur quelques thèmes baudelairiens que celui de L’œuvre d’art à l’époque de la reproductibilité technique qu’il faut lire ici. Ce que montre en effet le texte de Benjamin sur la narration, c’est qu’elle ressortit fondamentalement à une « parole » qui perd de son aura dès lors qu’elle n’est plus directe :
Celui qui écoute une histoire se trouve en compagnie du conteur ; même celui qui la lit partage cette compagnie. Le lecteur de roman, lui, est solitaire. Il l’est plus que tout autre lecteur. […] Dans cette solitude, le lecteur de roman s’empare plus jalousement que personne de la matière qui lui est offerte. Il est prêt à se l’approprier tout entière et, en quelque sorte, à l’engloutir.
Tendu vers la parole, le récit sériel de télévision tend à renouer avec une valeur « cultuelle » de récit partagé, collectif, au sens où le conte permet une récitation en situation, in praesentia, face à des regards, fussent-ils silencieux.
Ces regards fonctionnent comme des réponses à une narration parlée. L’aura est ainsi définie par Walter Benjamin comme cette capacité de réponse :
le regard est habité par l’attente d’une réponse de celui auquel il s’offre. Que cette attente reçoive une réponse, l’expérience de l’aura connaît alors sa plénitude. […] L’expérience de l’aura repose donc sur le transfert, au niveau des rapports entre l’inanimé – ou la nature – et l’homme, d’une forme de réaction courante dans la société humaine. Dès qu’on est – ou se croit – regardé, on lève les yeux. Sentir l’aura d’un phénomène, c’est lui conférer le pouvoir de lever les yeux[15].
L’aura de la série télévisée a partie liée avec la constitution d’un regard sur des images et d’une réponse à ce regard. Être regardé par l’émission d’images nécessite à la fois le hic et nunc d’une réception collective et la conscience de cette réception comme un échange optique in praesentia qui devient, in absentia, une parole. Moyennant quoi, notre hypothèse adjacente sur la série-de-télévision serait même plus précise. Elle tend à considérer que cette parole est le plus souvent explicite ou redoublée au sein des contenus et des histoires qu’elle porte.
Si la série constitue un récit de parole, il faut, en effet, entendre cette dernière expression au double sens d’un récit sur la parole et d’un récit qui renvoie à une situation abstraite de parole. Si les sitcoms renvoient au genre de l’humour (de la blague à la vanne), si les soap opera oscillent entre l’opérette et le commérage (le gossip), si le feuilleton renvoie à la « chronique » souvent historique, la série ressortit à une « inter-artialité » plus complexe qui renvoie au théâtre, à la « dramatique » radiophonique et au conte. On ne serait pas ainsi étonné de constater alors que les séries qui s’inscrivent le plus fortement dans l’écriture de l’aura, procèdent d’une situation de parole fortement marquée : l’analyse (talking cure) pour In treatment ou la prophétie pour FlashForward. De manière encore plus longitudinale dans l’histoire des séries, nous pourrions envisager Twin Peaks (1990-1991), Six feet under (HBO, 2001-2005), Oz (HBO, 1997-2003), Deadwood (HBO, 2004-2006) ou encore Boardwalk Empire (HBO, 2010-), par exemple, comme des séries fortement théâtralisées de la mise en spectacle de la parole et de la voix sous toutes leurs formes possibles (voix off du coryphée – parfois lui-même mort comme dans Desperate Housewives (ABC, 2004-2012) –, chœur, soliloque, aparté, faux dialogue, langage de sourds, etc.).
Pour résumer, disons que l’aura de la série constitue donc une expérience d’absorption et non d’immersion collective d’une parole inscrite dans un hic et nunc idiorrythmique, défini par la durée de sa diffusion et l’inter-durée de sa programmation.
De sorte que cette aura sera d’autant plus forte et son sentiment renforcé, que l’intensité de l’échange sera temporellement transmuée en durée et en expérience de la durée.
L’aura et le sentiment de durée de la série moderne
Nous prendrons quatre exemples pour illustrer cette tendance qui nous semble importante pour comprendre à la fois l’actualité de la série-de-télévision et, par effet de retour, ses spécificités symboliques. Pour les présenter, nous respecterons leur ordre d’apparition sur les chaînes américaines : 24 (FOX, 2001-2010), In treatment (HBO, 2008-2011), FlashForward (ABC, 2009-2010) et Touch (FOX, 2012).
24 : une parole auratique versus une consommation « expositive »
Série emblématique d’un renouveau de type éditorial, la série 24 a connu une première saison tonitruante et a été suivie par huit saisons. Son dispositif est bien connu, qui s’inscrit dans une parfaite illusion circadienne, puisque la série mime la temporalité d’une journée de vingt-quatre heures. Une saison classique de série américaine comporte en effet environ vingt-quatre épisodes. La diégèse est ainsi censée s’aligner sur ce modèle temporel fondamental d’un point de vue phénoménologique, l’unité de la journée. C’est pourquoi d’ailleurs l’un des visionnages possibles de cette série consiste à attendre la fin de sa diffusion périodique pour reconstituer à l’aide d’un enregistrement (légal ou non), la « journée » fictionnelle de la série. A regarder plusieurs épisodes à la suite, voire en regardant les vingt-quatre épisodes à la file, l’impression est ainsi formée pour un public généralement collectif de vivre la journée diégétique.
Bien évidemment, cette lecture reste une fiction. D’un point de vue purement structural, la série, étant diffusée sur un network américain, est entrecoupée de plusieurs pauses publicitaires qui trouent en quelque sorte l’heure de diffusion – et non de fiction – de chacun des épisodes. Il s’ensuit que le chronomètre qui suivrait le défilé des vingt-quatre épisodes s’arrêterait à dix-huit heures en réalité de narration. Le conflit entre perception et fiction de perception est alors patent à travers la simple mesure chronométrique.
Mais nous n’aurions là qu’un aspect de la fiction d’isochronie. Chaque épisode étant construit à la fois comme une unité et comme un élément d’un tout, la perception de la série 24 fait bien apparaître l’intérêt d’une lecture comparée de la forme série de télévision. En effet, d’un point de vue symbolique, chaque épisode doit recéler sa propre densité, qui vient s’inscrire dans une densité plus large, celle de la saison[16]. En pratique, le téléspectateur qui regarderait les vingt-quatre épisodes à la suite serait particulièrement soumis à un sentiment de grande densité en termes de contenu, dans le même temps où il serait soumis à un sentiment de grande redondance diégétique. Chacun des épisodes étant nécessairement contraint par une écriture du rappel, du résumé, de la reprise d’images déjà diffusées, en vue de la cohérence inter-épisodique, il s’ensuit qu’une lecture cursive de la totalité des épisodes conférerait une impression trouble de déjà-vu et de rupture. Du point de vue temporel et aspectuel, le sentiment de lecture serait alors mû par une forme de durée dédoublée. C’est d’ailleurs bien ce que décrit le philosophe Elie During dans un essai récent sur les effets de durée liés à la « coexistence des images », autrement dit au montage dans la série 24. Plus précisément, il rappelle comment l’expérience de la simultanéité nourrit dans cette série une durée à la fois comme objet d’amplification et de condensation :
Tel est en effet le paradoxe mis en œuvre par cette fiction : comme dans la physique relativiste, l’accélération des lignes de flux s’exprime par une dilatation des durées. L’apparence de compression spatiotemporelle associée à la densification de l’action et à l’intensification du sentiment d’urgence, la frénésie illustrée par chaque épisode pris à part se composent avec une étrange impression de lenteur à l’échelle de la saison entière[17].
24 se présente donc davantage comme une série sur le faux rythme, à travers un jeu sur la durée désignée comme un enjeu esthétique (sa forme) et esthésique (l’effet produit) qui s’expérimente à travers ses propres variations : entre accélération hyperbolique et sentiment paradoxal de lecture au « ralenti ». Voilà pourquoi ce sont d’autres séries contemporaines qui vont écrire une durée plus ancrée dans le temps et le calendrier mêmes de l’empirie du téléspectateur.
C’est pourquoi il nous semble possible de poser qu’il y aurait une échelle de lectures plus ou moins auratiques ou au contraire « expositives ». Les critères de cette différenciation sont à chercher dans les composantes mêmes de l’expérience la plus « cultuelle » au sens que Walter Benjamin donne à ce terme. À savoir l’opposition entre le proche et le lointain, le creusement de l’expérience collective par le maintien des espaces inter-épisodiques qui font « traces » relativement à l’expérience partagée hic et nunc, la création d’un sentiment de la réponse possible par le cadre collectif du « regarder ensemble ».
Ce sentiment de la réponse ne serait jamais aussi explicitement mis en scène que dans la série In Treatment.
Suite de l’article.
Olivier AÏM, « Une télévision sous surveillance », Communication et langages, n°141, 2004.
Olivier AÏM, « La transparence rendue visible », Communication et langages, n°147, 2006.
Roland BARTHES, Comment vivre ensemble : simulations romanesques de quelques espaces quotidiens, Cours et séminaires au Collège de France, 1976-1977, Paris, Seuil/IMEC, « Traces écrites », 2002.
Walter BENJAMIN, Œuvres complètes, Paris, Folio, 3 tomes.
Jay David BOLTER et Richard GRUSIN, Remediation. Understanding New Media, Cambridge, MIT Press, 2000.
Mihai COMAN, Pour une Anthropologie des médias, Grenoble, PUG, 2003.
Lucien DÄLLENBACH, Le Récit spéculaire, Paris, Seuil, collection « Poétique », 1977.
Elie DURING, Faux raccords. La coexistence des images, Arles, Actes Sud/Villa Arson, 2010, p.179
Umberto ECO, « Innovation et répétition : entre esthétique moderne et postmoderne », Réseaux, n°68.
Patrice FLICHY, L’Imaginaire d’Internet, Paris, La Découverte, 2001.
Henry JENKINS, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, NYU Press, 2006.
Youri LOTMAN, La Sémiosphère, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, « Nouveaux Actes Sémiotiques », 2000.
Jean-Louis MISSIKA, La Fin de la télévision, Paris, Seuil, coll. La République des idées, 2006.
Sophie PENE, « La « vie des hommes infâmes » dans la société de la disponibilité. », Etudes de communication, n°28, 2005.
Paul RICŒUR, Temps et récit, Paris, Points Seuil, 3 tomes, 1983-1985.
[1] La médiagénie est un concept créé en 1997 par Philippe Marion, sur le modèle de « photogénie » : « Toute forme de représentation implique une négociation avec la force d’inertie propre au système d’expression choisi. Cette opacité du matériau expressif constitue une contrainte pour que s’épanouisse la transparence relative de la représentation. Il en va de même pour les narrations médiatiques: le récit s’épanouit au diapason de l’interaction de la médiativité et de la narrativité. Mais il est des rencontres plus intenses que d’autres. Chaque projet narratif peut donc être considéré dans sa médiagénie. Les récits les plus médiagéniques semblent en effet avoir la possibilité de se réaliser de manière optimale en choisissant le partenaire médiatique qui leur convient le mieux et en négociant intensément leur « mise en intrigue » avec tous les dispositifs internes à ce média. », in « Narratologie médiatique et médiagénie des récits », Recherches en Communication, n°7, 1997, pp. 61-88.
[2] Bolter et Grusin nomment « re-médiation » le processus général par lequel les médias se régénèrent dans l’histoire, notamment à travers les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Jay David BOLTER et Richard GRUSIN, Remediation. Understanding New Media, MIT Press, Cambridge, 2000.
[3] Les westerns, les comics, les feuilletons télévisés, les mangas, les séries cinématographiques, les séries télévisées…
[4] Jean-Louis MISSIKA, La Fin de la télévision, coll. La République des idées, Seuil, 2006.
[5] C’est le sociologue américain de la culture Roland Robertson qui, le premier, propose le terme de glocalisation en 1995 pour décrire, dans le cadre de la circulation mondialisée de la culture, les logiques d’interpénétration avec les spécificités locales de son implantation.
[6] Olivier AÏM, « Une télévision sous surveillance », Communication et langages, n°141, 2004.
[7] Voici la définition fameuse que donne Pierre Schaeffer : « le dispositif télévisuel peut être comparé au piège tendu à l’animal humain pour sa capture en vue d’observation ».
[8] Pensons, outre Paul Ricœur, à l’ouvrage devenu classique de Harald Weinrich intitulé Le Temps.
[9] Paul RICŒUR, Temps et récit, Points, Seuil, 3 tomes.
[10] Appartenant au domaine religieux, le terme idiorrythmie désigne, sous la plume de Barthes, l’idéal d’une vie harmonieuse entre l’individu et le collectif. Il s’agirait là d’une figure possible du bien « vivre ensemble ». Roland BARTHES, Comment vivre ensemble : simulations romanesques de quelques espaces quotidiens, Cours et séminaires au Collège de France, 1976-1977, Paris, Seuil/IMEC, « Traces écrites », 2002.
[11] Qu’il serait ainsi possible de distinguer d’un « voir avec » subordonné à la pulsion scopique.
[12] Umberto ECO, « Innovation et répétition : entre esthétique moderne et postmoderne », Réseaux, n°68.
[13] Mihai COMAN, Pour une Anthropologie des médias, Grenoble, PUG, 2003.
[14] Youri LOTMAN, La Sémiosphère, Nouveaux Actes Sémiotiques, 2000.
[15] « Sur quelques thèmes baudelairiens »
[16] Qui peut d’ailleurs elle-même s’inscrire dans une densité encore plus large : ce que les auteurs de X Files ont de manière tout à fait stimulante appelé la « mythologie » d’une série, soit son fonds diégétique et feuilletonnesque qui est non seulement trans-épisodique mais encore trans-saisonnier.
[17] Elie DURING, Faux raccords. La coexistence des images, Actes Sud/Villa Arson, 2010, p.179














