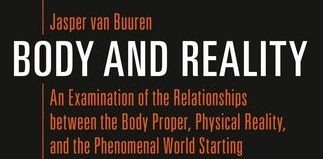La psychanalyse questionnée par l’autisme.(1/3)
Une lecture richirienne
Jean-Sébastien Philippart – Conférencier à l’École Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles
1. Introduction
En mai 2013, Madame Carlotti, ministre française chargée de présenter le plan Autisme 2013-2017 (le 3ème plan), voulut avoir le dernier mot : « En France, depuis quarante ans, l’approche psychanalytique est partout, elle concentre tous les moyens. Il est temps de laisser la place à d’autres méthodes pour une raison simple : ce sont celles qui marchent et elles sont recommandées par la Haute Autorité de santé. »[1] Elle ne faisait là qu’emboiter le pas à l’incessante querelle opposant les approches de style psychothérapeutique aux prises en charge « fondées » sur des approches éducatives et comportementales que la Haute Autorité de santé soutenait dans son rapport de 2012 au détriment des premières. Dans le droit fil du tollé que provoqua ce rapport au sein du milieu analytique, Jean-Claude Maleval, Professeur des universités à Rennes, dans une lettre ouverte à la ministre de la Santé, eut quant à lui ces mots :
Que se passerait-il si Mme Carlotti et ses amis avaient le pouvoir d’interdire les recherches universitaires sur les approches psychanalytiques de l’autisme ? Les uns et les autres ont-ils oublié qu’au XXe siècle ce fut au nom de la science, dont ils se revendiquent, que certaines idéologies conduisirent au pire ? En s’inscrivant dans ce courant de négation de la psychanalyse, c’est à la liberté de pensée que s’attaque le 3e plan autisme.[2]
Les déclarations de la ministre déléguée aux Affaires sociales et à la Santé sont certes péremptoires et reflètent l’esprit caricatural d’une parole prise par le « temps » médiatique. Mais comment un intellectuel aussi fin que J.-C. Maleval, formé à ruser avec les médias, peut-il revêtir la posture de l’orfraie qui tenterait de déchirer par ses cris une « nuit sécuritaire » tombant ? Comment expliquer ce recours à la platitude d’une reductio ad hitlerum pour disqualifier un destinataire ? Comment avancer le raccourci entre science et idéologie totalitaire sans pressentir le pathétique de la proposition ? Il y a là ce que nous pourrions appeler un « maniérisme » de l’indignation, c’est-à-dire l’expression inhabitée d’un comportement emprunté à un rôle prescrit d’avance, tel que le comportement désincarné se « rigidifie dans le cérémonial »[3] et « monte sur ses grands chevaux » : « rien ne peut proprement être opposé au comportement maniéré qui prendra un retour au bon sens pour une contrainte à la banalité, à la bêtise ou à la trivialité. »[4]
L’essentiel n’est toutefois pas pour nous de proposer ici une phénoménologie de l’indignation désincarnée, quant à sa forme empruntée au maniérisme antipositiviste doublé d’une posture antifasciste[5], mais de partir d’un examen de ce qui semble motiver son contenu.
La thèse que recouvre l’indignation peut être résumée de la manière suivante. La psychanalyse s’attache — seule —, dans le champ psycho-médical, à la subtilité de modifications subjectives qu’ignorent les disciplines bornées à l’étude du chiffrable. Or, à travers ces subtiles modifications, il y va de la dimension « symbolique », c’est-à-dire de la tâche civilisatrice à l’encontre du paradigme des sciences expérimentales où la question de l’homme qui s’y heurte, régresse et perd son âme.
Nous allons donc, dans un premier temps, retracer de façon aussi cohérente que possible, malgré les différents courants, ce que pourrait être le tableau clinique de l’autisme appréhendé avec les yeux de l’âme analytique. Mais du fait des difficultés qu’une telle vision charrie — lesquelles tournent essentiellement autour d’un sujet coincé dans les termes mêmes de sa conception (théorie) tandis qu’il fait l’ « objet » en pratique d’une attention (cure) cherchant à sortir de l’impasse —, nous serons amenés à interroger sa notion phare — l’« inconscient » — dans son extrême problématicité et à témoigner ainsi de ce qui échappe au discours articulé par la psychanalyse : l’élément phénoménologique.
Afin de guider au mieux le lecteur, disons dès l’abord quelques mots au sujet de la mise entre parenthèses (épochè) de l’« inconscient » par Marc Richir — l’auteur qui nous fait ici penser —, « inconscient » élaboré par la théorie psychanalytique. L’épochè vise à découvrir en premier lieu, en deçà dudit « inconscient », les profondeurs abyssales d’un inconscient de style phénoménologique. Celui-ci perce dans les trous par quoi s’articule une conscience elle-même de style phénoménologique, qui n’est jamais pleine conscience de soi à soi. Sur base de cette conscience et de ses lacunes, se constitue alors l’inconscient « symbolique », c’est-à-dire coupé du caractère vivant qui fait toute la teneur du caractère phénoménologique. Mais l’inconscient symbolique n’est pas encore l’inconscient de la psychanalyse : ce dernier, à travers une conception très problématique, en constitue une version tardive et éclatée. Autrement dit, il ne s’agit pas de nier l’être de la dimension élaborée par la psychanalyse, mais d’en mesurer la dérive conceptuelle par rapport à son ancrage phénoménologique.
Le « dehors » dont rend compte la phénoménologie richirienne ne se prend donc pas « pour le tout de ce qu’il y a »[6]. Si, dans un second temps, nous allons tenter une phénoménologie de l’autisme, ce n’est pas en vue d’exclure la psychanalyse à titre de théorie non fondée, mais de comprendre le « plus » (phénoménologique) que mobilise sans le savoir la pratique analytique quand elle s’avère efficiente, c’est-à-dire quand elle ne s’empare pas de son sujet pour le fixer en un cas de figure où se consolide un discours exclusivement tourné vers soi. En d’autres termes, lorsque la psychanalyse monte sur ses grands chevaux parce qu’elle se sent menacée alors qu’elle est en principe parfaitement organisée, son comportement trahit là un narcissisme autistique qui ne peut s’en prendre qu’à soi-même. Elle s’enlise elle-même, nous allons le voir, dans l’illusion de croire qu’elle n’est pas hantée, à la différence des sciences expérimentales, par l’aveuglement d’une « pensée » machinale en laquelle, à la manière d’un « dispositif d’actions et de réponses à des stimuli-signaux », « nous ne sommes pas au monde, notre être est ‘‘en souffrance’’ de monde »[7]. Car c’est cette part machinale qui fait retour et se radicalise dans l’hypersensibilité de l’indignation maniérée.
2. La conception de l’autisme en crise
En France, dans la continuité du Plan autisme 2008-2010, la maladie bénéficia du label Grande Cause nationale pour l’année 2012. Une bataille de longue haleine gagnée par des milliers de parents regroupés en associations, dans un pays condamné en 2004 par la Cour européenne des droits de l’homme pour non-respect des obligations éducatives dans le domaine de l’autisme et rappelé à l’ordre en 2007 par son Comité consultatif national d’éthique qui parlait quant à lui de « maltraitance ». Les chiffres sont à cet égard édifiants. Bien qu’il soit établi par la Haute autorité de santé (HAS) qu’un enfant sur 150 naît autiste et que le diagnostic peut être posé entre 8 mois et 2 ans, celui-ci l’est en moyenne à 6 ans, privant l’enfant d’un accompagnement approprié à un âge où il jouit d’une certaine plasticité qui lui permet d’acquérir de grands progrès. Diagnostiqué tardivement, les troubles envahiraient massivement les différentes sphères du développement, fixeraient ainsi les comportements inadaptés, creuseraient les retards en matière d’apprentissage et renforceraient les incapacités. Il est probable que 95% des adultes autistes n’aient pas été reconnus comme tels. Du coup, 60% des internements de plus de trente jours en hôpitaux psychiatriques concernent des autistes dont la situation ne cesserait d’aggraver leur handicap et coûterait inutilement cher à la société. En France toujours, 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés en milieu ordinaire, alors qu’ils sont 70% à l’être en Grande Bretagne et qu’en Italie tous les enfants autistes sont scolarisés depuis 1992 en milieu ordinaire.
Toutefois, ce tableau chiffré, relayé massivement par la presse, ne découle-t-il pas d’une conception comportementale et biologique du phénomène telle que les résultats s’anticipent dans la nature du sujet que l’on prétend expliquer ? Nulle part la HAS ne se demande si l’autisme pourrait être autre chose qu’un trouble du « fonctionnement » de la personne. D’où l’exigence d’un décodage (déchiffrage) du tableau par une pensée qui ne se laisserait pas elle-même trop absorber par son propre codage. Une pensée qui procéderait d’un recul par rapport à la rigueur propre de sa méthode en vue d’une avancée qui ne serait pas circulaire. Une pensée qui procéderait d’une énigme qu’elle tiendrait pour impossible à résoudre dans l’adéquation du sens à lui-même. Une démarche qui, lancée à l’aventure, ne se résoudrait donc pas en équation. La psychanalyse resterait-elle en ce sens adéquate ?
La psychanalyse en cause
Car 2012 ne fut pas l’année de la psychanalyse. Dans son rapport publié le 8 mars, la HAS désavouait en effet celle-ci dans le traitement de l’autisme au profit de l’approche cognitivo-comportementaliste. La Haute autorité mettait la psychanalyse à l’index en la jugeant « non pertinente » pour l’autisme : « L’absence de données sur leur efficacité et la divergence des avis exprimés ne permettent pas de conclure à la pertinence des interventions fondées sur les approches psychanalytiques, ni sur la psychothérapie institutionnelle »[8]. Quand on sait que la grande majorité des équipes de professionnels, qui exercent leur travail auprès des autistes dans le cadre des secteurs de psychiatrie et des institutions médico-sociales, bénéficient d’une formation analytique relayée par le monde universitaire, telle que la psychanalyse constitue en France l’unique « technique » en la matière remboursée intégralement par la sécurité sociale, on imagine aisément quelle put être l’ampleur du choc pour lesdits professionnels.
L’écartement de la psychanalyse recommandé par la HAS n’est en réalité que la conséquence d’un affrontement autour de la conception de l’autisme et du type de traitement que l’on en déduit. Cet affrontement dure depuis des décennies et a été porté sur le terrain médiatique et politico-juridique par le biais du monde associatif. Celui-ci, institué par les parents d’enfants autistes, accuse la psychanalyse d’accuser les mères de ces enfants, considère que la psychiatrie n’a pas à accueillir ces enfants puisque l’autisme serait une « réalité neurobiologique » non une « psychose », et a porté plainte contre le recours au packing, une pratique introduite par la psychanalyse consistant à envelopper l’enfant dans des draps mouillés froids en cas de grande agitation afin qu’à leur contact « se reconstruise l’image de son corps ». On imagine aisément que la représentation du packing aux yeux des non-professionnels se fonde sur le souvenir de pratiques asilaires issues d’un autre temps et puisse être couverte d’opprobre.[9] Admettre que la maladie n’est pas provoquée par les parents mais qu’elle est d’origine neurobiologique comporte en outre un effet bénéfique sur le plan socio-politique : aux yeux de l’opinion publique, il est normal que le contribuable soutienne les victimes d’une catastrophe « naturelle »[10]. Mais, contrairement à ce que clament certains psychanalystes, l’unanimité des associations de parents contre le traitement analytique de l’autisme n’est pas forcément le résultat d’une pression des cognitivo-comportementalistes regroupés en lobby, attendant dans l’ombre l’institutionnalisation et le remboursement de leur pratique. Il est bien plus économique pour la pensée d’imaginer des parents fatigués de se sentir suspectés de froideur à l’égard de leur progéniture, se tournant dès lors vers des techniques qui les intègrent véritablement à une approche éducative et pédagogique de l’autisme. Notons que cette prise en charge sociale qui arrache l’autisme à ses structures médicales apparaît de la sorte paradoxalement motivée par une conception neurobiologique. Quant à l’idée que les parents satisfaits de la psychanalyse ne se seraient pas exprimés parce qu’ils auraient honte (l’autisme renvoyant à leur intimité)[11], quelle curieuse satisfaction que celle vécue dans un tel sentiment ! La honte induite par la situation analytique, dira-t-on, exclut encore une fois les parents d’une partie de la solution. Enfin, s’il s’agit bien de reconnaître le rôle essentiel du monde associatif dans le désaveu officiel de la psychanalyse (sur 180 organismes consultés par la HAS, 106 associations représentant les usagers, les familles et gestionnaires d’établissements), il reste que le rapport de la HAS a classé celle-ci dans les pratiques « non consensuelles » et pas dans les pratiques « non recommandées » comme le désiraient les familles. S’il y avait un lobby cognitivo-comportementaliste à l’œuvre, il fallait donc également compter avec un lobby psychanalytique.
La réaction des psychanalystes
Face au spectre d’une disparition de la psychanalyse des institutions, les praticiens par le biais de la pétition et du manifeste ont revêtu la posture des « résistants ». Certains prétendent même, curieusement, qu’il y va dans cette affaire du devoir démocratique puisque l’écartement de la psychanalyse condamnerait les parents à ne plus pouvoir jouir de la liberté de choisir le traitement qu’ils estiment convenir à leurs enfants.[12] C’est donc l’hôpital monopolisé depuis des décennies par la psychanalyse qui se moque de la charité… Mais plus sérieusement, l’essentiel de la charge contre les traitements de type cognitivo-comportementaliste mobilise, en le portant haut et fort, le thème d’un choix de civilisation à la portée ontologique : agir au profit du comportementalisme et de la biologie reviendrait à dénier le sens même de la subjectivité en instituant par le « dressage » un monde de sujets qui ne connaîtraient que des homologues et dont on aurait occulté la souffrance psychique. À cet égard, la prolifération du thème de l’autisme dans les médias, pas même en tant que « question » mais en tant que « fait » de société, ne serait que le symptôme d’un système de communication agité par celui qui ne sait pas communiquer, « l’impossible à supporter »[13]. Prolifération médiatique associée à des modes de traitements cognitivistes qui s’évertueraient, dans une tâche sans relâche parce qu’impossible (20 à 25h de prise en charge éducative préconisées par semaine), à déloger le « sujet » de son monde afin de l’intégrer au circuit de l’autonomie et de l’utilité. La problématisation à la portée ontologique est telle que la querelle des lobbies se voit dépassée.
Ne doutant pas que des intérêts personnels et professionnels puissent à leur niveau motiver une thèse comme celle-là, nous nous proposons de l’examiner en lui reconnaissant une « intentionnalité » qui lui serait propre.
La thèse analytique présente l’avantage — tout en prenant acte de la souffrance — de relativiser la situation. Mettre en cause l’« impérialisme idéologico-scientifique » propre à l’empirisme anglo-saxon qui œuvrerait à l’établissement d’une psychiatrie mondialisée et d’une mathématisation de l’univers mental par le biais de son Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)[14], lequel classifie l’autisme dans la catégorie d’un trouble envahissant du développement (TED)[15], constituerait les premiers pas d’une démarche éclairée. Confrontée à une expérience dont la singularité lui échapperait, l’empirisme classerait l’autisme dans un vaste ensemble aux critères différenciateurs vagues regroupant des troubles hétérogènes. Pour la psychanalyse donc, l’absence d’une spécification de la maladie dans son originalité expliquerait l’explosion statistique.
3. La conception psychanalytique de l’autisme
En vue d’examiner la thèse analytique qui se pose à même le champ clinique comme l’unique gardienne de la subjectivité, exposons brièvement le regard psychodynamique sur la maladie. Dans la foulée des questions que ce regard soulèvera, nous interrogerons alors la « culpabilisation » funeste de la mère, dont les professionnels se défendent aujourd’hui grâce, entre autre, à une conception « renouvelée » de la maladie.
Pour la psychanalyse (dont la diversité des regards théoriques et pratiques traverse une certaine orthodoxie condensée dans des dictionnaires ou des lexiques[16]) l’autisme se différencie de la psychose en ce que celle-ci constitue un trop-plein d’identification tel que le psychotique se voit envahi par la voix de l’Autre (lieu symbolique de production du signifiant) qui parle dès lors pour lui. Dans l’autisme, au contraire, il y a originairement échec de l’identification primaire.
Le processus d’identification a pour enjeu l’éveil à la pulsion ou au désir visant un objet imaginaire qui le cause et dans le rapport entre lesquels l’être se condense en un « moi » (effet d’une seconde identification)[17]. La pulsion est dite « invocante » en ce qu’elle vise la « voix » surgissant comme objet imaginaire.
Au départ n’est pas la voix, mais le « cri ». Le cri, celui de l’enfant (infans), est une sonorité pure et non pas « pour » : il ne possède pas la dimension de l’« appel ». C’est l’Autre incarné par la mère ou son substitut qui, prêtant attention au cri de son enfant, lui prête sens ou signification, l’interprète comme signe de faim, soif, besoin d’être changé… Autrement dit, si le cri est un signifiant sans effet de sens (S1), la réponse de l’Autre est la production d’un signifiant (S2) qui va représenter l’enfant dans le désir de sa mère. Du coup, le cri pris au champ de l’Autre devient « appel » et le signifiant (S1) ne représente le « sujet » que pour un autre signifiant (S2).
Mais un sujet clignotant et vacillant indéfiniment entre deux signifiants n’épuise pas la structuration de l’être : dans la dépossession du cri se profile un « moi » dont la voix fait entendre la voix de l’Autre. L’Autre effectivement n’a pas seulement la parole, il a une « voix ». Il faut entendre ici la voix dans sa résonnance pure comme ce qui relève spécifiquement des phénomènes prosodiques tels que l’intonation, l’accentuation, le rythme, les variations de hauteur et d’intensité, la durée[18]. Résonnance qui pénètre l’être en profondeur, le fait vibrer, retentit en lui, l’é-meut et explique la préséance de la voix sur le regard. La voix porte la parole : elle résonne entre les signifiants comme ce qui détermine précisément l’appel à répondre. La voix est l’appel même à ce que le sujet lui prête attention en prêtant l’oreille, se fasse toute ouïe. Ainsi, dans la mesure où la voix est liée à ce qui se dit mais n’offre pas de réponse (puisqu’elle n’est pas la signification), elle en appellerait une. Cependant, il convient de ne pas aller trop vite. Car « originairement », en tant que résonnance, la voix n’est rien d’autre qu’une voix captivante et envahissante — le chant des sirènes — qui s’empare de l’enfant dans un appel inconditionnel à jouir sans répit de l’indifférenciation. Le désir de l’Autre qu’exprime la voix, à ce niveau, laisse celui qui l’entend sans voix. La subjectivation ne peut avoir lieu qu’à travers un écart, un pas de côté. Or ici, rien ne distingue vraiment le cri infantile qui mobilise la mère de la voix maternelle qui mobilise l’enfant. C’est donc là, par contraste, qu’entre en scène la parole ou le travail « symbolique » de la signifiance. La voix introduit l’enfant à la parole en ce sens que, confronté à la signification qui mine la matérialité vocale, l’enfant est dépossédé de son cri tandis que, simultanément, la voix qu’il incorpore dans l’audition se trouve voilée. En incorporant la voix (= incorporation de base) qui ne peut que s’incorporer à lui puisqu’elle résonne comme organe de jouissance absolue, l’enfant accepte le règne du « symbolique » que le support de jouissance lui permet d’investir et du même coup se rend sourd « au timbre primordial pour parler sans savoir ce qu’il dit, c’est-à-dire comme sujet de l’inconscient. »[19] L’incorporation a lieu dans le refoulement originaire par quoi « l’infans simultanément perd et trouve sa voix. »[20] Au sein de la continuité ou indifférence vocale, le refoulement institue un point sourd (comme on parle en optique d’un point aveugle) en tant que condition de possibilité de l’invocation. Mais en refoulant la voix de l’Autre, le sujet la fait surgir comme objet imaginaire qui soutient le désir (= incorporation seconde) et tient lieu de la chose perdue à titre de signe, de trace ou de reste de la jouissance auditive. (Il faut être attentif à la notion de « trace » : celle-ci se situe entre la présence de ce que le signifiant n’a pas fait disparaître et son absence due à l’« espacement » symbolique.) Désormais, le sujet peut donner de la voix : sa voix, il ne la possède pas, elle est à chercher dans ce qui se reflète au champ de l’Autre auquel elle est restituée.[21] De là cette voix qui est la mienne et qui pourtant m’échappe, n’est pas vraiment celle qu’on a cru saisir dans un enregistrement.
En d’autres termes, de la même manière qu’un regard peut exprimer ce qu’il voit, la voix de l’Autre — surgissant comme objet imaginaire, voilement de la voix — « répond » à ce qui se dit en n’y répondant pas et possibilise l’identification (incorporation seconde). La similarité (qui fait la teneur de l’« objet ») se dessine, se réfléchit sur la surface impénétrable de l’unité symbolique : le signifiant. L’objet imaginaire est « la structure signifiante dont se vêt l’objet réel pour supporter le désir »[22]. À distance d’elle-même par rupture de la pure continuité vocale, la voix est articulée à la signifiance — comme écho d’elle-même et de ce qui la fait taire — et se pose comme articulation de signifiants : non seulement le désir (qui exige la jouissance) court entre les signifiants mais il ne coïncide pas avec lui-même et à ce manque correspond l’« objet » ou la représentation-chose déterminé par le symbolique et auquel s’accroche le désir. À travers la distance, un sujet peut user d’un « objet » en ce « sens » que le désir manifeste un sujet destiné indéfiniment à n’être en vue de soi que le désir d’autre chose. Confronté à l’altérité de la voix qui constitue le reflet de la réponse désirée — l’autre en tant que trace du désir de l’Autre scintillant entre les signifiants —, le sujet cherche à l’assimiler comme ce à quoi il peut s’assimiler. Il s’y appréhende soi-même comme un autre et s’éveille à l’aperception de soi à même le désir.
Par la voix de l’Autre que le sujet assume en y demeurant sourd et au terme d’une seconde incorporation donc, se forme un « moi » dans un sentiment de soi où le sujet « se fait entendre » (se fait appeler et appelle). Ce qui se dessine par l’incorporation que l’objet imaginaire suscite n’est ainsi rien d’autre que l’image du corps dont le moi a idée comme de soi et à travers laquelle l’être se donne une contenance. Grâce à la représentation-voix, le psychisme trouve son centre de gravité. Elle enveloppe l’appareil psychique. La pulsion ne peut être en effet ressentie comme poussée que dans la mesure où elle a affaire à la limite d’un objet-support qu’elle investit et contre lequel elle s’investit. De ce rapport entre la pulsion et la représentation-chose qui la contient, émerge le sentiment du moi. Pour le dire encore autrement, la représentation-chose où la pulsion est pendue à un signifiant — tel que le moi est mis en mouvement autour de quelque chose d’impossible dont il ne cesse de faire le tour — met en scène le sujet et donne une figure au désir.
Ainsi à la différence du psychotique, l’autiste ne délire pas car l’incorporation de la voix n’a pas eu lieu : il a manqué (de) l’appel inconditionnel. Aussi, pour l’autiste, la relation à autrui (à la place de l’Autre) n’existe pas faute de contours corporels que constitue l’image du corps : corrélativement au manque de perception interne d’un « moi » dans le chaos pulsionnel, l’autre n’a pas de centre de gravité. D’où l’auto-mutilation, la stéréotypie, l’hypertonie et la recherche d’appui sur des supports, comme efforts désespérés pour se donner une contenance dans l’établissement des bords. Il s’enveloppe dans la souffrance ou s’appuie sur un ensemble d’éléments qui ne sont au service que de la négation de la réalité externe : l’« objet-double ». « Le bord est une frontière protectrice, qui peut devenir le lieu de déploiement d’un îlot de compétence, mais c’est aussi le lieu où le sujet situe un objet-double qu’il maîtrise. »[23]Faute de voix qui introduit à la parole de l’Autre (S2), tout est donc « réel » pour l’autiste[24] : il vit dans un environnement différent du monde de l’interprétation et de la signification. Son langage (S1 sans S2) est idiosyncrasique. Coupé du discours c’est-à-dire du passage à l’Autre par le biais de l’appel, il n’est pas soumis aux articulations propres à la langue maternelle qui aurait dû être la sienne. « Incapacité à généraliser, pauvreté de la capacité d’abstraction, disent les spécialistes, certes, mais plus précisément, faute d’avoir eu accès au signifiant, l’autiste pense d’abord avec des signes, lesquels se caractérisent de conserver un rapport étroit avec leur référent. »[25] Le réel est pris à la lettre et sa jouissance ne peut être que souffrance[26]. C’est que le signe (le signifiant détaché de sa valeur de signification, le cri qui entend rester maître de soi en ne se disposant pas au champ de l’Autre) n’existe qu’à se répéter en enfermant les sujets dans l’angoisse « dès qu’ils sont confrontés à la demande de l’Autre, dès qu’on leur retire leur objet, dès qu’on leur demande de parler en leur nom propre »[27]. Les autistes disposent de mots « ‘‘émis plutôt que parlés’’, [ceux-ci] proviennent d’un ‘‘répertoire mental mémorisé’’, rien n’est plus difficile à ces sujets qu’une ‘‘expression personnelle’’. Quand ils parlent, c’est sans s’impliquer dans leur parole, sans prendre appui sur leur ressenti. »[28]
Le symbolique avec lequel les autistes se structurent induit une propension à recourir aux indices et aux icônes pour appréhender le monde, or ces signes ne s’inscrivent pas dans le corps et ne sont pas porteurs de la jouissance vocale, d’où l’obligation de ‘‘tout comprendre par l’intellect’’ soulignée d’emblée par Asperger.[29]
Nous retrouvons la corrélation entre la signifiance de la parole et la fonction corporelle comme possibilité même que quelque chose puisse s’inscrire (possibilité de la trace) et faire que la parole puisse être « habitée ». Dans la structure autistique, « le signifiant manque à devenir corps et manque ainsi à faire affect »[30]. Désinvestie, désancrée du « ressenti » (désinscrite de l’inscription qui ne se fait pas), la parole éclate en « signes » qui ne découpent rien et paraissent coller aux choses. À défaut d’imaginaire, il n’y a pas d’espace vécu (entre ouverture et capture) entre le symbolique et le réel. L’autisme atteste donc par sa défaillance que l’imaginaire nous prémunit de l’enfermement dans un réalisme nominaliste (la chose est le mot) ou un nominalisme réaliste (le mot est la chose) en tant que court-circuit ou dissociation entre le symbolique et le réel.
Que peut faire le psychanalyste ? Comprendre qu’à travers l’angoisse, un sujet tente de se défendre « contre le réel sans loi auquel il est soumis »[31]. Être attentif par conséquent aux fragments de langage qui s’échappent du circuit signalétique et se donnent à titre éléments proto-métaphoriques[32] : association phonétique par consonance ou association d’objets par ressemblance dans l’espace du jeu, telle que le rapport de « semblance » noue un signifiant à son signifié. Être attentif par conséquent à ces efforts esquissés par quoi le sujet tente de faire trou dans le réel, et l’aider ainsi à construire, en aménageant des points d’arrêts dans le flux de la répétition, un espace où la parole pourrait venir se fixer. (Mais la conception analytique de la parole ne suppose-t-elle pas elle-même la position d’un sujet qui n’est qu’un sujet en souffrance ?)
À cet égard, les professionnels rappellent « qu’en France, à partir des années 60-70, ce sont les psychiatres d’enfant et les psychologues formés à la psychanalyse qui commencent à se préoccuper du sort des enfants autistes jusqu’alors placés en hôpital psychiatrique ou en institution fermée où la dimension déficitaire était prépondérante »[33]. Les « hôpitaux de jour » — à mi-chemin entre l’hôpital psychiatrique à plein temps et la sortie complète de l’hôpital — se créeront dans cette perspective : extraire l’autiste comme le psychotique de la coercition psychiatrique basée sur la logique du « tout ou rien ». Si certains psychanalystes assimilent l’autisme à la psychose, il n’en reste pas moins que la prise en charge hospitalière n’est pas synonyme d’enfermement, contrairement à ce qu’entretient l’imagerie populaire.
[1] Eric FAVEREAU citant la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, in Libération, Site Internet, 19 juin 2013, Disponible sur : http://www.liberation.fr/societe/2013/06/19/autisme-la-psychanalyse-isolee_912306
[2] Jean-Claude MALEVAL, « Lettre ouverte à Madame Touraine, ministre de la Santé, pour le retrait du 3e Plan autisme », in Lacan Quotidien, n° 330, Site Internet, 11 juin 2013, Disponible sur :
http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2013/06/LQ-330.pdf
[3] Marc RICHIR, Phantasia, imagination, affectivité. Phénoménologie et anthropologie phénoménologique, Grenoble, Millon, 2004, p. 390.
[4] Ibid.
[5] Phénoménologie de l’indignation de type médiatique que nous avons tenté d’esquisser ailleurs. Nous nous permettons ainsi de renvoyer le lecteur à notre étude : « La rhétorique de l’indignation ou le maniérisme cosmopolitain », in Mondesfrancophones.com, Site Internet, 4 décembre 2011, Disponible sur :
[6] M. RICHIR, « Science et Monde de la Vie. La question de l’ ‘‘éthique’’ de la science », in Futur antérieur, n° 3, automne 1990, p. 22.
[7] Ibid., p. 19.
[8] HAS – ANESM, « Autisme – Questions / Réponses », 08 mars 2012, Disponible sur : Questions / Réponses – Autisme, p. 4.
[9] Faute de place, nous ne traiterons pas ici de la problématique du « packing » — qui pourrait, à l’encontre de l’imagerie qu’elle produit spontanément, trouver une justification phénoménologique. À cet effet, nous renvoyons le lecteur à : Alain GILLIS, « Approche phénoménologique de l’autisme infantile. Perspectives thérapeutiques », in Perspectives Psy, vol. 43, 2004/2, pp. 113-117.
[10] Cf. Théo PEETERS, « Centre de Formation Autisme », in Theopeeters.be, Site Internet, Disponible sur : http://fr.theopeeters.be/?page_id=1368 (consulté le 09/01/2013)
[11] Cf. Hervé BOKBOZA, in « Autisme : ‘‘Les psychanalystes vont entrer en résistance’’ », in L’Express, Site Internet, 18 mars 2012, Disponible sur : http://www.lexpress.fr/actualite/societe/autisme-les-psychanalystes-vont-entrer-en-resistance_1094612.html
[12] Cf. Christophe DUBOIS, « Défendre une prise en charge psychanalytique de l’autisme : un devoir démocratique », in Des choses à se dire, Site Internet, 3 mai 2012, Disponible sur :
http://christophedubois.wordpress.com/2012/05/03/defendre-une-prise-en-charge-psychanalytique-de-lautisme-un-devoir-democratique/ — Certes il s’agit là d’une réaction belge eu égard au contexte français. Mais il a fallu attendre 2005 pour que voient le jour en Belgique les premiers Centres de Référence pour l’Autisme, conventionnés et effectuant leurs diagnostics, en l’absence de ligne de conduite officielle, sur base des classifications internationales qui considèrent la maladie comme un trouble d’origine neurobiologique. Ils sont actuellement au nombre de huit, ce qui reste, de l’avis des associations, encore largement insuffisant.
[13] Cf. Jean-Pierre ROUILLON, « Petite note sur l’autisme chez Lacan », in École de la Cause freudienne, Site Internet, Disponible sur :
http://www.causefreudienne.net/etudier/essential/petite-note-sur-l-autisme-chez-lacan.html?symfony=59764fbf0c652dcbe181bc649b46e3c1 (consulté le 16/01/2013)
[14] « DSM » dont la nouvelle mouture parue tout récemment — le « DSM-5 » — n’a pas manqué de susciter des attaques de toutes parts, y compris de la part des tenants de la version précédente. En réalité, la virulence des réactions, au-delà de leur aspect idéologique, est à la mesure de l’extrême difficulté de la tâche (impossible à résoudre) : stabiliser le découpage entre normalité (l’être-sain) et pathologie.
[15] Notons que le DSM-5 a remplacé le terme de « TED » qui, dans le DSM-IV (les chiffres romains ont été abandonnés), répondait à la grande variabilité des symptômes des personnes autistes, mais créait du coup la confusion en laissant croire que les personnes TED n’étaient pas autistes, par le terme « TSA » : troubles du spectre de l’autisme.
[16] Bien que tous les professionnels ne reconnaîtraient pas leur regard sur la chose, notre exposé n’a de sens que de permettre au lecteur de se faire une idée de ce qu’est l’autisme du point de vue analytique, — exposé à distance des querelles à l’occasion byzantines entre les différentes chapelles, cherchant à tracer une route dans une mer quelquefois houleuse de textes fidèles à tels ou tels courants et cédant au passage à la cascade des jeux de mots. Si par ailleurs ce bref exposé s’empare de la logique du « signifiant », c’est en tant que celle-ci entend répondre à une formalisation de la situation du sujet et s’adresser par là à l’auditeur universel que représenterait de façon particulière tout lecteur. Autrement dit, le discours de la psychanalyse ne se réduit pas à ce que l’on en dit ; elle ne se bat pas avec les mots simplement pour les mots : la profusion des points de vue s’arrime tant bien que mal à une certaine orientation qui n’a cependant rien d’évident et fait question en deçà de l’organisation conceptuelle fondamentale de son expérience.
[17] Prenons garde à l’emploi des termes. Le processus d’identification que nous assimilons dans notre exposé à un processus d’incorporation (qui n’est pas l’« incarnation » au sens phénoménologique) est double : pour nous, la seconde identification semble avoir lieu sur base d’une identification primaire constituant précisément celle qui ferait défaut dans la radicalité du phénomène de l’autisme. Or, la plupart du temps, en littérature analytique, l’identification « primaire » est assimilée à la « phase du miroir » qui correspondrait ainsi pour nous à la seconde incorporation et dont le défaut s’expliquerait sur base d’un manque plus élémentaire. Cela dit, nous employons ici le conditionnel, car une fois la lecture psychanalytique problématisée, sa refondation phénoménologique redistribuera les découpages en faisant apparaître de nouvelles articulations qui ne remettent pas en cause (montrent du doigt) mais en question (éveillent au remaniement) l’institution analytique.
[18] Avant d’être objets de calculs, les phénomènes prosodiques doivent être rendus à leur essence : ils ne se déroulent pas dans un cadre fixé par des coordonnées, ils s’engendrent à même l’espace qu’ils ouvrent dans un style qui leur est à chaque fois propre. L’intonation d’une voix n’est pas ainsi représentable, elle ne peut être que sentie. D’où (selon une perspective bergsonienne) le rire provoqué par l’imitateur en ce qu’il chosifie le rythme de la voix dont il s’est saisi par des automatismes (mais dont l’acquisition suppose une gestuelle mimétique). Une redoutable question (dont nous ne traiterons pas directement ici) se pose alors : comment du mécanique peut-il être plaqué sur du vivant sans l’étouffer complètement ?
[19] Jean-Michel VIVES, « Pulsion invocante et destins de la voix », in Psychologie clinique, n° 13, 2009, p. 87.
[20] Ibid.
[21] On l’aura compris, si la voix de la mère se dévoile originairement chez l’infans comme non voilée, elle est d’ores et déjà voilée pour la mère, c’est-à-dire chez un sujet affecté du « pour-soi ».
[22] Jean-Michel RIBBETES, « La troisième dimension du fantasme », in Claude ZÉRAFFA et Didier COSTE (sous la direction de), Art et fantasme, Seyssel, Champ Vallon, 1984, p. 190.
[23] J.-C. MALEVAL, « Qui sont les autistes ? », in Le Pont Freudien, Site Internet, Disponible sur : http://pontfreudien.org/content/jean-claude-maleval-qui-sont-les-autistes (consulté le 20/01/2013)
[24] Si dans l’autisme, c’est le sujet qui jouit, dans la psychose en tant que soumission à la voix de l’Autre, c’est ce dernier au contraire qui jouit.
[25] J.-C. MALEVAL, Op. cit.
[26] Il convient d’avoir assimilé ici la catégorie de « réel » à la notion de jouissance, ce qui fait de la jouissance en psychanalyse quelque chose d’« impossible ». Le « réel » relevant en effet de l’imperceptible, c’est-à-dire de ce qui n’est pas saturé par le désir et l’imaginaire, demeure inassimilable au symbolique (comme pouvoir de représentation, accès au langage). Par ailleurs, on l’aura compris : la « voix » constitue une modalité du « réel ».
[27] J.-C. MALEVAL, Op. cit.
[28] Ibid.
[29] Ibid.
[30] Rosine et Robert LEFORT cités in Ibid.
[31] J.-P. ROUILLON, Op. cit.
[32] Cf. Barbara BONNEAU, « Quelques éléments de psychanalyse avec les enfants manifestants des signes d’autisme », in Les mots dans l’œil, Site Internet, 10 novembre 2010, Disponible sur : http://les-mots-dans-l-oeil.com/galerie-de-textes/quelques-%C3%A9l%C3%A9ments-de-psychanalyse-avec-les-enfants-manifestants-des-signes-d-autisme/
[33] Commission d’initiative de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, « Autisme et psychanalyse : nos convictions », in Le Cercle Psy, Site Internet, 22 février 2012, Disponible sur :
http://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/autisme-et-psychanalyse-nos-convictions_sh_28529