L’animalité en question (1)
Une lecture richirienne dans un souci éthique
Jean-Sébastien Philippart
Par souci de clarté et d’économie typographique, certaines citations sont directement suivies d’une numérotation. Il s’agit dans tous les cas d’un renvoi à l’ouvrage de Marc RICHIR que nous travaillons principalement ici, à savoir : Phénoménologie et institution symbolique, Millon, Grenoble, 1988, 383 p.
I. Esquisse de la question
L’animalité constituerait-elle l’une des principales dimensions de l’impensé de notre époque ou de notre tradition métaphysique ? Le foisonnement des publications qui marque à l’égard de l’animal, ou mieux, des animaux, une inquiétude philosophique croissante depuis une quinzaine d’années[1] le laisserait penser. Or, lorsque l’on se veut critique, il est de coutume d’attribuer à Descartes le moment décisif qui déterminera l’occultation moderne de l’animal en tant que tel. En nous appuyant spontanément sur les animaux pour définir ce que nous ne sommes pas ou ce que nous ne devrions pas être, de la « bêtise » à la « bestialité », nous nous comportons « le plus souvent à notre insu »[2] comme des cartésiens.

Bien que l’animal puisse ne pas manquer de savoir-faire, son être sensible dénué de parole apparaît dépourvu d’esprit et s’en trouve réduit au mouvement-réflexe — pense-t-on lire chez Descartes. L’animal-machine agit et souffre mais il est incapable de se représenter les actions et la souffrance qu’il vit. Il est incapable de l’abstraction qui rapporte les sensations à un « je » et dont témoigne la parole. « [On] voit que les pies et les perroquets peuvent proférer des paroles ainsi que nous, et toutefois ne peuvent parler ainsi que nous, c’est-à-dire, en témoignant qu’ils pensent ce qu’ils disent… »[3]Le sujet a priori humain se fonde alors sur une puissance d’abstraction qui arrache l’être à la nature ou l’étendue, laquelle devient l’objet de pensée d’un « moi ». Privé de raison, enfermé dans son espèce, l’animal assoie la dignité humaine… Toutefois notre commentaire, par trop classique, devrait être nuancé. Descartes, en effet, n’affirme pas vraiment que les animaux soient dénués d’esprit, il affirme surtout que rien ne prouve qu’ils en aient un. Prendre les animaux pour des machines ne veut pas dire qu’ils le soient réellement mais que l’on peut s’en contenter. Le philosophe se veut d’abord prudent avant d’adopter quelque position de principe que ce soit. Il n’empêche : toute une tradition dite « cartésienne » — développant un matérialisme à partir du philosophe et contre lui — s’emparera de ce qui se verra transposé en paradigme de recherche.
Pour l’herméneute visant notre modernité donc (qu’elle s’oppose idéellement à l’animal ou qu’elle considère matériellement l’homme comme une combinaison animale réussie), l’animal privé de la pensée et de la parole, au lieu de lui-même, en dit long sur l’homme ou les préjugés de l’humanisme rationaliste — et cette conception négative, que traduit un sujet dominant théoriquement le monde animal, semble justifier de la sorte en elle-même une certaine violence industrielle, chimique ou génétique[4] sur les animaux. L’arraisonnement (Gestell) se sent convoqué là où la raison fait défaut et met la nature en demeure de dévoiler ses lois mathématiques. Nature qui dans son manque même est d’ores et déjà produite par la raison raisonnante qui l’inspecte, en ce qu’elle est tenue de lui rendre des comptes.[5] La question est alors de savoir comment nous pouvons fonder la nécessité du « bien-être » animal sans que cette éthique ne paraisse relever d’un vécu (subjectivisme), d’une sensibilité personnelle qui n’aurait pas voix au chapitre scientifique (objectivisme).
Afin d’échapper au renvoi désespérant du sujet par l’objet (objectivisme) et de l’objet par le sujet (subjectivisme), il apparaît que la recherche doive se faire selon un certain style qui accomplit ce qui est à signifier, dans une simultanéité entre l’expression et le sens. Il apparaît donc que la réflexion éthique doive s’articuler à une écriture phénoménologique en ce que celle-ci cherche originellement à dépasser l’idéalisme et/ou le psychologisme comme le matérialisme.
À cet égard, sur le rapport de l’animal avec son milieu, inspiré par les recherches du biologiste Jakob von Uexküll, l’un des plus grands précurseurs de l’éthologie contemporaine, Heidegger va s’étendre lors du cours de 1929-30 qu’il dispensera à l’université de Fribourg et qu’il intitulera Les concepts fondamentaux de la métaphysique, Monde-Finitude-Solitude[6]. La recherche heideggérienne apparaît refondatrice en ce qu’elle part d’une phénoménologie de l’organisme qui le différencie de l’instrument et met en cause ainsi la confusion cartésienne de l’animal-machine, toute une tradition. Mais, nous allons le voir, la thèse que poursuit Heidegger — qui développe davantage une métaphysique d’inspiration phénoménologique — demeure par trop massive en ce qu’elle creuse un véritable abîme entre l’animal et l’homme, ce dernier susceptible dès lors de se faire encore accuser pour s’être fait valoir au travers de l’exclusion. Tandis que la tradition métaphysique moderne commence avec l’homme pour revenir à lui par exclusion de l’animalité, l’enjeu inouï consiste à pouvoir penser la vie animale dans sa singularité tout en articulant cette singularité à une différence dans le passage (qui à la fois sépare et réunit) de l’animal à l’homme. Aussi, le cours de 1929-30 consacré en grande partie à l’animalité s’avère « passionnant » en ce que son aporie, si elle est comprise comme telle, met potentiellement en demeure le penseur de reprendre le travail dans une nouvelle direction (ou profondeur). Ce à quoi s’est attelé Marc Richir.
Chez Richir, l’« animalité » fait principalement l’objet d’un chapitre dans Phénoménologie et institution symbolique (pp. 223-285). Précisons que le rapport à l’animal en toute rigueur phénoménologique n’y est pas caractérisé de façon normative. Or, quant à nous, c’est bien à l’horizon d’un souci éthique que nous allons lire ce chapitre. Dès lors, le sens de notre lecture de Richir, aimanté par ce souci, apparaîtra en quelque sorte comme une « déformation cohérente » de l’œuvre. Ce qui ne signifie pas que l’œuvre phénoménologique soit hétérogène à l’éthique puisqu’une pensée authentique se doit d’être attentive en ce qu’elle fait au sens de ce qui se fait.
II. Le rapport heideggérien de l’animal à son milieu[7]
Le préjugé cartésien dont Heidegger cherche à se départir concerne l’amalgame de l’organisme et la machine suscité, peut-être malgré lui, par le Discours de la méthode :
Et si je m’étais ici particulièrement arrêté à faire voir que, s’il y avait de telles machines, qui eussent les organes et la figure d’un singe, ou de quelque autre animal sans raison, nous n’aurions aucun moyen pour reconnaître qu’elles ne seraient pas en tout de même nature que ces animaux […].[8]
Mais il convient d’abord de ne pas confondre « machine » et « outil ». La machine est bien plutôt un complexe d’« instruments » qu’un outil compliqué. Si tous les outils sont des instruments, l’inverse n’est pas vrai. L’essence de l’instrument est d’être « utile à quelque chose », l’essence de l’outil d’être utile « pour un travail » (p. 227). Or toutes les machines ne s’inscrivent pas dans une chaîne de production. Il convient ensuite de se demander si un « organe » a le même sens qu’un instrument. Un œil sert-il à voir comme un porte-plume sert à écrire ? À première vue, on pourrait affirmer que là où le porte-plume est en tant qu’il se rend disponible à la capacité d’écrire, l’œil possède en lui-même la capacité de voir.
Du moins est-ce ainsi en apparence, car Heidegger ajoute aussitôt que ce ne peut être le cas, puisqu’un œil pour soi n’est justement pas un œil : un œil détaché de l’organisme est, dirons-nous, une abstraction ou un œil mort (celui de l’anatomie), l’abstraction, précisément, de l’instrument. (p. 230)
L’organe n’a donc la capacité que dans la mesure où il s’inscrit dans un organisme. L’organe n’a pas la capacité, c’est l’organisme, l’être-capable, qui a l’organe dont l’être n’est pas d’être « utile à quelque chose » mais d’être « au service de la capacité qui le constitue » (Heidegger cité p. 232). L’organisme, à commencer par l’amibe où les organes se forment momentanément en fonction du besoin, ne se sert pas de son organe, il forme lui-même son organe — c’est-à-dire dans une formation qui « n’ouvre à aucun temps et à aucun espace » (p. 233) comme l’aurait le projet d’une pensée qui disposerait d’un instrument d’ores et déjà apprêté. L’être-capable qui s’approprie son organe en rendant possible le service de cet organe est capable « de se placer lui-même à l’avance en lui-même, dans le en-vue-de-quoi. » (Ibid.) Il n’y a d’organisme que dans cette capacité à se dé-placer en soi-même ou à se précéder toujours déjà soi-même — c’est-à-dire sans un temps dans l’espace ni un espace dans le temps — « pour s’exercer, à travers l’organe qu’elle met à son service, en vue d’elle-même. » (Ibid.) Autrement dit, à la différence de l’instrument, l’organe pousse en tant qu’il est poussé au service de l’organisme qui se l’approprie en vue de soi-même. Or la notion de « poussée » s’avère déterminante pour la compréhension de l’être de l’animal en ce qu’elle met en jeu l’ordre « pulsionnel ».
Cette auto-propulsion et cet être propulsé vers ce dont il est capable n’est possible, pour ce qui est capable, que si l’être-capable en général est pulsionnel. Il y a capacité là seulement où il y a pulsion.[9]
Si la capacité se déplace en soi-même, elle « ne se quitte pas pour se rattraper » (p. 240), sous peine de perdre son caractère de poussée dans ce qui apparaîtrait comme une reprise de soi-même. Anticipant le besoin qui pourrait la mettre en retard sur elle-même, elle n’a pas à se reprendre. Aussi, aucune pulsion n’apparaît détachée d’une autre pulsion dont l’écart marquerait comme un temps d’hésitation, mais chaque pulsion apparaît dans son entraînement vers les autres. Le « soi » de l’organisme ne connaît pas de « dehors » qui ouvrirait une conscience ou une réflexion : il est absorption en soi, implication de soi dans un cercle dont il n’occupe pas le centre (ce qui le constituerait comme « dedans » et par suite ouvrirait un dehors) mais la périphérie, « c’est lui qui trace l’anneau où il se tient. » (p. 251) Or, il en va de même pour le comportement animal « qui est en soi un être rendu capable » (p. 243).
Le fait d’être poussé, et d’être poussé (Zu-getriebenheit) de poussée en poussée tient et pousse l’animal en un anneau (Ring), au-dessus et en-dehors duquel il ne saute pas, mais à l’intérieur duquel quelque chose est ouvert pour l’animal. (p. 247)
Que signifie cette « ouverture » à l’intérieur du cercle de l’être-périphérique ? L’animal ne peut adopter un comportement que parce que le comportement s’approprie « le domaine possible de ses effectuations » (p. 237) et « sait » ainsi d’ores et déjà comment se comporter. En ce sens, insiste Heidegger, le comportement est pris en lui-même : « cette prise de comportement est capture comportementale comme capture (Eingenommenheit) de l’animal en soi. » (p. 243) Mais « la capture comportementale n’est pas seulement capture par le comportement, elle est aussi capture par les éléments de l’environnement avec lesquels le comportement est en rapport. » (pp. 246-247) C’est ici que s’établit le lien essentiel entre l’organe et la « prise de comportement » dans la mesure où cette notion permet à Heidegger de rendre compte de l’« excitabilité » de l’être vivant. Ce n’est pas en vertu de quelque excitabilité d’un objet biologique que l’organisme est capable en effet de s’ouvrir à un environnement[10]. Il convient de mettre en lumière une relation préalable entre ce qui est susceptible d’exciter l’organisme et l’ouverture de celui-ci à son environnement (Umwelt). Autrement dit, cette relation préalable doit avoir le caractère de la « pulsion » si nous voulons comprendre comment quelque chose d’environnemental peut éveiller le comportement. Étant entendu que la pulsion, prise en elle-même, selon Heidegger, ne constitue pas une « impulsion » mais est de prime abord inhibée et a besoin d’être activée par un désinhibiteur.
En concevant l’animal comme étant primordialement inhibé, pris en lui-même, Heidegger renverse un axiome fondamental de la conception hégélienne de l’humanité comme inhibition en soi de l’animalité et, en vérité, il détruit complètement notre conception usuelle de l’animalité. Traditionnellement, les animaux sont caractérisés par des tendances (Hin-zu) et des impulsions (Drang) effrénées qui les poussent à agir de telle ou telle manière. Souvent même, le terme d’animalité est synonyme d’impulsivité en ce qu’il fait référence à une force active, une force vitale ou irrationnelle, à une puissance déchaînée, à un surplus d’énergie – énergie bouillant également à l’intérieur des hommes, mais que l’humanité serait parvenue à maîtriser, à nier, à sublimer, à transcender.[11]
Mais si l’inhibition explique l’excitabilité, celle-ci implique en soi la possibilité d’une désinhibition. En réalité, la prise de comportement et ce sur quoi s’ouvre le comportement « forment un seul et même cercle qui se parcourt lui-même. »[12] La pulsion, à même sa tension, anticipe sa désinhibition en ce que l’« autre » ne touche l’organisme qu’à titre de déclencheur d’un comportement spécialisé. À travers la pulsion, l’autre répond d’ores et déjà au comportement qu’il déclenche. L’environnement de l’animal n’est de la sorte constitué que de ce qui est pertinent pour lui. « L’animal et l’environnement jouent donc comme deux pôles en quelque sorte transversaux par rapport à la ligne que constitue l’anneau […]. » (p. 249) Et nous retrouvons naturellement la figure du cercle dans l’entraînement d’une « rencontre » pulsionnelle à l’autre, c’est-à-dire « sans délai et sans répit. » (p. 252) Pour l’illustrer, Maldiney cite ici von Uexküll de qui Heidegger a beaucoup appris (même si le passage que choisit Maldiney est tiré d’un ouvrage postérieur au cours de 1929-30).
La tique ne peut vivre que du sang d’un mammifère de passage. Son organe de perception est excité par… (et ne peut l’être que par…) les exhalaisons d’acide butyrique provenant des follicules sébacés du mammifère. « Des processus dans l’organe de perception déclenchent dans l’organe de l’action les impulsions qui suscitent le relâchement des pattes et la chute. La tique qui se laisse tomber confère aux poils touchés du mammifère le caractère actif du heurt qui déclenche de son côté un caractère perceptif tactile par lequel le caractère olfactif d’acide butyrique va être éteint. Le nouveau caractère perceptif déclenche un mouvement d’exploration, jusqu’à ce qu’il soit à son tour supprimé par le caractère perceptif chaleur, lorsque la tique parvient à un endroit dépourvu de poils, qu’elle commence à perforer. »[13]
Nous le voyons, de même que l’organisme et son environnement entrent d’ores et déjà en résonnance, à un certain type de comportement répond dans une succession déterminée la désinhibition d’un autre comportement. Il en résulte que « l’être ouvert de l’animal n’est en fait qu’être ouvert à ce qui désinhibe » (p. 250). Ce qui dans le cas de la tique réduit son environnement à trois caractéristiques : l’odeur de l’acide butyrique, la texture de la peau des mammifères et la chaleur propre à ceux-ci. Et chaque trait de l’environnement d’être si exclusivement mis au service de l’organisme que sa mobilisation revient finalement à l’écarter comme tel, c’est-à-dire à ne pas s’ouvrir à son altérité en tant qu’une chose, dans l’optique heideggérienne, n’est pas une autre, se réfère à l’autre et prend sens dans une situation d’ensemble. D’où la thèse qui sert de fil rouge à l’exposé de Heidegger : « La pierre est sans monde, l’animal pauvre en monde, l’homme est le plasmateur du monde »[14]. Pris par son comportement et par ce qui le déclenche, l’animal n’a pas la possibilité — c’est-à-dire, à ce niveau, le temps — de percevoir « en tant que tel » ou « comme tel ou tel » ce à quoi il est porté. Selon Heidegger, l’animal est privé de la prise de recul qui s’offre en propre à l’homme et ouvre à toute la richesse d’un monde au large duquel la stricte capacité d’exciter se voit suspendue, recul par lequel un Umwelt (dont le préfixe « um » exprime la complémentarité entre l’organisme et son milieu) qui ne fait jamais que succéder à un autre Umwelt — devient un Welt, unique et d’ores et déjà-là, ensemble signifiant de structures référentielles, au beau milieu duquel l’homme se sent situé. « Si plantes et animaux sont privés de langage, écrit Heidegger, c’est parce qu’ils sont emprisonnés chacun dans leur univers environnant, sans être jamais librement situés dans l’éclaircie de l’Être. »[15]
La différence entre l’animal et l’homme est donc, selon le cours de 1929-30, on ne peut plus radicale en ce que, contrairement à l’homme qui est d’ores et déjà du côté de l’être qui s’adresse à l’homme, lequel peut ainsi l’exprimer dans un langage qui rassemble sans figer (l’ensemble signifiant vient « en mots » dont l’être est de faire advenir le sens en faisant signe), l’organisme n’est tout simplement pas impliqué dans l’être de l’étant : il est exclu de la phénoménalité de l’étant. Il ne jouit pas de cette compréhension pré-ontologique qui nous rapporte à l’être comme l’horizon à partir duquel peuvent se manifester et venir pour nous à la parole les étants comme tels. Il n’a pas la parole — à partir de laquelle quelque chose se montre « en tant que » quelque chose — où s’articule la compréhension qui constitue de la sorte une temporalisation en ce qu’elle se dépasse vers l’être qui l’a chargée de le dire à travers une configuration inédite. L’animal vit donc hors de la différence ontologique. Précisons ici puisque cela s’avèrera utile pour la suite, que cet appel de l’être qui a d’ores et déjà chargé l’être-au-monde d’une compréhension de soi comporte en soi une ouverture et une fermeture. L’être nous appelle dans la mesure même où il se retire. La retraite, le voilement ou l’oblitération de l’être possibilise notre attirance vers lui. Dans l’accès à l’être qui dépend de l’être, l’être se retire comme ce qui se donne en tant qu’impensé.
Eu égard au questionnement éthique, quel bénéfice tire-t-on de l’analyse heideggérienne ? Rien de moins, il nous semble, que l’établissement d’un soi ou d’une individualité animal dans la mesure où l’organisme en tant que tel se structure soi-même, constitue un auto-mouvement dans l’unité d’un comportement rapporté à son milieu. Mais se posent immédiatement ici une série de difficultés que nous ne pouvons pas écarter.
Premièrement, la notion de « pauvreté » en monde de l’animal, liée au caractère pulsionnel de l’organisme qui écarte ce qui n’est pas pertinent pour lui et pour lequel ne persiste pas ce qui l’était, apparaît, au terme de sa longue analyse, problématique pour Heidegger lui-même :
« Cette caractérisation de l’animalité par la pauvreté en monde n’est pas originaire (genuine), elle n’est pas tirée de l’animalité elle-même et elle ne reste pas dans les limites de l’animalité, au contraire la pauvreté en monde est un caractère défini par comparaison avec l’homme. Ce n’est que du point de vue de l’homme que l’animal est pauvre en monde, mais l’être animal n’est pas en soi un être privé de monde. »[16]
Dès lors, pour l’herméneute Françoise Dastur, les scrupules de Heidegger qui viennent renforcer l’abîme entre l’homme et l’animal échappant absolument à notre compréhension, puisque nous ne partageons absolument pas le même monde, doivent être entendus non pas comme l’échec d’une pensée empêtrée dans la métaphysique anthropocentrique, mais comme l’appel, à même cette dé-prise de la compréhension, à considérer l’animal dans sa radicale différence[17]. L’analyse s’achèverait donc à même son propre inachèvement et ne serait rien d’autre qu’une chance pour l’animal… Pour notre part, nous n’emprunterons pas — du moins pas totalement — cette voie qui accompagne une énigme. Nous ne pensons pas que toute compréhension se résoudrait à un asservissement de l’être, précisément parce qu’elle est originairement une expérience d’empathie et qu’elle peut maintenir la différence au sein de sa manifestation. Mais cela implique que nous ayons à réduire l’écart apparent entre le milieu animal et le monde humain. Pour l’instant et pour répondre à la première difficulté, nous pourrions avancer que Heidegger, captif de sa prise de conscience relative à une caractérisation métaphysique, oublie là toute la positivité de l’être-animal qu’il a lui-même mis en lumière et qui n’est pas le simple fait « d’une considération déconstructive »[18]. Reconnaître que c’est l’homme qui procède à une « mise à l’écart » épistémologique (et non pas phénoménologique) ne réduit pas pour autant l’unité de « forme contrapuntique »[19] (au sens musical) entre le comportement et son milieu — en laquelle l’organisme s’approprie la désinhibition — au fait d’une opération de soustraction effectuée sur l’ouverture du monde humain. Le sens aigu de l’observation, avant de se réfléchir en soi et d’interroger sa méthode, est suscité par ce qui le dépasse, ne fait que passer, disparaît dans son apparition et éveille ainsi le regard à soi-même. En réalité, l’hésitation de Heidegger a un sens plus profond que la signification prêtée par le philosophe à son sentiment, mais pour le comprendre, il faudra nous doter d’autres outils d’analyse.
Une deuxième difficulté beaucoup plus sérieuse cette fois concerne la conception organique de la vie qui ne ferait apparaître que « la vie-en-général », sur fond de laquelle on ne voit pas ce qui distingue l’être-animal de l’être-végétal. Nous devons à Christiane Bailey d’avoir soulevé avec acuité l’erreur heideggérienne qui consiste à pousser la déconstruction (de la pulsion appréhendée traditionnellement comme impulsion) jusqu’à la destruction de l’animal en tant que tel.
Ontologiquement, l’animalité n’est pas, pour Heidegger, distincte de la végétalité. La vie, c’est essentiellement le biologique : « le fonctionnement du cœur chez l’animal n’est pas un processus autre que le fait de prendre ou de voir » ([Les concepts fondamentaux de la métaphysique, p.] 349). Les comportements des animaux ne sont pas essentiellement différents de la croissance des végétaux et du fonctionnement des organes vitaux : « entendre, voir, prendre, chasser, s’enfuir, dévorer, digérer, etc. – bref tous les processus organiques » ([Ibid., p.] 349, [C. Bailey] souligne). Et c’est uniquement parce que Heidegger pense les comportements animaux sur le modèle des mouvements tropistiques des végétaux qu’il peut passer sous silence le problème de la relation au temps des animaux, puisque par définition les tropismes sont indifférents à la situation, c’est-à-dire à ce qui venait avant l’excitation et à ce qui viendra après. Ce qui les caractérise, c’est leur indifférence au temps. Un être purement tropistique ou taxique – nous pourrions maintenant dire : purement instinctif – ne peut absolument rien apprendre ni rien anticiper : il est rigoureusement le représentant de son espèce et n’a pas d’histoire individuelle.[20]
Cela étant dit, si l’analyse heideggérienne paraît rivée à l’indifférence vitale, ne sommes-nous pas en droit de nous poser la question inverse : la métaphysique biologique n’assimile-t-elle pas plutôt l’être-végétal à l’être-animal, occultant ainsi davantage l’être-végétal que l’être-animal ? Car tant il est vrai que le règne végétal est susceptible d’une multiplication consistant en une division de l’appareil végétatif dont chaque partie continue à se développer séparément, nous ne pouvons pas confondre l’unité (entre le comportement et son milieu) qui forme une individualité avec l’être-végétal dont certaines parties détachées peuvent rester vivantes. — Mais il reste vrai que l’« ipséité » animale ne peut être ramenée à la seule excitabilité. Le tropisme végétal se caractérise par son unidirectionnalité, alors que la taxie attachée à l’orientation animale tient compte de ses capacités motrices qui recouvrent une possibilité de changement impliquant du « temps ». Il est donc vrai — et Bailey a parfaitement raison de le pointer — que la phénoménologie heideggérienne demeure insuffisante en ce qu’elle occulte totalement la question du temps chez l’animal. Question pour nous cruciale puisqu’elle ouvre, nous allons nous en rendre compte, à la question même de la souffrance animale.
Nous l’avons vu, l’animal selon Heidegger n’a pas accès au langage, non parce qu’il lui manquerait la raison, mais parce qu’il ne se tient pas dans l’ouverture de l’être. Autrement dit, la coïncidence dans le comportement entre la capacité et son effectuation prive l’animal d’un excès en phénoménalité — et donc de langage. Toutefois, au lieu de rejeter en bloc cette thèse par trop massive, il convient davantage selon nous d’être attentif aux failles qui s’y feraient jour, afin d’y articuler de nouveaux aspects (de l’animalité), — inattendus —, dont les possibilités se rapporteraient ainsi au noyau heideggérien en le « dépassant ».
À cet égard, il nous paraît intéressant d’évoquer les remarquables travaux d’Erwin Straus qui, contrairement à Heidegger, ne semble pas préjuger de la possibilité d’une compréhension animale et rend compte, du même coup, d’une différence appuyée entre l’animal et le végétal.
La croissance et la maturation sont des processus inhérents à l’organisme qui exigent que certaines substances soient intégrées et métabolisées. Toutefois, dans la vie animale l’ingestion et l’exécration se réfèrent à un ordre de relation au monde totalement différent de celui qui caractérise l’existence végétale, un ordre de relation qui doit être décrit comme une union et une séparation, mieux, comme un s’unir-à et un se séparer-de. C’est à cette relation au monde du s’unir-à et du se séparer-de et à toutes ses réalisations dans le s’ouvrir et le se-fermer à l’autre, qu’est subordonnée l’expérience vécue primaire de la vie animale. En ce qui concerne les formes supérieures de la vie animale, nous accédons à la connaissance de ce niveau de relation à partir du monde même dans lequel s’établit entre l’animal et nous une compréhension réciproque ; pour les formes inférieures, nous pouvons inférer à sa vraisemblance par voie d’analogie.[21]
Détaché du règne végétal, l’être-animal — c’est-à-dire l’être « sentant » qui n’est plus seulement « être-pris-par » — est mû par une compréhension dont l’esthétique élémentaire est saisie de l’attrayant et de l’adversif qui met en jeu précisément une forme de discrimination élémentaire. Phénoménologiquement, ce n’est pas en vertu d’organes sensoriels que la chose est sentie attrayante : l’attraction a lieu à même la possibilité de l’approcher ou du s’ouvrir, c’est-à-dire à même une compréhension dans le contexte immédiat de son action. Or, sentir l’attraction, c’est la sentir maintenant « à l’endroit particulier et dans le présent particulier et fugace de sa survenance »[22], mais « sous le mode du n’être-pas-encore-un avec cela, c’est-à-dire dans la possibilité du changement de l’approche et de l’union. »[23] Autrement dit, selon Straus, le « monde » de la compréhension du sentir possède toujours la structure de l’Umwelt — en tant que la chose se rapporte à un appétit qui l’anticipe —, mais l’organisme sentant ne se déploie pas périphériquement, son environnement est déterminé « par un centre qui est le là spécifique du lieu d’occupation active de l’animal »[24]. L’appétit est pris dans la double possibilité de l’effroi ou de l’attrait qui fonde l’empathie.
Un oiseau en cage qui ne peut se dérober lorsque quelqu’un s’approche de lui, ne comprendra pas longtemps l’attitude amicale de l’homme dans son environnement.[25]
La compréhension du sentir implique bien alors une sorte de temporalisation. « Tous les objets du sentir ont un horizon temporel en ce sens qu’ils transcendent le présent dans la direction du futur. »[26] Le phénoménologue ouvre ainsi la porte à la reconnaissance authentique d’une inquiétude et donc d’une souffrance animale.
Cette cassure dans l’immédiateté des échanges entre l’organisme et son milieu fait naître, d’une part, un monde, d’autre part, un Soi, une ipséité plus accusée, en tant qu’elle est affectée au sens propre du terme, et en rapport avec elle-même par le détour d’une médiation dont les formes ne lui sont pas données par la nécessité, mais bien par la contingence qui accompagne une vie libre, capable de mouvement spontané.[27]
Toutefois, l’être-en-transition qui se vit comme incomplétude n’apparaît pas dans la description qu’en fait Straus sans quelque ambivalence qu’illustre la proposition suivante. « Tout acte de séparation ou d’union est déjà, à l’ordre de l’immanence, un être-mû, mieux, un être-en-mouvement. »[28] D’un côté donc, c’est dans la communauté fugace de l’instant « que l’animal est enfermé toute sa vie. »[29] De l’autre, « [le] sentir possède sa propre structure spatio-temporelle »[30]. Certes, l’« enfermement » animal dans la description straussienne se dit eu égard à la possibilité de la connaissance objectivante de l’homme : « le sujet-sentant ne parvient pas à un point de vue en dehors du monde des phénomènes. »[31] Mais la difficulté subsiste : comment ce qui est « uniquement à sa place » et « dans son temps »[32] peut-il sortir de sa propre immanence tout en y persistant ? Certes, Straus ne pense pas (ou plutôt croit ne pas penser) le maintenant du sentir comme un maintenant ponctuel : ce dernier « ne désigne pas en effet l’expérience temporelle immédiate du devenir, c’est-à-dire la transition du futur au passé à travers le présent. »[33] Mais la difficulté subsiste : la conception du temps comme écoulement (mélodique) ne rend pas compte des « écarts » où s’articule la temporalisation. Si le maintenant qui survient est destiné à passer et était annoncé par le maintenant qu’il chasse de la présence, futur et passé se ramènent au même. Il en résulte que l’être-en-transition demeure voué en quelque sorte à la capture comportementale « où rien d’autre ne règne […] que l’automatisme de répétition » (p. 251).
Il convient donc d’affiner la description en nous interrogeant à nouveau. Comment penser l’esthétique élémentaire de la compréhension animale qui ne relève à proprement parler ni de l’Umwelt ni du Welt ? Comment penser la structure spatio-temporelle propre au sentir ? Mais une autre question se pose immédiatement : le sentir animal et le sentir humain se recouvrent-ils totalement ? Le sentir animal doit-il, une nouvelle fois encore, répondre à une réduction en tant que réduction du sentir humain toujours déjà habité par des signes ?
Tandis que l’analyse heideggérienne distingue entre la capacité où se joue la capture comportementale et la possibilité où se joue une compréhension pré-ontologique de l’être qui en appelle à sa compréhension linguistique, laquelle n’est pas de soi objectivante, — Straus, de son côté, distingue entre une compréhension pré-linguistique à laquelle est voué le sentir animal comme humain et sur laquelle se base le sujet connaissant (dont le premier moment, chez Sraus, est la perception).
La compréhension de l’animal, nous dit Straus, est une compréhension symbiotique. L’animal comprend tout ce qui est expression et expression-de-soi. Cependant, il ne saisit pas ces expressions à la façon de signes isolés liés à des objets dans leur altérité extérieure […].[34]
L’alinguistique résiste à toute tentative de compréhension de soi, nous dit-il un peu plus loin. Tout ce qui a été structuré et pensé préalablement par le langage masque ce qui est expériencié au niveau alinguistique dès que nous tentons de comprendre nos vécus ou même d’exprimer simplement leur contenu.[35]
Le pré-linguistique — tout autant alinguistique —, on le voit, est frappé d’ambivalence : il fait souffrir l’animal d’un manque qui apparaît en creux de ce dont l’homme est capable (poser le monde comme tel). Il fait souffrir automatiquement l’animal de son animalité, bloqué en soi par soi — tel un fou qu’il ne peut pourtant pas être (le fou continuant en effet à parler). Toute la question est dès lors de pouvoir reconnaître une esthétique animale à distance de l’Umwelt mais de telle sorte que cette esthétique ne soit pas seulement pré-linguistique et possède ainsi un mode d’être qui lui soit propre. Du coup, si l’on en venait à découpler la compréhension linguistique de sa dimension pré-ontologique — ce qui, formulé ainsi, paraît absurde —, une autre question encore se ferait menaçante : que voudrait dire le langage s’il n’est pas une expression de l’être ?
Straus pressent pourtant ce qu’il n’a pas les moyens de dire et que les travaux précurseurs de Marc Richir vont nous permettre d’affronter : si la langue masque ce sur quoi elle s’institue, il y a du non-phénoménologique qui s’empare du phénoménologique et que la notion de « négation existentielle »[36] (comme montée à un niveau supérieur), apparaissant tel un deus ex machina, n’explique tout simplement pas.
[1] Cf. Une bibliographie sélective des ouvrages de la Bibliothèque nationale de France en vue de la seconde épreuve écrite de l’agrégation de philosophie 2012, autour précisément du thème : « L’animal », Disponible sur : www.bnf.fr/documents/biblio_%20agregation_animal.pdf
[2] M. RICHIR, Le corps, Essai sur l’intériorité, Paris, Hatier, 1993, p. 60.
[3] René DESCARTES, Discours de la méthode, Paris, Vrin, 1989, p. 122.
[4] « La génétique contemporaine travaille sur une autre analogie : l’animal n’est plus une machine thermodynamique, mais un programme d’ordinateur, que l’on peut à loisir enrichir d’informations nouvelles… » (Catherine LARRÈRE et Raphaël LARRÈRE, « Actualité de l’animal machine ? », in Sens Public, Site Internet, 20 septembre 2004, Résumé, Disponible sur : http://www.sens-public.org/spip.php?article77#)
[5] D’où la question : comment la raison raisonnante peut-elle échapper au cercle de la tautologie qu’elle trace en elle-même ?
[6] Martin HEIDEGGER, Les concepts fondamentaux de la métaphysique, Monde-Finitude-Solitude, Paris, Gallimard, 1992, 552 p.
[7] Pour l’essentiel, nous exposons ici la thèse heideggérienne sur base des travaux de M. RICHIR, Op. cit., et de Henri MALDINEY, in Penser l’homme et la folie, Grenoble, Millon, 1997, pp. 194-197 et pp. 368-375.
[8] R. DESCARTES, Op. cit., p. 120.
[9] M. HEIDEGGER cité par H. MALDINEY, in Op. cit., pp. 368-369.
[10] Ce que défend au contraire la neurophysiologie basée sur le modèle de l’organe comme instrument, qui relève ainsi d’une conception abstraite du vivant : « La neurophysiologie est l’étude du fonctionnement du système nerveux. L’information en provenance des récepteurs périphériques nous renseignent sur l’environnement ; elles est analysée par le cerveau pour donner naissance aux perceptions (certaines d’entre elles pouvant être stockées en mémoire) et initier une action comportementale.» (Pr. Jacques LE HOUELLEUR (Université Montpellier II), « Cours de neurobiologie cellulaire », Chapitre I – La neurophysiologie cellulaire, I – Définition, Disponible sur : http://schwann.free.fr/neurobiologie_cellulaire03.html (consulté le 15/07/2012))
[11] Christiane BAILEY, « La vie vegetative des animaux. La destruction heideggérienne de l’animalité comme réduction biologique », in PhaenEx, n° 2, Site Internet, automne-hiver 2007, Disponible sur :
[12] H. MALDINEY, Op. cit., p. 375.
[13] Ibid., pp. 373-374.
[14] M. HEIDEGGER, in Ibid, p. 194.
[15] Idem, Lettre sur l’humanisme, Paris, Aubier, 1983, p. 65.
[16] Idem cité par Françoise DASTUR, in « L’animal, figure du Tout-Autre », in Philopsis, Site Internet, 2012, Disponible sur : http://www.philopsis.fr/spip.php?article227, p. 14.
[17] Cf. Ibid., p. 14-16.
[18] Idem, in Ibid., p. 11.
[19] H. MALDINEY, Op. cit., p. 374.
[20] C. BAILEY, Op.cit., p. 111.
[21] Erwin STRAUS, Du sens des sens. Contribution à l’étude des fondements de la psychologie, Grenoble, Millon, 2000, p. 234.
[22] Ibid., p. 237.
[23] Ibid., p. 279.
[24] Ibid., p. 276.
[25] Ibid., p. 242.
[26] Ibid., p. 279.
[27] F. BURGAT, « L’inquiétude de la vie animale », in Klesis, n° 16, « Humanité et animalité », Site Internet, 2010, Disponible sur : http://www.revue-klesis.org/numeros.html#d16, p. 34.
[28] E. STRAUS, Op. cit., p. 235.
[29] Ibid., p. 237.
[30] Ibid., p. 243.
[31] Ibid.
[32] Ibid.
[33] Ibid., p. 412.
[34] Ibid., p. 236.
[35] Ibid., p. 239.
[36] Ibid., p. 388.












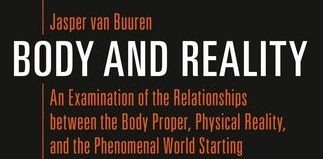


Bonjour,
Peut-être cette courte video vous intéressera-t-elle.
Cordialement.
https://www.arca-librairie.com/forum/videos-et-commentaires/207-stephane-feye-l-homme-un-animal