Le fondement rationnel de la philosophie du langage ordinaire.
Dire et vouloir dire ( deuxième partie)
Autour de « Must we mean what we say ? » de S. Cavell
Alors que tout le poids de la critique de Mates se trouve dans la dénonciation de l’absence de fondements solides des procédures du langage ordinaire, autrement dit « l’accusation caractéristique de la non-vérifiabilité empirique »[1], Cavell retourne cette critique, en montrant qu’elle-même n’est pas fondée, c’est-à-dire que « certains des arguments qu’avance Benson Mates contre les philosophes d’Oxford qu’il mentionne sont au total sans pertinence au regard de leurs préoccupations principales »[2]. Du fait que son « excellent collègue Benson Mates trouvait l’apport philosophique des travaux d’Austin – pour dire les choses brutalement – tout à fait nul »[3], celui-ci néglige de prendre en considération ce qui « est dit » (ce qui est avancé et revendiqué) par les philosophes de l’ordinaire. Toute parole est située ; pour la comprendre et l’estimer, il faut tenir compte de son contexte global.
C’est pourquoi Cavell leur rend justice en reprenant ce qu’est « la signification d’une démarche philosophique où nous partons de ce que nous disons et voulons dire d’ordinaire » (MWM, p.2). Et pour cela il ne pose pas seulement la question « de quel droit les philosophes du langage ordinaire se fondent sur ce que nous disons d’ordinaire ? », mais aussi « sur quoi ou sur qui se fondent-ils pour déterminer ce que nous disons ordinairement ? ». En un mot, il déjoue le piège de la simple confrontation critique pour montrer dans quelle mesure le renversement austinien est révolutionnaire et en fin de compte nettement plus convaincant que les résultats de la philosophie traditionnelle. Pour montrer cela, il nous faut tout d’abord faire un petit détour et expliciter une notion utilisée jusqu’ici sans les justifications nécessaires.

Roman Bonnery - http://www.romanbonnery.com/
La notion de contexte
De prime abord, il est absolument nécessaire de souligner que la notion de contexte n’est pas « neutralisante » au sens où elle serait un cadre de compréhension univoque. Le contexte est intrinsèquement une notion plurielle : on a toujours affaire à des contextes où sont en jeu divers éléments ; d’où la difficulté que l’on a parfois à les caractériser. Il semble toujours être un horizon à partir duquel on fait ressortir le sens, d’où l’impression de distorsion entre l’événement que constitue l’énoncé (l’énonciation) et son arrière-plan global. Mais si ce sentiment recèle quelque chose de vrai, pour autant la remarque de Mates à ce propos est caricaturale :
Nous avons tous entendu cette platitude lassante selon laquelle “il est impossible de séparer” la signification d’un mot de la totalité du contexte dans lequel ce mot apparaît, ce qui comprend non seulement le contexte linguistique effectif, mais aussi les visées, les sentiments, les opinions, et les espoirs du locuteur, idem pour l’auditeur et les assistants éventuels, la situation sociale, l’environnement physique, l’arrière-plan historique, les règles du jeu, et ainsi de suite à l’infini[4].
Et cela permet à Cavell d’ironiser (d’une manière assez austinienne) :
Ne s’agit-il pas là encore une fois d’une de ces apostrophes à l’infini qui empêchent les philosophes de s’occuper de cas concrets ? Il est sûr que si je dois continuer à l’infini sur le contexte de “volontaire”, je n’irai pas très loin (pp. 16-17).
Ce dont ne tient pas véritablement compte Mates, c’est que le discours est le lieu où se trouvent tous les éléments pour comprendre le contexte d’un énoncé, car toute parole est située. « On ne peut comprendre les questions, les plus profondes comme les plus superficielles, que lorsqu’elles ont été placées dans leur milieu naturel. (Ce qui rend profond un énoncé ou une question, ce n’est pas son lieu mais son moment) » (p.41). Ce que l’on demande de prendre en compte, ce n’est pas un contexte général, mais ce contexte d’énonciation. C’est ce qui donne son sens aux mots que nous employons et c’est ce que nous recherchons. Selon Cavell, Kierkegaard nomme cela une « dialectique qualitative » :
« D’une façon très générale, l’examen dialectique d’un concept montrera comment la signification de ce concept change, et comment le sujet dont il est le concept change, quand change le contexte dans lequel il est utilisé : la signification dialectique est l’histoire ou la confrontation de ces différences. Par exemple, un examen du concept de silence montrera que le mot signifie des choses différentes – que le silence est des choses différentes – selon que le contexte est le silence de la nature, le silence de la timidité, le silence du menteur ou de l’hypocrite, le bref silence de l’homme incapable de tenir sa langue, le long silence du héros ou de l’apôtre, ou l’éternel silence du Chevalier de la Foi »[5].
La situation de l’énonciation – son occasion – nous éclaire sur ce point, en ce sens qu’elle caractérise plus fermement le contexte (elle en limite l’étendue). Par situation, j’entends quelque chose d’assez général qui comprendrait l’idée des circonstances (appropriées ou non) d’une énonciation, la position du sujet (s’il est autorisé ou non – s’il est en mesure de – proférer cette énonciation), ou encore les modalités spécifiques d’énonciation, ou pourrait-on dire sa « coloration » (son ton par exemple). Cette notion de situation a, entre autres, la vertu d’être dite limitée et par conséquent permet de parer l’accusation d’inintelligibilité pour cause de caractère illimité ou illimitable… Il est possible de caractériser un énoncé dans son contexte propre, et tout l’enjeu ici est de savoir ce que c’est, ou comment, caractériser un énoncé correctement (de manière satisfaisante). C’est là un moment crucial quant à la légitimité des résultats de la philosophie du langage ordinaire. D’une certaine manière, c’est ce qui autorise Mates à porter sa critique contre la généralisation de Ryle.
Une partie du problème soulevé par Mates dans sa critique de Ryle repose en fait sur une caractérisation insuffisante du terme « volontaire » :
Son erreur consiste à caractériser ces actions de manière incomplète, et à caractériser de manière erronée les actions pour lesquelles la question ne peut pas se poser. […] Faute de voir que la condition d’application du terme «volontaire» vaut de manière très générale – à savoir, la condition qu’il y ait quelque chose (réel ou imaginaire) de douteux dans tout acte qu’on qualifiera de manière intelligible de ce terme – Ryle donne une acception trop étroite à la condition, il suppose qu’il doit y avoir quelque chose de moralement douteux dans l’acte (pp. 6-7).
Il est fondamental de comprendre que nous ne pouvons pas toujours dire d’actions qu’elles sont volontaires, même quand il est évident qu’elles ne sont pas non plus involontaires ; c’est seulement en vue de leur contexte (des circonstances extraordinaires où elle s’est déroulée par exemple) que l’on peut diagnostiquer qu’une action a été faite volontairement ou non. Or la généralisation de Ryle faute sur ce point. La dichotomie volontaire-involontaire est en fait une asymétrie. « Volontaire ou pas ? » ne signifie pas « volontaire ou involontaire ». On peut opposer à « volontairement », « sous la contrainte » par exemple. C’est pourquoi on ne peut pas se contenter de cette dichotomie, qui dissimule les cas où se demander si l’action est volontaire ou pas n’a en réalité aucun sens. C’est seulement quand quelque chose paraît inapproprié (dans ces circonstances) que l’on perçoit le fonctionnement « normal » d’une action. D’où l’importance primordiale de l’étude des excuses chez Austin, parce que
Étudier les excuses, c’est étudier les cas où il s’est produit quelque anomalie ou échec ; et, comme c’est si souvent le cas, l’anormal met au jour ce qui est normal, et nous aide à déchirer le voile aveuglant de la facilité et de l’évidence qui dissimulent les mécanismes de l’acte naturel et réussi[6].
Il nous faut ici remarquer deux points concernant notre propos général : (1) il nous faut toujours être extrêmement attentif dans le déroulement des procédures du langage ordinaire afin d’éviter ce type d’erreur ; et (2) cette erreur souligne la situation précaire de la philosophie du langage ordinaire, qui se trouve toujours – intrinsèquement d’une certaine manière – exposée à la critique, et à son propre dépassement par cette critique (qui peut aussi être une autocritique). Quoiqu’il en soit, il n’en reste pas moins que cette notion est aussi difficile qu’elle est complexe ; toutefois l’accusation portée par Mates n’est justement pas fondée. C’est pourquoi on peut reprendre la remarque de Cavell soulignant que : « Quand il nous recommande d’ignorer le contexte afin de produire des “divisions provisoires” dans un sujet, et de démarrer une enquête, Mates recommande une mauvaise solution pour une bonne raison ». En effet, le projet de Mates est dirigé vers une recherche empirique sur le langage et la distinction qu’il préconise est la distinction classique (depuis C. Morris et R. Carnap) syntaxe-sémantique-pragmatique. Pour résumer cette partition, on peut dire que la sémantique interprète ce que la syntaxe a déjà assemblé et que la pragmatique ajuste l’interprétation à l’usage que l’on veut faire du langage.
Austin refuse ce genre de distinction qui nous conduit en fin de compte à envisager la signification en termes de cognitivisme et d’émotivisme. C’est pourquoi Cavell, dans cette lignée, soutient que :
Le philosophe qui part du langage ordinaire se préoccupe moins de dénoncer et de punir des crimes odieux contre l’intellect que de compenser, au civil, les dommages qu’il a subis ; de rétablir tout défaut d’équilibre, toute négligeable usurpation, dans l’esprit. Ceci demande inévitablement de réintroduire des idées qui sont devenues tyranniques (par exemple l’existence, l’obligation, la certitude, l’identité, la réalité, la vérité…) dans les contextes spécifiques de leur fonctionnement naturel (p.18).
Et dans la foulée, il reprend à son compte le conseil austinien[7], « Il ne s’agit pas ici de retailler des idées trop grandes pour leur faire retrouver leur format adéquat, mais de leur donner l’espace exact dans lequel elles peuvent se déplacer sans avoir d’effet corrupteur ».
Après ce détour nécessaire par la notion de contexte, il convient de revenir au plus près de la richesse du texte cavellien, afin de mieux comprendre sur quoi se fondent les procédures du langage ordinaire. C’est dans le conflit entre Austin et Ryle que réside la « base du scepticisme » de Mates : si deux membres d’une même « école » ne trouvent pas d’accord sur un point aussi fondamental, cela jette un discrédit sur l’ensemble de leur démarche, qui s’en trouve alors infondée. C’est pourquoi Cavell cherche à montrer la légitimité de la démarche (et des procédures) ordinaire(s) en la fondant.
La critique de la critique : vérification empirique vs «nous-même».
Mates opère une critique analytique classique – l’accusation de non-vérifiabilité empirique – et s’appuie pour cela sur le conflit entre Ryle et Austin sur l’usage de « volontaire » et « involontaire » appliqué à certains types d’énoncés. Mais pour comprendre pourquoi Cavell souligne que « Mates se soucie moins de critiquer spécifiquement certains des résultats des philosophes d’Oxford que de mettre en cause les procédures qui ont amené ces philosophes à les revendiquer (en particulier, il met en doute qu’ils aient réuni le genre de preuves que demandent leurs “déclarations sur le langage ordinaire”) » ( p.2), il est nécessaire de présenter la divergence entre Austin et Ryle, avant de questionner le fondement de leurs procédures.
Pour Ryle comme pour Austin, le problème de « volontaire » ne doit pas s’articuler autour du partage entre physique et mental. En revanche, les deux philosophes ne sont pas d’accords sur l’usage de « volontaire », ou plutôt sur la distinction entre « volontaire » et « involontaire ». Pour Ryle,
« Malgré quelques extensions de sens, les adjectifs “volontaire” et “involontaire” sont, dans l’usage courant appliqués à des actions qui n’auraient pas dû être faites. Nous ne discutons du caractère volontaire de l’action que lorsqu’il semble qu’elle soit au discrédit de l’agent. (…) Il est absurde de discuter, dans l’usage courant, du point de savoir si des activités satisfaisantes, correctes ou admirables, sont ou non volontaires. (…) Mais les philosophes, lorsqu’ils discutent des actions volontaires ou involontaires, sont enclins à décrire comme volontaires les actions méritoires aussi bien que les actions répréhensibles, ce qui est à porter au crédit de l’agent, tout comme ce qui est de sa faute »[8].
Or, quand il expose l’asymétrie entre « volontaire » et « involontaire »[9], Austin entre en conflit avec ce que Ryle présente. Pour Austin la phrase « faire un cadeau volontairement » est sensée c’est-à-dire que nous ne sous-entendons pas par là que « l’action de faire le cadeau est une action qui n’aurait pas dû être faite, ou qui était de la faute de quelqu’un ».
Pour éclairer le foyer conflictuel, Cavell propose une « classification » des types (idéaux) d’énoncés produits par les philosophes du langage ordinaire. Tout d’abord (1) les énoncés qui produisent des exemples de ce qui se dit dans un langage (illustré par «Nous disons bien… mais nous ne disons pas…») ; puis (2) des énoncés qui explicitent ce qui est sous-entendu quand nous disons ce que nous disons quand nous nous référons aux exemples des énoncés (1) (par exemple : « Quand nous disons… nous sous-entendons (suggérons, voulons dire)…» ) ; et (3) il y a des généralisations, que nous pouvons tester par référence aux énoncés des deux premiers types. Cette classification montre de quelle manière on peut sortir de l’orbite de la critique traditionnelle de non-vérifiabilité.
Le point problématique que soulève Mates se concentre en fait sur les deux premiers types d’énoncés. Le type d’énoncés que produit Ryle (ceux relevés par Mates pour illustrer le point conflictuel) est de l’ordre du troisième type (nécessitant d’être testé en référence aux deux premiers types), or l’exemple d’Austin fait échouer le test de la généralisation de Ryle. Cette erreur est ce qui permet à Mates de conclure que « Ryle est dépourvu de preuves – ou en tout cas sans preuves qui soient très bonnes – parce qu’il n’est pas en position de produire un énoncé du premier type (un énoncé qui présente un exemple de ce que nous disons) en l’absence d’études expérimentales qui démontrent son occurrence dans le langage »[10]. Néanmoins, son erreur « peut indiquer seulement qu’il s’est trop pressé d’accepter une généralisation, et pas qu’il est dépourvu de (bonnes) preuves qui la soutiennent ».
À la question « Sur quoi (ou plutôt qui) se fonde le philosophe pour produire les énoncés que nous disons d’ordinaire ? », Cavell répond :
Pour voir que cette objection, prise au sens général dans lequel Mates l’avance est dépourvue de fondement, nous devons garder à l’esprit le fait que ces énoncés – des énoncés qui déclarent que l’on dit quelque chose en anglais – sont produits par des locuteurs dont l’anglais est la langue maternelle. En général, de tels locuteurs n’ont pas besoin de preuves de ce qui se dit dans la langue ; ils sont eux-mêmes la source de telles preuves. […] Le locuteur qui parle dans sa langue maternelle peut se fier à sa propre tête […] il n’y a rien là qui rende globalement suspectes les données ainsi recueillies[11].
C’est au locuteur qu’incombe la responsabilité du fondement de ce qui est dit, c’est-à-dire que nous ne pouvons nous référer qu’à nous-même (membre d’une communauté linguistique – naturelle – dans laquelle nous nous comprenons, nous nous accordons avec les autres, sans quoi toute communication serait tout simplement impossible) pour dire ce que nous disons d’ordinaire. Nous n’avons pas besoin de faire un sondage d’opinion pour savoir, dans telle situation précise, dans ces circonstances, dans ce contexte-là, ce que nous disons ordinairement. Utiliser sa langue maternelle – pour converser avec d’autres, ou pour comprendre le monde, ou pour penser par nous-mêmes – veut dire savoir quelles formes sont normatives, et dans quels contextes il faut les mobiliser, pour accomplir ce que nous accomplissons en faisant usage du langage.
Pour produire le premier type d’énoncés (exemple), on ne se fonde pas sur l’affirmation que «[nous avons] déjà amassé […] une formidable quantité d’information empirique sur l’usage de [notre] langue maternelle »[12]. Et il n’est pas non plus question de « faire appel à une mémoire infaillible » par exemple, pour dire que nous sommes fondés à produire des exemples : « pour dire ce qui se dit et quand dans des circonstances ordinaires, un locuteur parlant dans sa langue maternelle n’a pas besoin d’aucune information particulière de ce genre, et n’en revendique aucune. Tout ce dont on a besoin, c’est que soit vraie la proposition qu’une langue naturelle est ce que parlent des locuteurs dont cette langue est la langue maternelle » (MWM, p.5), car nous nous accordons dans le langage et ce, naturellement. C’est pourquoi les philosophes sont tout autant autorisés à produire des énoncés du premier type que du deuxième, c’est-à-dire qu’ils peuvent prétendre à dire à la fois ce que nous disons ordinairement, mais aussi ce que nous (devrions) voulons dire quand nous le disons. Pour parachever cette critique de l’accusation de non-vérifiabilité empirique et estimer ce second « volet », la raison pour laquelle nous sommes autorisés à produire des énoncés des deux types, il me semble approprié de montrer parallèlement quel « type d’affirmation » produit le philosophe du langage ordinaire.
Delphine Dubs
[1] Cavell, Un Ton pour la philosophie, op. cit., p.35. Il met en doute qu’Austin et Ryle aient réuni le genre de preuves que requièrent leurs « déclarations sur le langage ordinaire ».
[2] Cavell, « Must We Mean What We Say? » [MWM], op.cit., p.2, je souligne. (Toutes les références dans le texte renvoient à la pagination de la version originale de l’article)
[3] Cavell, Un Ton pour la philosophie, op. cit., p.94.
[4] Benson Mates, op. cit., p. 71.
[5] Cavell, « Kierkegaard : le livre sur Adler », op.cit., pp. 169-170.
[6] Austin, « Plaidoyer pour les excuses », op. cit., p.141, je souligne.
[7] « Be your size ».
[8] Ryle, La notion d’esprit, op.cit., pp.149-150, je souligne.
[9] Austin, « Plaidoyer pour les excuses »,op. cit., en particulier pp. 153-156.
[10] Cavell, « Must We Mean What We Say? », op.cit., p.4.
[11] Ibid. (je souligne).
[12] Mates, op. cit., p.68.


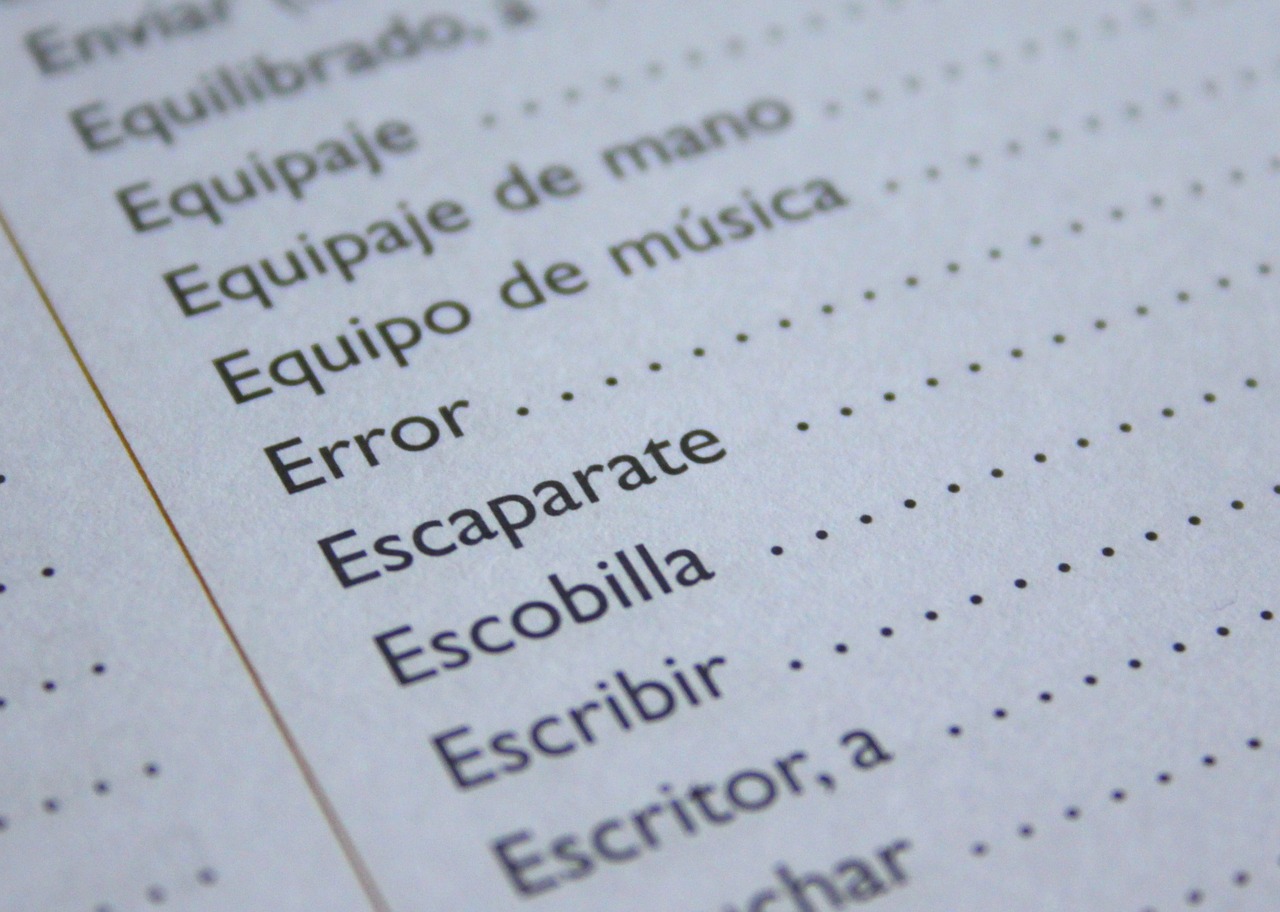





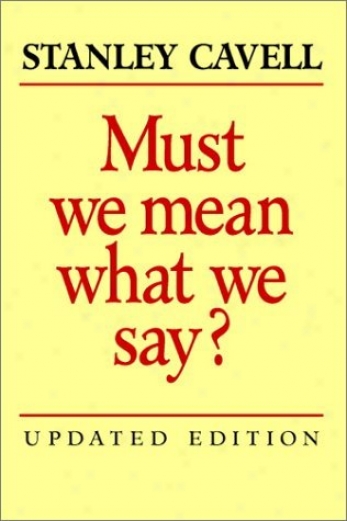

Merci pour cet excellent résumé. Néanmoins, je ne parviens pas à ne pas m’étonner devant le fait que Cavell semble obstinément ignorer la plupart des recherches et des découvertes faites en linguistique dans les trentes dernières années. Et en particulier :
-> La distinction entre sémantique et pragmatique, maintes fois confirmées expérimentalement, et qui rend caducs les arguments à base de « on utilise ce mot dans les contextes x et y, donc le mot n’a pas de sens en-dehors des contextes x et y »
-> Le fait plusieurs fois observés que tant les linguistes que les philosophes du langage peuvent être en désaccord (et se tromper) sur la façon dont est utilisée un terme.
Est-ce que cette ignorance est volontaire ? A-t-il un argument massue pour dire que toutes ces recherches n’ont aucun intérêt ?
Cher Florian,
Merci d’ouvrir la discussion!
Ce premier article de Cavell (le premier de sa carrière philosophique) est une conférence qu’il a prononcé en présence d’Austin lors de la réunion de l’Association Américaine de Philosophie de décembre 1957. Il s’agit donc d’un dinosaure, incomparable avec ce qui a pu etre porduit ces trente dernières années…
Par la suite, Cavell ne s’est pas replongé sur ce genre de question.Donc il ne s’agit pas « d’ignorance est volontaire », ni « argument massue pour dire que toutes ces recherches n’ont aucun intérêt » chez Cavell.
Le contexte de cet article fait qu’il a un ton qui se veut assez polémique (tout comme « Existalism and analytical philosophy » écrit durant la même période), mais tout le point de Cavell est d’attirer l’attention sur le fait que le langage est performance. On ne trouve plus vraiment dans la suite de son œuvre des papiers de cette facture.
En revanche d’un point de vue personnel, je veux bien que tu m’indiques quelques bonnes références sur les dernières avancées concernant la distinction entre sémantique et pragmatique !
amicalement,
1957 -> Ah oui, effectivement, ma remarque est légèrement anachronique. Rien à dire, donc, la situation n’était effectivement pas la même à l’époque, et la distinction sémantique/pragmatique beaucoup moins opérationnalisée et étudiée empiriquement. Merci.
Pour les références, je regroupe ça (ce n’est pas ma spécialité) et je te les fais parvenir.