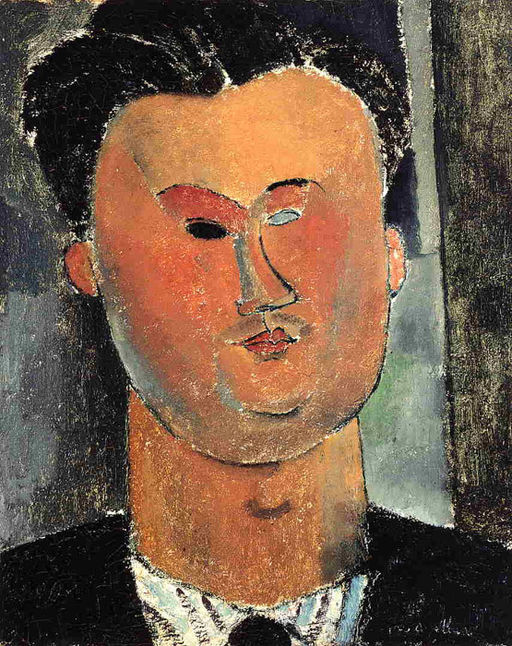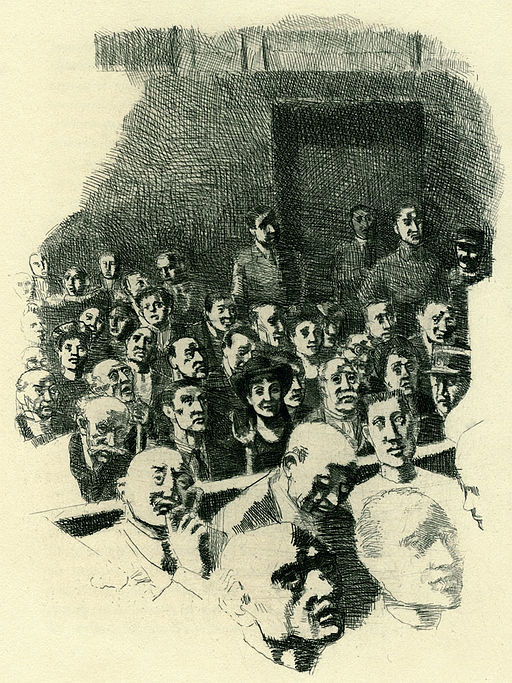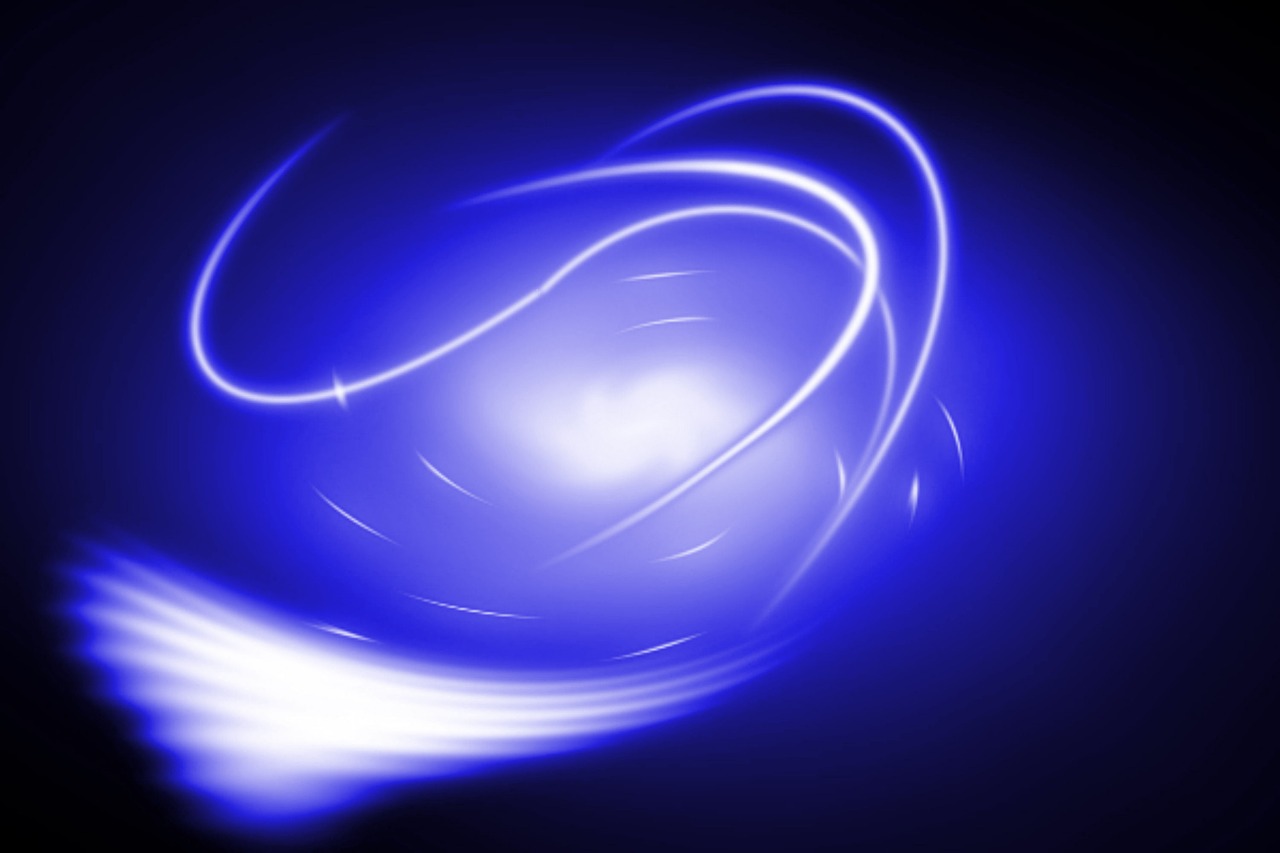Le surnaturel au service de la raison. Lecture « quantique » de trois récits fantastiques de Julio Cortázar
Anouck Linck, Maître de conférences à l’Université de Caen Basse-Normandie, docteur en littérature hispano-américaine.
Résumé : Julio Cortázar, dans son essai Le tour du jour en quatre-vingts mondes [1964], relie ce qu’il appelle le « sentiment de l’absurde » à une expérience de décentrement ontologique provoquée par la prise en compte, depuis notre univers familier, de vérités contre-intuitives et scandaleuses (du point de vue du sens commun) issues des sciences physiques (physique quantique et relativité einsteinienne). Cet article s’intéresse aux manifestations du sentiment de l’absurde sur le plan littéraire, en mettant à jour des résonances implicites fortes de la physique quantique dans trois nouvelles fantastiques célèbres de Julio Cortázar.
Abstract: In his essay Around the Day in Eighty Worlds (1964), Julio Cortazar connects what he calls “the feeling of absurdity” to an experience of ontological shift caused by outrageous and counter-intuitive truths (for the common sense) coming from physical science (quantum and Einstein relativity), taken into account from our familiar world. This article deals with the expression of the feeling of absurdity in literature, revealing strong implicit resonance of quantum physics in three famous fantasy short stories by Julio Cortazar.
« À quoi bon la vaporeuse métaphysique, alors que nous [avons] sous la main la physique palpable[1] ? » demande l’écrivain argentin Julio Cortázar dans son essai Le tour du jour en quatre-vingts mondes. En matière de questionnements ontologiques, rien ne vaut en effet un petit détour par la physique quantique ! « Au XXe siècle rien ne peut mieux nous guérir de l’anthropocentrisme auteur de tous nos maux que de se pencher sur la physique de l’infiniment grand (ou de l’infiniment petit)[2]. » L’intérêt que Cortázar portait aux choses de la physique influe sur la production de ses textes, mais la fécondation s’opère à distance toujours. Certaines de ses nouvelles fantastiques entretiennent des résonances implicites mais fortes avec des préceptes parmi les plus spectaculaires de la physique quantique. Nous avons choisi trois textes fantastiques particulièrement représentatifs : « La lointaine » (Bestiaire [1951]), « Axolotl » (Fin d’un jeu [1962]) et « L’île à midi » (Tous les feux le feu [1966]) et nous les avons lus sous l’éclairage de la physique quantique, essentiellement en nous appuyant sur des conférences de divulgation proposées par des physiciens qui sont aussi des épistémologues : Philippe Grangier, Alain Aspect, Roland Lehoucq, Étienne Klein. Nous verrons que le surnaturel à l’œuvre dans chacune de ces histoires peut être interprété comme la transposition, sur le plan littéraire, d’effets quantiques particuliers : successivement intrication quantique, effet tunnel et dualité matière/antimatière. Cette fonction que lui attribue la lecture « quantique » est nouvelle et assez paradoxale. Le surnaturel devient support et agent de rationalité, ce sur quoi se fonde une compréhension complexifiée du monde fictionnel, et non plus – comme on le conçoit habituellement – une entrave à la rationalité ou la preuve flagrante de ses limitations. L’effet fantastique à l’œuvre dans les textes se trouve modifié en substance : il s’éprouve sur le mode du « sentiment de l’absurde » au sens non trivial du terme qui est celui de Cortázar.
Le sentiment de l’absurde
L’avénement de la physique quantique, qui se constitua en théorie en 1927, date à laquelle Niels Bohr formule son célèbre principe de complémentarité, et Werner Heisenberg le non moins célèbre principe d’indétermination, est « la plus grande aventure intellectuelle du XXe siècle[3] » selon le physicien Philippe Grangier. Pour lui son impact est plus grand « que la relativité, que le marxisme, que la psychanalyse[4] ». La mécanique quantique est en effet le cadre de toute notre compréhension de l’univers physique, elle explique la stabilité de la matière, la nature de la lumière, les interactions de la matière et de la lumière. Ajoutons également que la réalité qui est la nôtre aujourd’hui n’existerait pas, si la révolution quantique n’avait vu le jour : elle est à la base de toute l’électronique et l’informatique actuelles, on lui doit aussi les développements récents de la médecine et de la chimie (laser). Mais cette théorie aux « idées bizarres », comme disait d’elle le physicien nord-américain Richard Feynman, implique que l’on renonce « aux idées et aux idéaux traditionnels concernant la causalité et la réalité dans la nature[5]. » Elle ressemble à ces monstres qu’engendre au cours des siècles l’évolution de la pensée. Elle contredit de plein fouet les situations concrètes et quotidiennes de notre univers familier. Et on n’est pas forcément prêt à se départir du bon vieux sens commun, même au nom de vérités supérieures. La physique quantique dit des choses que l’on n’arrive de prime abord tout simplement pas à croire, que l’on n’accepte pas, que l’on n’aime pas.
En insistant sur la « contextualité » des phénomènes microphysiques, la dimension métaphorique des « mots adaptés aux images de la physique classique » et la nécessité d’attribuer à l’« objet quantique » des prédicats contradictoires, Bohr touche un point très sensible, dans la mesure où il remet de facto en question deux postulats de la philosophie rationaliste qui semblaient inébranlables : (a) l’intelligibilité du réel en fonction des catégories kantiennes de la connaissance (causalité, subsistance, unité/pluralité etc.) ; (b) l’obligation de décrire les « objets » en fonction d’une logique non contradictoire, du type aristotélicien[6].
Les scientifiques non plus ne sont pas immunes à l’étrangeté de la physique quantique. Le mathématicien René Thom n’hésitait pas à taxer cette dernière de « scandale intellectuel du siècle[7]. » La théorie quantique a ceci de particulier qu’elle amène à admettre l’existence d’une réalité « inaccessible à la perception sensible directe, mais saisissable par la symbolique mathématique[8]. » Le physicien français Alain Aspect admettait récemment ne connaître « aucun moyen de faire une véritable correspondance entre [les] objets mathématiques de la physique quantique et ce que nous avons dans l’espace réel[9]. » Mais ce qui est important, remarque Feynman, « c’est que la théorie (…) permette des prédictions qui sont en accord avec l’expérience. » Et il ajoute, un brin provocateur, à l’adresse d’un public de non-spécialistes : « J’espère donc que vous accepterez la Nature telle qu’elle est : absurde[10]. »
Pour Julio Cortázar, les avancées de la science au XXe siècle donnent un fondement solide et concret au sentiment de l’absurde « au moyen duquel on se définit et on définit le monde ». L’homme du XIXe siècle pouvait encore étouffer ce sentiment en se réfugiant dans la métaphysique ; mais le siècle présent nous incite à l’accepter « comme l’avènement naturel d’une réalité inconcevable » :
Le premier texte de vulgarisation scientifique nous fait recouvrer prestement le sentiment de l’absurde, mais, cette fois, c’est un sentiment à portée de la main, né de choses tangibles et démontrables, presque consolant. Il ne faut pas croire parce que c’est absurde, mais c’est absurde parce qu’il faut y croire[11].
Dans les années 1920 la raison relativiste et complexifiée fait sauter le « cadre étroit[12] » du rationalisme antérieur et plonge la physique dans une véritable crise de mots. L’éventualité d’une contradiction ne l’horrifie pas, elle se montre réceptive à ce qu’aucun langage ne saurait formuler, et résiste à la perte angoissante des fondements. Le sentiment de l’absurde, tel que le conçoit Cortázar dans son essai paru quarante ans plus tard, décrit les effets induits par la prise en compte, depuis notre condition d’être humain dans le monde, de cette extension des limites de la raison :
Je veux dire qu’un clair sentiment de l’absurde nous situe mieux ou plus lucidement que l’assurance d’origine kantienne selon laquelle les phénomènes sont les médiatisations d’une réalité inaccessible mais qui, de toute façon, les garantit un an contre tout risque de rupture[13].
Julio Cortázar est, comme chacun sait, un maître incontesté de la littérature fantastique. Mais il n’est guère fait allusion, dans ses nouvelles fantastiques, à la physique des particules dont les résultats le fascinaient si visiblement. Littérature et science restent chacune à la place qui est la leur. Les trois nouvelles que nous allons analyser sous l’éclairage de la physique quantique deviennent néanmoins le lieu d’une synthèse culturelle qui les dépasse. Cette lecture n’est pas sans conséquences.
La lointaine
On pourrait dire de la nouvelle fantastique intitulée « La lointaine »[14] qu’elle transpose – avec la liberté d’imagination qui est la prérogative indiscutable de toute fiction, et toujours selon les modalités propres au genre – un état d’intrication quantique.
Le récit se décompose en deux parties. La première partie reproduit des fragments du journal intime tenu par Alina Reyes du 12 janvier au 7 février, quelque temps avant son mariage ; dans la deuxième partie, plus brève (quatre paragraphes), un narrateur hétérodiégétique prend le relais, et raconte la suite de l’histoire en focalisant sur un événement ayant lieu le 7 avril, « deux mois avant son divorce ». Alina Reyes porte bien son nom, et semble – comme on dit – avoir tout pour être heureuse : jeunesse, joie de vivre, amour et beauté. Mais quand on parcourt les pages de son journal intime, on la découvre rongée par une sourde inquiétude. « Alina Reyes, c’est la reine et… ». L’anagramme est « horrible » – et pour cause :
il ouvre un chemin à celle qui n’est pas la reine et que de nouveau, la nuit, je hais. À celle qui est Alina Reyes mais non pas la reine de l’anagramme, qui peut être tout ce qu’on veut, mendiante à Budapest, pensionnaire d’un bordel à Jujuy, où servante à Quetzaltenango, n’importe où, loin, en tous cas, de la reine[15].
« Je ne peux, [confesse Alina], que la haïr de toutes mes forces » ; « cela me désespère »[16]. Alina Reyes, jeune femme de vingt-sept ans, entourée, adulée et aimée, et « la lointaine », malheureuse indigente, battue, transie, errant quelque part dans Budapest, sont – les pages du journal en témoignent – indissolublement liées.
Nulle corrélation entre la vie des deux femmes, et pourtant, la destinée de « la lointaine » se répercute immédiatement sur celle d’Alina – « quelque part dans le monde je traverse un pont au moment même (mais je ne sais pas si c’est au moment même)[17]. » Elles ont beau être très éloignées l’une de l’autre, elles n’en forment pas moins une seule et même entité, aucune n’étant complètement « maîtresse » de sa destinée. La conscience pénible de cette non-séparabilité, qui lie indissolublement Alina à l’autre, la part maudite et haïssable, imprègne l’ensemble de son journal. La fluctuation permanente entre la première et la troisième personne illustre, dans les extraits suivants, cette étrange unité :
« c’est moi et on la bat » ; « c’était à l’autre qu’il arrivait quelque chose, à moi si loin » ; « c’est la part de moi que l’on n’aime pas, et comment ne pas être déchirée quand je sens qu’on me bat ou que la neige entre dans mes souliers ». « Ce n’est pas que je sente quoi que ce soit », précise Alina, qui reste ce qu’elle est, tout en étant fortement corrélée à l’autre, « là-bas »[18].
On peut douter de l’intrication des deux femmes, la mettre tout entière sur le compte d’une maladie mentale d’Alina : « le célibat me pesait, tout simplement ; vingt-sept ans et pas d’homme[19]. » Mais comment expliquer alors les bribes de hongrois dans le texte, les noms de rues inconnues, et surtout, la rencontre sur le pont à Budapest, narrée par un narrateur hétérodiégétique, peu suspect de troubles de la personnalité ? L’intrication est donc, à défaut d’être certaine, du moins l’hypothèse la plus « raisonnable ».
« Assez pensé, vivons, vivons enfin et que tout soit pour le mieux[20]. » Qu’importe l’origine de cet état, l’important est d’y mettre fin, il est par trop pénible. Alina Reyes joue résolument sur les deux tableaux : guérir à la fois par le mariage et en allant à la rencontre, minutieusement projetée, de la « lointaine » :
Sur le pont je la trouverai et nous nous regarderons. Et ce sera la victoire de la reine sur cette adhérence maligne, cette usurpation indue et sourde. Si je suis vraiment moi, elle s’inclinera et fondra dans ma lumière ; il suffira que je m’approche et que je pose ma main sur son épaule[21].
La fin, nous la connaissons. L’étreinte passionnée des deux femmes trompe les attentes et l’espoir de la candide Alina. Alina Reyes, définitivement jouée, instigatrice involontaire de sa propre destitution, est condamnée à habiter le corps de l’autre, et à voir l’autre usurper froidement le sien – « Alina Reyes, ravissante dans son tailleur bleu, repartait vers la place, les cheveux défaits par le vent, repartait sans retourner la tête. »
Ce final est digne d’un conte fantastique, sans compter qu’il réinvestit les motifs traditionnels (dédoublement, ubiquité, transmutation des corps). Effectuer une lecture « quantique » revient à accepter le surnaturel – l’intrication et l’inversion des rôles – mais l’effet déstabilisateur de ce dernier ne se dilue pas pour autant, au contraire. L’intrication est un phénomène avéré, scientifiquement prouvé et certainement très étrange. Il n’est pas étonnant qu’il entre en résonance avec le fantastique, un genre littéraire qui s’intéresse de près à toute figuration raisonnée de l’étrange, voire de l’impossible.
La mécanique quantique « décrit des objets globaux qui sont corrélés, mais les corrélations ne sont pas portées par des propriétés locales des deux particules[22]. » Alina et « la lointaine », dans la mesure où elles figurent, à un niveau macroscopique, deux particules intriquées, forment comme ces dernières un objet « global ». Les corrélations – les mots hongrois, ou la sensation de froid en plein mois de janvier à Buenos Aires, par exemple – ne sont pas portées par des propriétés locales – le contexte où évolue Alina Reyes ne s’y prête guère – mais font partie des propriétés de l’ensemble qu’elle forme avec « la lointaine ». « Il faut abandonner cette notion de réalité physique locale[23] », insiste Grangier, à propos de l’intrication, et c’est bien ce que le surnaturel nous force à faire dans ce texte. En vertu de ce parallèle, le surnaturel figure une vérité contre-intuitive, et non une contre-vérité. Une lecture quantique, on le voit, demande une certaine hardiesse, mais fait du fantastique l’allié de la raison. Une dernière précision s’impose. Pour qu’il y ait intrication, explique Grangier, il faut nécessairement que les deux particules aient interagi par le passé. Le physicien et philosophe Étienne Klein dit la même chose, d’une façon plus romantique : « Deux cœurs qui ont interagi dans le passé ne peuvent plus être considérés de la même manière que s’ils ne s’étaient jamais rencontrés. Marqués à jamais par leur rencontre, ils forment un tout inséparabl[24]. » Le fantastique se fait un malin plaisir d’inverser ce processus et de pervertir la belle image de Klein. La rencontre entre les deux femmes a lieu à la fin et non au début ; par ailleurs le sentiment qui les unit, malgré « une brusque et nécessaire tendresse » qui envahit par moments Alina, tient davantage de la haine (« qu’elle souffre, qu’elle gèle » « je ne peux que la haïr ») que de l’amour.
Axolotl
Un autre texte parmi les plus célèbres de Cortázar pourrait se prêter, lui aussi, à une lecture « quantique ». Il s’agit de « Axolotl »[25], qu’on peut lire comme la figuration d’une autre propriété très étrange de la matière au niveau subatomique, connue sous le nom d’« effet tunnel ». L’histoire est très simple, le premier paragraphe du texte la résume en trois phrases :
« Il fut une époque où je pensais beaucoup aux axolotls. J’allais les voir à l’aquarium du Jardin des Plantes et je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leurs mouvements obscurs. Et maintenant je suis un axolotl[26]. »
La narration, en revanche, est autrement plus complexe. Au moment de l’énonciation, la métamorphose est accomplie, les faits sont donc narrés au passé. Mais les « faits » consistent davantage en pensées et rêveries qu’en actions ; le personnage est rivé à la vitre de l’aquarium, parfaitement immobile, plongé dans la contemplation intensive des axolotl. Les pensées du narrateur interfèrent avec celles de l’homme qu’il était et cet effet de brouillage continuel rend floue et incertaine son identité présente ; en même temps, comme il fait constamment allusion à cette identité, il prépare le lecteur à accueillir avec une relative sérénité l’annonce de l’improbable métamorphose.
Pour Daniel Grojnowski, la stratégie d’écriture mise en place consiste à créer ce qu’il nomme une « transformation par incantation » :
La répétition obsédante du mot titre avère la transformation fantastique. Fasciné par les larves, le narrateur fixe son regard sur leurs yeux : son reflet dans la vitre de l’aquarium l’absorbe, et il se voit alors de l’autre côté, hors de l’aquarium. La succession et l’association des deux champs lexicaux exploités intensivement est l’un des vecteurs de la transformation par incantation : d’autant que le signifiant axOlOtl (ajOlOte) comporte les deux O O qui simulent le regard hypnotique! Exprimés page après page dans chaque développement, ces deux champs lexicaux structurent l’ensemble de la nouvelle, à force de redites et d’interférences[27].
Une rapide recherche par mots-clés met en évidence l’exploitation intensive des champs lexicaux signalés par Grojnowski :
– Occurrences du mot « axolotl » : 28
– Occurrences de formes conjuguées de « mirar » (regarder) : 14
– Occurrences de formes conjuguées de « ver » (voir): 14
– Occurrences du mot « ojo » (œil) : 16
– Occurrences du mot « oro » (or) associé au précédent : 7
La transformation par incantation relève de la magie. Si l’on envisage les choses sous l’éclairage de la physique quantique, la transformation n’est pas « magique » mais, aussi bizarre que cela paraisse à première vue, tout à fait « logique », grâce à l’effet tunnel, et les procédés d’écriture identifiés par Grojnowski se prêtent également à cette autre interprétation.
Qu’est-ce que l’effet tunnel ? C’est l’effet par lequel, explique l’astrophysicien Roland Lehoucq, on peut « dans le monde microscopique – et seulement dans le monde microscopique (…) – franchir spontanément une barrière de potentiel avec des probabilités faibles mais non nulles[28]. » Prenons l’exemple de deux protons, dit Lehoucq. Étant tous deux chargés positivement, ils se repoussent ; on nomme cette répulsion « force coulombienne » ou « barrière de potentiel » car elle représente un obstacle en principe infranchissable. Les protons n’ont pas l’énergie suffisante pour le briser, mais grâce à l’effet tunnel, le proton incident a une chance de fusionner avec l’autre. Klein, lui, donne l’exemple d’une bille qui se proposerait de franchir une montagne. Elle n’a pas l’impulsion suffisante pour y parvenir, et pourtant elle se retrouve de l’autre côté.
La démonstration qu’un tel phénomène a beau figurer dans les premiers chapitres de tous les cours de physique quantique, elle est trop compliquée pour être rapportée sans équations. Nous ne l’évoquerons donc pas, nous contentant d’affirmer ici qu’une particule peut effectivement apparaître de l’autre côté d’une barrière d’énergie… qu’elle ne doit pas pouvoir franchir si l’on s’en tient aux seules lois de la physique classique. Tout se passe en définitive comme si cette barrière (la montagne) était percée d’un véritable tunnel au travers duquel la particule, après de multiples tentatives infructueuses, finit par passer[29].
Klein met son lecteur en garde : aucune analogie « ne saurait être érigée au rang de scénario fidèle à la réalité (aussi atomique soit-elle), car comme toujours en physique quantique les métaphores mènent rapidement à des contradictions[30]. » Ceci étant, l’homme du commun ne dispose que d’images et du langage de tous les jours, pour approcher ce phénomène incroyable. Les analogies ne sauraient être prises à la lettre, mais elles stimulent certainement la compréhension. En ce sens, il se pourrait que la lecture « quantique » du texte de Cortázar proposée ici puisse, elle aussi, servir de relais à la compréhension.
On peut interpréter les stratégies d’écriture mises à jour par Grojnowski comme autant d’efforts concentrés et désespérés, réitérés jour après jour inlassablement par le personnage, pour fusionner son regard avec celui d’un axolotl. « Leurs yeux surtout m’obsédaient », reconnaît le narrateur, « jamais je ne m’étais senti un rapport aussi étroit entre des animaux et moi », « loin d’eux je ne pouvais penser à autre chose, comme s’ils m’influençaient à distance »[31]. La force qui l’attire invariablement vers les axolotl est entravée par la paroi de l’aquarium, à laquelle il se heurte jour après jour, impuissant : « je collais mon visage à la vitre », « inutile de frapper du doigt contre la vitre ». La vitre dans la nouvelle de Cortázar figure « une barrière de potentiel » que le regard insistant du personnage s’acharne à percer. Les lois de la physique classique interdisent aussi bien de passer à travers un mur ou une montagne, qu’à travers la vitre épaisse d’un aquarium, à moins de la briser, mais la physique quantique, on le sait, « est plus libertaire[32]. » Le regard incident du personnage ne cesse de rebondir sur la barrière de potentiel, jusqu’au moment où, aidé par le jeu des probabilités et la multiplicité des tentatives, il finit par la traverser.
Je collai mon visage à la vitre de l’aquarium, mes yeux essayèrent une fois de plus de percer le mystère de ces yeux d’or sans iris et sans pupille. Je voyais de très près la tête d’un axolotl immobile contre la vitre. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre, à la place de l’axolotl, je vis mon visage contre la vitre, je le vis hors de l’aquarium, je le vis de l’autre côté de la vitre. Puis mon visage s’éloigna et je compris[33].
La lecture « quantique » nous fait appréhender la métamorphose du personnage comme étant le résultat d’un processus logique et non magique. La devise du fantastique – impossible et pourtant vrai – entre en résonance avec une vérité « incroyable » mais rationnelle. D’après cette lecture, le surnaturel est, une fois encore, l’allié de la raison.
La fantastique nous offre une transcription intéressante sur le plan fictionnel de l’effet tunnel, mais il nous l’offre à sa façon. Les axolotl, pour commencer, exerceront sur toute personne de bon sens un effet répulsif. Ils ont l’air parfaitement insensibles et sont plutôt inquiétants. « Les axolotls n’étaient pas des animaux », « parfois ils devenaient de terribles juges », « ces visages aztèques, inexpressifs, et cependant d’une cruauté implacable », « c’était des larves, mais larve veut dire masque et aussi fantôme », « ils me faisaient peur » : en eux revit un motif traditionnel de la littérature fantastique, celui du monstre. Ensuite, le personnage sert, une fois encore, de victime propitiatoire sur l’autel du genre. Une fois que la fusion tant désirée a eu lieu, il n’est plus question de revenir en arrière. Quand un noyau incident franchit une barrière de potentiel, il est soumis aux forces de cohésion qui collent ensemble les particules nucléaires. Il en va de même pour le personnage, dans sa relation avec les autres axolotl :
en me tournant un peu je vis un axolotl à côté de moi qui me regardait et je compris que lui aussi savait, sans communication possible mais si clairement. Ou bien j’étais encore en l’homme, ou bien nous pensions comme des êtres humains, incapables de nous exprimer, limités à l’éclat doré de nos yeux qui regardaient ce visage d’homme collé à la vitre[34].
Le destin du personnage est définitivement scellé. L’effet tunnel n’est pas reproductible à volonté. L’homme de l’autre côté se détache, s’en va, il ne revient plus. « Les ponts sont coupés à présent. » Le statut ambivalent du narrateur matérialise dans le texte toute l’horreur de sa condition : « prisonnier dans le corps d’un axolotl, transféré en lui avec [sa] pensée d’homme, enterré vivant[35]. » Quant aux continuelles immixtions du présent de l’énonciation, elles sont autant de contorsions inutiles de son triste soliloque. Comme s’il pouvait accrocher quelque chose du passé !
L’île à midi
Notre dernier exemple de lecture « quantique » dans l’œuvre de Cortázar est fourni par la nouvelle « L’île à midi »[36]. Le dédoublement de Marini, personnage principal, pourrait se lire comme la figuration, sur le plan fictionnel, d’une dualité particulièrement fascinante : celle de la matière et de l’antimatière.
Le mot « antimatière » semble tenir davantage de la science-fiction que d’une science exacte, et mérite par là-même qu’on prenne un peu le temps de le démystifier. L’histoire de l’antimatière commence en 1929, date à laquelle Dirac, en utilisant la théorie de la relativité d’Einstein jointe aux exigences de la théorie quantique, déduisit une formule pour l’énergie de l’électron qui admettait deux solutions, une positive et l’autre négative. La première correspondait à l’électron ; quant à la seconde, il eut été raisonnable de penser qu’il s’agissait simplement d’une bizarrerie mathématique sans contrepartie dans la nature. Mais « le génie de Dirac est précisément de n’avoir pas suivi cette voie[37]. » Plutôt que d’ignorer le résultat négatif, comme le recommandaient le bon sens et la grande majorité des physiciens, il se résolut finalement à l’interpréter comme correspondant à un « anti-électron », c’est-à-dire un électron négatif (on l’appelle aujourd’hui positron ou positon) qui serait en quelque sorte l’image de l’électron vu dans un miroir : une particule de même masse, même spin, etc. mais de charge opposée. L’histoire lui donna raison. Son étrange prédiction, basée sur des considérations purement théoriques (et esthétiques) fut confirmée un an après, un peu par hasard, par un jeune physicien expérimentateur nommé Carl Anderson. Aujourd’hui, autant que nous le sachions, toute particule possède une antiparticule. Les antiparticules sont des particules au même titre que les particules dont elles sont les « antis ». Précisons encore une chose : l’antimatière est stable quand elle isolée, mais si elle entre en contact avec la matière, toutes deux s’annihilent (en produisant de l’énergie émise sous forme de rayonnements gamma). Ainsi, aucun corps physique ne peut être composé d’un mélange stable de matière et d’antimatière.
Revenons, à présent, au texte de Cortázar. Si on transpose sur le plan macroscopique la dualité de la matière et de l’antimatière qui existe au niveau de la physique des particules, et qu’on lit le récit comme s’il était une adaptation libre de cette dualité, on a tôt fait de repérer l’« anti-Marini » qui figure, dans le texte, l’image inversée de Marini, personnage principal. L’opposition est trop explicite pour mériter d’être longuement développée. Contentons-nous d’en souligner ici quelques aspects relativement signifiants, avant de nous intéresser à la chute de la nouvelle.
Le nom du personnage principal, d’emblée, invite à la dissociation : les syllabes du début et la fin – Mar et ni – sont tenues à distance par l’action d’un conjonctif (le « i » en espagnol, homonyme du « y »). L’une préfigure l’homme abîmé dans la contemplation de la mer, et l’autre, du latin nec, porte en elle l’union et la négation, présage de l’annihilation à venir.
Le narrateur, hétérodiégétique, adopte une focalisation interne. La vie routinière de Marini, steward dans un avion, apparaît alors au lecteur telle qu’elle est aux yeux du personnage : creuse, « d’un ennui mortel ». Les autres – Carla (sa petite amie), son frère, ses compagnes de travail, les femmes de passage – interagissent avec lui sans laisser aucune empreinte, ils ont l’épaisseur des rêves, des ombres, leurs voix et leurs désirs propres ne signifient rien pour Marini. « Le temps passait en choses comme ça, en une infinité de plateaux de repas, chacun accompagné du sourire auquel avait droit le passager[38]. » Marini a perdu tout intérêt pour ce qui, avant, était plein de sens et de promesses, à en juger par l’enfant que Carla attendait de lui et la promotion dont il pourrait bénéficier dans son travail, et qu’il ne désire pas plus qu’il ne désire l’enfant. « Tout cela avait si peu d’importance à midi[39] » : collé au hublot de l’avion, étranger à tout et à tous, il s’abîme à cette heure dans la contemplation de son île, avec la complicité de Felisa « la seule qui le comprenait un peu[40] ». Au moment où s’ouvre le récit, Marini aspire en effet à une sorte d’authenticité indéfinie qui se matérialise trois fois par semaine sous la forme de l’éphémère vision d’une île grecque coupée du monde, « en marge des circuits touristiques »[41], immune au matérialisme extérieur et aux atteintes corrosives du temps, où habitent le patriarche Klaios et quelques pêcheurs. Mais « voler trois fois par semaine au-dessus de Xiros c’était aussi irréel que de rêver trois fois par semaine qu’il volait au-dessus de Xiros à midi[42] » : le monde hyper-connecté où évolue Marini, d’une ville à l’autre, d’une femme à l’autre, d’un plateau à l’autre, et celui, immobile et hors du temps, que figure « la tortue dorée » sous le soleil de midi, ne se touchent pas. L’île représente « cette autre réalité[43] » qui l’obsède et à laquelle il est totalement étranger, et qui ne se laisse pas posséder : « Il prit une photo de Xiros mais elle était floue[44]. »
Tout en doutant de jamais pouvoir mettre le pied sur l’île, Marini jour après jour s’absorbe dans la contemplation de « l’île petite et solitaire (…) rocheuse et déserte[45] ». On ne sait comment il se débrouille pour atteindre son but. Est-ce à force de rêver, de laisser dériver son imagination? Ou obéit-il brusquement à l’impulsion qui mûrit en lui depuis longtemps ? Le récit est ambigu sur ce point.
« Kalimmèra! » pensa-t-il absurdement. Cela n’avait pas de sens d’attendre plus longtemps, Mario Merolis lui prêterait l’argent qui lui manquait pour le voyage et en moins de trois jours il serait à Xiros. Les lèvres collées au hublot, il sourit en pensant qu’il grimperait jusqu’à la tache verte, qu’il entrerait nu dans la mer des calanques du nord, qu’il pêcherait des poulpes avec les hommes de l’île, en se faisant comprendre par des gestes et des rires. Rien n’était difficile une fois décidé, un train de nuit, un premier bateau, un autre bateau vieux et sale, l’escale à Rynos, la négociation interminable avec le patron de la felouque, la nuit sur le pont, collé aux étoiles, le goût de l’anis et du mouton, l’aube au milieu des îles. Il débarqua aux premières lueurs du jour et le capitaine le présenta à un vieux qui devait être le patriarche. Klaios le prit par la main gauche et lui parla lentement en le regardant dans les yeux[46].
Prenons d’abord le parti du rêve, optons pour croire que Marini fait comme si. Cette lecture éradique le surnaturel et sauve peut-être Marini de la mort, mais le rend-elle pour autant à la vie ? Rien n’est moins sûr. Dans l’avion, « les lèvres collées au hublot », Marini fabule, il imagine, au cours de sa « minute » de sursis, le périple à destination de l’île, son débarquement à l’aube, le regard franc de Klaios, annonciateur d’une vie nouvelle. Sa rêverie est si profonde et si vraie, que la narration verse dans un temps de l’actuel, passant du conditionnel au prétérit, comme on passe d’une somnolence rêveuse au sommeil profond. Si l’on interprète ainsi le texte, les événements qui constituent le climax du récit – l’avion coulant à pic, le sauvetage d’un homme, les cris du mourant pour le faire venir à soi – peuvent se lire comme la transmutation soudaine d’un rêve complaisant en horrible cauchemar. La vision de son propre corps agonisant, prélude de l’instant douloureux du réveil, annonce le retour brusque de Marini à la réalité, à sa destinée de songe-creux, de mort-vivant.
Mais on peut, aussi bien, prendre le récit à la lettre et croire en l’arrivée effective de Marini sur son île, ce qui implique alors d’accepter le dédoublement surnaturel du personnage. L’avantage de cette interprétation, c’est qu’elle préserve la séparabilité des deux mondes et rend possible la lecture « quantique ». Marini, « l’homme vieux », est perdu dans sa rêverie stérile, là-haut dans le ciel, tandis que le nouveau Marini, en osmose avec la terre nouvelle, ce petit coin de paradis miraculeusement préservé, amorce une existence en tout point opposée à l’ancienne. Les lieux et les temps sont divergents, ce qui accentue la séparabilité : la rêverie de Marini dans l’avion dure une minute, le séjour de Marini sur l’île Xiros plusieurs heures.
Quand il atteignit la tache verte, il entra dans un monde où l’odeur du thym et de la sauge, le feu du soleil et le vent de la mer n’étaient plus qu’une seule et même matière. Marini regarda sa montre puis, d’un geste agacé, il la fourra dans sa poche. Ça ne serait pas facile de tuer le vieil homme, mais ici en haut, tout tendu de soleil et d’espace, il sentit que l’entreprise était possible[47].
Les deux hommes sont identiques en apparence – même corps, même figure – mais sont porteurs de « charges » littéralement différentes. Marini est accablé par le travail et la superficialité de la vie qu’il mène, l’anti-Marini est libre, il redonne au mot « travail » son sens primitif, se soustrait à l’aliénation culturelle du langage, retrouve un centre, une volonté, un désir « il sut (…) sans la moindre hésitation qu’il ne quitterait plus jamais l’île, que d’une certaine façon il allait rester dans l’île pour toujours[48] », jouit de la vie aspirée à pleins poumons, de la plénitude éprouvée de l’instant, du sentiment d’être vivant, bien vivant, en paix avec soi-même, en harmonie avec les autres et la nature. Libre au lecteur de considérer à l’envi Marini et son « anti » : l’un et l’autre sont un homme de chair et d’os, simplement vu sous un angle particulier, image inversée l’un de l’autre.
Mais l’homme sur l’île a raison de craindre et de détester cet autre qui lui est associé, « le pire de lui-même »[49]. Suivons jusqu’au bout notre parallèle avec la matière subatomique : quand une particule rencontre son « anti », toutes deux s’annihilent en produisant du rayonnement gamma. Il en va de même des deux hommes. Le fantastique, une fois encore, n’est guère propice à son personnage. Marini, unique rescapé de l’avion tombé en mer, est destiné – cruelle ironie du sort ! – à entrer en collusion avec son « anti » dont il n’eut, logiquement, jamais dû faire la rencontre…
Il le remorqua lentement jusqu’au rivage, prit dans ses bras le corps vêtu de blanc et l’étendit sur le sable en regardant le visage plein d’écume où la mort était déjà installée, la blessure béante à la gorge. A quoi bon la respiration artificielle puisqu’à chaque convulsion la blessure semblait s’ouvrir un peu plus, elle était comme une bouche répugnante qui appelait Marini, l’arrachait à son pauvre bonheur si pauvre dans l’île, lui criait dans un flot de sang quelque chose qu’il n’était plus à même de comprendre[50].
L’étreinte des deux hommes devait fatalement, lecture « quantique » oblige, se solder par leur mort réciproque, leur dilution qui, en conformité avec le goût du genre pour la monstration, se traduit par « une blessure béante à la gorge » et « un flot de sang ». La dématérialisation de l’anti-Marini, l’homme nouveau, est entérinée par le regard de Klaios. Rien de lui ne survit, pas même sa mémoire : « comme d’habitude, il n’y avait qu’eux dans l’île, et le cadavre aux yeux ouverts était le seul nouveau parmi eux[51]. » Comment expliquer le corps gisant sur la plage ? On pourrait avancer l’hypothèse, en reprenant le jargon de la physique, qu’il y a eu une brisure de symétrie : dans ce récit comme dans l’univers, la matière l’emporte sur l’antimatière. Dans ce texte de fiction, matérialité est synonyme de matérialisme ; la matière est connotée « négativement » et « négatif » signifie ici « mauvais », « nuisible ». Ce « cadavre » dont la présence est incongrue, impensable en un tel lieu, est le signe que l’île ne peut échapper à la « contamination », et que la stewardees avait raison quand elle annonçait nonchalamment, en sirotant un verre à Rome, à propos de Xiros : « ça ne durera pas, (…) les hordes déferleront sous peu[52]. »
Conclusion
Force est de constater que le surnaturel, dans les trois nouvelles de Cortázar que nous venons d’analyser à la lumière de la physique quantique, n’est nullement l’expression des carences ou des insuffisances de la rationalité. Au cours du travail d’interprétation textuelle, on s’en prévaut au contraire comme d’un instrument aux ressorts multiples, jouant avec lui non plus à exhiber mais à repousser les limites officiellement assignées à la rationalité. La raison en action mobilisée dans le cadre d’une lecture « quantique » laisse la part belle à l’imagination, elle est plus souple, plus libertaire, plus ouverte en un mot, et dote l’univers fictionnel d’une cohérence insoupçonnée. Mais elle est irrecevable du point de vue du sens commun (envisager le surnaturel comme agent de rationalité n’est pas envisageable). En faisant du surnaturel le vecteur de la rationalité, le genre plaide pour une « extension » de la raison. L’effet fantastique est le signe de cette extension de la raison ; le signe de la dilatation de ses limites. Il s’éprouve sur le mode du sentiment de l’absurde tel que l’entend Cortázar, c’est-à-dire un sentiment comparable à celui qu’engendrent les résultats « impossibles mais vrais » de la physique quantique.
C’est peut-être le raccordement problématique de ce savoir scientifique avec notre expérience quotidienne, avec notre espace-temps familier, qui est figuré d’une manière générale par l’écriture dans les textes littéraires dont il est ici question.
[1] Julio Cortázar, Le tour du jour en quatre-vingts mondes, Paris, Gallimard, 1980 [La vuelta al día en ochenta mundos, 1964], p. 19.
[2] Idem.
[3] Philippe Grangier, « Des photons intriqués à l’information quantique », conférence prononcée à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris le 20 mars 2008.
[4] Idem.
[5] Wolfgang Pauli, Physique moderne et philosophie, Paris, Albin Michel, 1999 [Aufsätze und Vorträge über Physik und Erkenntnistheorie, 1961], p. 160.
[6] Ilias Yocaris, « Des images et des paraboles : Niels Bohr et le discours descriptif en physique quantique », Cahiers de Narratologie, numéro 18, juin 2010.
[7] René Thom, Prédire n’est pas expliquer, Paris, Eschel, 1991, p. 86.
[8] Wolfgang Pauli, op. cit., p. 177.
[9] Alain Aspect, « Lumière : ondes, photons, quantas », conférence prononcée à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris le 13 mars 2008.
[10] Richard Feynman, Lumière et matière. Une étrange histoire, Paris, InterEditions, 1987 [QED, The Strange Theory of Light and Matter, 1985], p. 18.
[11] Julio Cortázar, Le tour du jour en quatre-vingts mondes, op. cit., p. 20.
[12] Werner Heisenberg, La partie et le tout. Le monde de la physique atomique, Paris, Flammarion, 1972 [Der Teil und das Ganz. Gespräche im Umkreis der Atomphysik, 1969] p. 121.
[13] Julio Cortázar, Le tour du jour en quatre-vingts mondes, op. cit., p. 20.
[14] Julio Cortázar, « La lointaine », Bestiaire [1951] in Nouvelles 1945-1982, Paris, Gallimard, 1993, p. 105-111.
[15] Ibid., voir le journal à la date du 12 janvier.
[16] Ibid., voir le journal à la date du 20 janvier.
[17] Idem.
[18] Idem.
[19] Ibid., voir le journal à la date du 7 février.
[20] Idem.
[21] Idem.
[22] Philippe Grangier, op. cit.
[23] Idem.
[24] Étienne Klein est cité par Aladin Quet, « Introduction à l’informatique quantique », Travail d’étude et de recherche dans le cadre d’un Master Informatique, option Epistémologie de l’informatique, UFR Sciences, Université de Montpellier II, décembre 2007.
[25] Julio Cortázar, « Axolotl » [1962], Fin d’un jeu, in Nouvelles 1945-1982, op.cit., p. 355-358.
[26] Idem.
[27] Daniel Grojnowski, Lire la nouvelle, Paris, Nathan, 2000 [1993], p. 144.
[28] Roland Lehoucq, « Le grand récit de l’univers », conférence prononcée à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris le 24 janvier 2008.
[29] Étienne Klein, Petit voyage dans le monde des quantas, Paris, Flammarion, 2004 [1996], p. 66.
[30] Idem., p. 71.
[31] Julio Cortázar, « Axolotl », op.cit., p. 357.
[32] Étienne Klein, op. cit., p. 64.
[33] Julio Cortázar, « Axolotl », op.cit., p. 358.
[34] Idem.
[35] Idem.
[36] Julio Cortázar, « L’île à midi », Tous les feux le feu [1966], in Nouvelles 1945-1982, op.cit., p. 533-537.
[37] George Gamov, Le nouveau monde de M. Tompkins, Paris, Le Pommier, 2005 [Mr. Tompkins, 1941, repris et actualisé par Russell Stannard en 1999], p. 228. Propos tenus par le professeur, un des trois personnages principaux du récit de Gamov.
[38] Julio Cortázar, « L’île à midi », op. cit., p. 535.
[39] Idem.
[40] Idem.
[41] Ibid., p. 534.
[42] Idem.
[43] Idem.
[44] Ibid., p. 535.
[45] Ibid., p. 533.
[46] Ibid., p. 535-536.
[47] Ibid., p. 537.
[48] Ibid., p. 536.
[49] Ibid., p. 537.
[50] Idem.
[51] Idem.
[52] Idem.