Le temps de la sérialité (2)
Le temps au cœur des séries
Le temps est tout également un élément central des intrigues des séries. Il est évident qu’il rythme et donne vie au récit. Mais la façon dont certaines séries le placent au premier plan – comme principe moteur – non pas seulement de l’intrigue mais de la série en question peut donner à penser. On s’étonne parfois de la lenteur d’une série dite policière comme The Wire ou du rythme effréné et des multiples rebondissements jouant avec nos nerfs de 24. Nous chercherons ici à cerner quelques principes (temporels) mis en œuvre dans certaines séries.
A) Jouer avec ou contre la montre ?
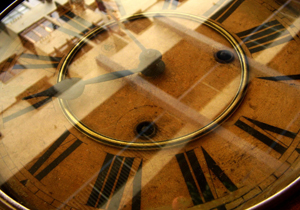
Source : photo-libre.fr
Le Tic-tac, Tic-Tac, qui résonne à chaque fin d’épisode de 24, illustre la course contre la montre engagée par Jack Bauer, agent américain de la lutte contre le terrorisme, chargé d’anéantir les menaces, en poursuivant les terroristes, remontant les réseaux et démasquant les taupes. Cette série a en quelque sorte révolutionné le monde du feuilleton par l’unité de temps choisie par ces créateurs : chaque saison représente une journée et comporte 24 épisode sc’est-à-dire 24 heures – d’où le titre de la série. Chaque épisode dure une heure (42 minutes + les publicités) et les huit saisons de la série ne représentent en fait que huit jours – non consécutifs, étalés dans un laps de temps d’une dizaine d’années.
Nous suivons l’intrigue « en temps réel » c’est-à-dire qu’on ne trouve pas les procédés habituels du « flashback » ou même du ralenti. Cette simultanéité au centre de la série pourrait créer des « longueurs » si nous n’avions pas affaire – chaque heure – à un ou une suite de rebondissements. Le suspense est à son comble quand, à chaque fin d’épisode[1], le cliffhanger tombe et arrête net cette horloge que l’on ne cesse de nous montrer durant l’épisode. Comme Jack, nous aussi « we’re running out of time »[2]. C’est souvent la gorge nouée et en ayant des fourmis dans les jambes que nous suivons sa course contre la montre, qui paradoxalement peut-être, se déploie dans une sorte d’atemporalité : les épisodes de 24 ne sont jamais datés et se déroulent dans un « présent perpétuel », c’est-à-dire dans un temps toujours présent, dans l’éternelle urgence du moment présent.
Cette urgence comporte différents aspects : celle vécue par le personnage et celle vécue par le spectateur. Pour Jack elle augmente graduellement au fil des minutes. Pour le spectateur elle est plus diffuse : elle augmente au gré de l’intrigue et des rebondissements[3] et devient de plus en plus stressante quand on prend conscience du fait que n’importe lequel des personnages entourant Jack et auquel le spectateur a pu s’attacher, peut mourir à tout instant. C’est par exemple le cas lors de la fin de la première saison, lorsque sa femme meurt, ou les morts multiples au début de la cinquième saison. Ce « principe d’incertitude » qui fait que tous peuvent mourir à chaque seconde qui passe, est une nouveauté nous semble-t-il propre à cette série et qui rend ses spectateurs encore plus « addicts »[4].
À l’opposé de cette course contre la montre et sans pour autant manquer de suspense, la série policière Cold Case joue la montre en profitant du temps qui a passé. Le principe de la série est simple : Lilly Rush est chargée de rouvrir d’anciens dossiers classés sans suite et de faire resurgir les fantômes du passé. Contrairement à Jack Bauer, Lilly Rush dispose de (tout) son temps, ou du moins elle prend le temps d’écouter les personnes faisant progresser son enquête et les laisser raconter leur histoire. Comme le souligne Guillaume Soulez, l’éloignement temporel entre les faits meurtriers et la réouverture de l’enquête n’est pas forcément un handicap :
le pilote de la série (diffusé en septembre 2003 sur CBS) propose un dialogue entre celle ci [Lilly Rush] et son supérieur sur le rôle du temps. Alors que l’éloignement temporel pourrait sembler un obstacle à la reprise de l’enquête, les personnages évoquent « le temps (qui) peut jouer en notre faveur » et « le temps (qui) passe, les amitiés (qui) s’érodent, les choses (qui) évoluent [5].
Le temps n’est pas un couperet impliquant des morts en masse (les attentats que combat Jack Bauer), mais une distance thérapeutique : c’est le temps de l’acceptation :
Cold Case est en somme une série sur cette maladie du temps liée au deuil, au « travail du deuil ». Lilly Rush accomplit pour les autres ce travail qui n’a pas eu lieu. On pourrait parler ici d’une connexion biographique. Le caractère de répétition de la série s’inscrit ainsi dans la temporalité même du deuil en tant qu’il est le contraire de l’oubli : faire son deuil n’est pas « mettre dans un coin » un « épisode » douloureux de sa vie, c’est au contraire « lui faire une place », l’inscrire dans le fil temporel de sa vie, en s’assumant soi-même à travers cette opération. En luttant contre la résistance au deuil, la série réaffirme la nécessité de ce travail qui n’a de sens que répété[6].
B) Jouer sur le temps : remonter le temps ou aller de l’avant ?
Les deux modes que nous venons de présenter ne sont pas les seuls ressorts permettant de jouer sur le temps. Analepses, ellipses, prolepses sont monnaie courante dans les récits, et les producteurs en usent – et parfois en abusent – dans leurs séries. Ces procédés sont de bons moyens pour redynamiser une série, comme ce fut le cas pour Desperate Houseviwes, lorsque les producteurs ont recommencé l’intrigue de la cinquième saison cinq ans après la fin de l’intrigue de la saison précédente – ce qui nécessite de nombreuses « (re)mises au point » concernant la vie des personnages et permet d’attacher à nouveau le spectateur à la série. La plupart des séries font appel aux analepses (ou flashbacks), il est donc peu utile de nous attarder sur ce procédé classique. En revanche la prolepse (ou flashforward) est un procédé bien moins usité dans les narrations sérielles. Une série comme Damages a su y trouver un élément moteur perdant, accrochant et scotchant son spectateur. C’est en effet une série qui demande une grande attention pour la suivre et plus spécifiquement une attention aux détails pour la comprendre complètement. L’épisode pilote commence par une prolepse : Elen Parsons, jeune et brillante avocate new-yorkaise qui vient d’être embauchée dans le plus célèbre cabinet de Patty Hewes (incarnée par une magnifique Glen Close), nous est présentée toute ensanglantée sortant d’un ascenseur et errant dans les rues de la ville. L’intrigue est révélée partiellement par ce biais dans un jeu d’allers-retours incessants, déroutant et captivant les spectateurs.
Mais nous trouvons aussi d’autres séries qui sont entièrement construites sur ces procédés narratifs ou du moins qui érigent une certaine temporalité en principe moteur de la série. Deux options se présentent alors : faire un saut dans le temps ou le remonter.
L’humanité entière s’évanouit pendant 2 minutes et 17 secondes, laps de temps pendant lequel chacun est confronté à une vision de son futur (six mois plus tard) : voici le principe de la série Flashforward. Nous sommes donc invités à suivre et à imaginer les chemins que les personnages vont prendre pour parvenir – ou non – à cette vision de leur futur. Notons que cette série a été créée par la chaine ABC pour succéder à Lost, et que cette question du rapport au temps y était déjà largement thématisée[7]. Deux lignes de force se mettent en place dans Flashforward : celle de l’enquête entreprise par les agents du FBI menée par Mark Benford pour comprendre les causes du « black-out » et éviter qu’un tel événement se reproduise, et une ligne de force ayant un plus large spectre, à savoir les réactions des personnages à ce petit aperçu de leur avenir et leur action pour y parvenir ou au contraire pour l’éviter. La question – classique – qui est posée est de savoir si notre futur est déjà tracé et si oui, essayer de déterminer quels sont les moyens que nous avons pour le contourner ou le modifier envers et contre tout. Théorie du destin et théorie du complot se mêlent pour rendre compte de (et peut être inspirer au spectateur) la confusion et l’inquiétude des personnages.
De l’autre coté de la flèche du temps nous trouvons des séries comme Life on Mars ou son spin off Ashes to Ashes, puisque nous avons affaire à un bond inverse dans le temps : dans Life on Mars, Sam Tyler, commissaire principal à Manchester est renversé accidentellement par une voiture et se réveille en 1973, et dans Ashes to Ashes, Alex Drake, experte en profilage criminel à Londres, se fait enlever par un inconnu et après qu’il lui ait tiré dessus, elle se trouve propulsée dans le Londres de 1981, où elle rencontre certains des personnages de Life on Mars. Les deux séries policières s’organisent sur un double principe : résoudre une enquête policière à chaque épisode, enquête qui a plus ou moins rapport avec l’affaire en cours des deux personnages avant leur « arrivée dans le passé », et élucider les causes ou raisons de leur présence dans le passé : sont-ils mort ou dans le coma ? Sont-ils en train d’halluciner ? Qu’est-ce qui est réel ?
Ce retour dans le passé nous semble bien plus savoureux que le saut dans le temps de Flashforward dans la mesure où le spectateur est embarqué lui aussi dans son passé. Les deux séries anglaises ne manquent pas de références sociologiques, culturelles et politiques qui nous réengagent dans notre propre passé ou dans les souvenirs issus du passé de nos parents. Ce maillage renvoie aussi bien aux chansons de D. Bowie dont les titres des séries sont tirés, aux codes vestimentaires des années 1970 et 1980, aux luttes pour les droits sociaux, qu’aux événements historiques comme la guerre des Malouines (saison 2 d’Ashes to Ashes). On est tout autant séduit par cette ambiance décalée que par l’accent et le caractère à la fois brutal et old school du commissaire principal Gene Hunt. Comme pour Mad men, on s’étonne de toutes ces choses qui ont changé et on est presque scandalisé de voir qu’à l’époque tous et toutes fumaient, y compris les femmes enceintes… Mais ce n’est pas tant ce « bon vieux temps » qu’on nous donne à voir, c’est plutôt la quête de Sam Tyler et d’Alex Drake pour retrouver leur temps et se retrouver : retrouver leur identité et leur réalité.
On doit se demander quel peut être le réalisme de ces séries une fois leur principe temporel posé, ou du moins quels sont les éléments avancés pour justifier ou, à défaut, pour rendre plausible ce saut dans le temps. Nous touchons là à un principe de base des récits de sciences fictions, mais dans les trois séries que nous avons ici abordé nous ne tombons pas vraiment dans le monde du fantastique. Les hypothèses conduisant à la distorsion (temporelle) de notre monde trouvent une sorte de légitimation scientifique. Dans Flashforward on oscille entre théorie du complot et expérience scientifique aux conséquences désastreuses. Dans Life on Mars, Sam Tyler comprend qu’il est dans le coma, et les clefs de cette présence dans le passé sont données dans le dernier épisode d’Ashes to Ashes.
Dans ces deux séries les deux personnages principaux se demandent souvent s’ils ne sont pas en pleine hallucination et prétendent que cette réalité dans laquelle ils vivent est « dans leur tête », ils produisent ce qu’ils voient, touchent, mangent, etc. Et ils s’étonnent souvent de la « réalité » de leur hallucination, de sa concrétude et de sa grande qualité, comme en atteste un moment clef de l’épisode pilote de Life on Mars, où Sam Tyler est à deux doigts de se taper la tête contre les murs pour sortir de ce qu’il croit être un cauchemar et qu’il prend conscience de la « réalité » de ces murs, de leur dureté, de leur humidité et de leur rugosité. Cette « réalité » est celle de l’enfermement du personnage, et contrairement à Flashforward où toute l’humanité partage le « flashforward » et donc personne ne doute de l’avoir vécu, Sam Tyler et Alex Drake en doutent en permanence – la rejettent – ou s’étonnent de « créer » certaines situations dans cette – leur – réalité, comme le fait de manière répétée Alex Drake face aux comportements brutaux et souvent misogynes de son supérieur Gene Hunt.
C) Raconter des histoires et raconter l’Histoire
Notre compte rendu du « temps au cœur des séries » serait incomplet si on ne s’arrêtait pas sur le « temps de l’histoire » : les séries racontant le passé ou reprenant les grands moments ou événements de l’Histoire. Ce type de série est en expansion depuis les dix dernières années[8]. Ce sont généralement des « mini-séries » c’est-à-dire environ une dizaine d’épisodes, comme Band of Brothers, John Adams, Generation Kill, ou le tout récent The Pacific[9].
Même si les récits d’épisodes historiques belliqueux sont majoritaires dans ces récits de l’Histoire : Band of Brothers, The Pacific, Generation Kill, etc., ils ne sont pas exclusifs. Il nous semble en effet que nous avons aussi affaire à des récits relatant les origines (mythiques?) de la civilisation. Ainsi des séries comme Rome, Deadwood, John Adams et par certains aspects Mad Men nous présentent une vision de périodes historiques fondatrices.
Si nous parlons ici de « vision », c’est bien parce que ces récits ne sont pas véritablement authentiques ou fidèles à l’histoire. En effet, la super-production Rome, coproduite par les chaînes HBO et BBC et annoncée comme la série la plus chère jamais réalisée (quelques centaines de millions de dollars ont été dépensés pour recréer les monuments, le Forum, les costumes, etc.) mêle aux faits historiques avérés des écarts tout à fait fictionnels. La chute de la République et la naissance de l’Empire sont vues et animées par deux personnages fictifs Lucius Vorenus et Titus Pullo. Néanmoins dans ce cadre antique, la critique de l’impérialisme que Rome présente en filigrane, vise bien l’actualité et le discours de G. W. Bush.
Les séries John Adams et Deadwood reviennent quant à elles aux racines de l’histoire américaine. John Adams[10] est une sorte d’hommage à l’avocat et homme politique du même nom, qui en 1770, va se faire remarquer pour son impartialité alors qu’il défend des soldats britanniques au cours du procès dit du « Massacre de Boston ». Et c’est ce même fervent défenseur de l’Indépendance qui va devenir le premier Vice-Président et par la suite le deuxième Président des États-Unis. Deadwood se situe un siècle plus tard durant la période troublée de conquête de l’ouest et de guerre civile entre les chercheurs d’or et les Indiens : la Guerre des Black Hills, et réinvestit, avec une grande noirceur, le genre du western en y entremêlant des épisodes et personnages historiques et fictifs.
Pour Mad men, nous n’avons pas véritablement affaire à une série de genre historique à proprement parler, mais à la peinture de l’époque à l’origine du « monde moderne ». Pour ce faire la série plante son décors dans une agence de publicité en pleine expansion au début de ces années 1960 où après un demi siècle de guerres et de crises, la vie et l’économie reprennent leurs droits de manière excessive, naturellement. Pour autant, le rythme de la série est étonnamment lent, ce qui permet néanmoins au spectateur de s’imprégner et de s’immerger dans ce moment de l’Histoire qu’il connaît relativement mal tout simplement parce qu’il ne l’a pas vécu[11]. Nous suivons ainsi Don Draper, sa famille, ses collègues et amis, évoluer dans ce monde en mutation et nous vivons avec eux les événements marquants de cette époque : la crise des missiles de Cuba, l’élection de Kennedy et son assassinat, la mort de Marilyne Monroe, etc.
En réalité, Mad Men est une espèce de long film, parfois lent, très (trop ?) lent. Un peu comme ceux qu’Hollywood produisait à une époque pas si lointaine et qui parlaient des Années folles, de la Prohibition, ou encore de l’émergence des clubs de jazz à New York. Il y a là, comme un besoin de se souvenir de quoi était fait le “bon vieux temps”, combien on s’amusait à cette période-là et comment la vie était (peut-être) plus facile. S’en tenir à ce constat serait rester à la surface des choses.
Ce que montre M. Weiner [créateur de la série], c’est qu’il n’existe pas d’époque bénie, rose et insouciante. Et pour illustrer cette idée, le choix de l’univers de la publicité est judicieuse. La concurrence y est aussi sauvage que celle qui règne aujourd’hui dans le monde des start-ups ou celui des technologies qualifiées (abusivement) de pointe. Au fond, la jungle reste un paysage récurrent et inamovible et il est toujours aussi difficile de se raccrocher aux branches quand on tombe du faîte d’un arbre. […]
En utilisant, précisément, les flash-back, Weiner montre que les choses ont finalement bien peu changé depuis la fin de la guerre. La vie commune, l’appartenance à une collectivité ou à une tribu professionnelle, posent toujours les mêmes questions, imposent les mêmes frustrations. Le message est clair : la modernité n’est certainement pas un remède, et pas nécessairement un bienfait[12].
Nous avons ainsi affaire à un excellent récit fictionnel nous replongeant dans une période de l’histoire peu connue pour nous jeunes spectateurs que nous sommes.
Si néanmoins nous touchons souvent à l’Histoire dans ce type de série, le genre historique se développe plus complètement dans les récits de guerre. La chaîne HBO s’est appliquée à créer ce type de production sous l’impulsion de Tom Hanks et Steven Spielberg : Band of Brothers et The Pacific en sont les résultats. Les deux mini-séries fonctionnent sur le même principe : fondées sur des œuvres d’historien (Band of Brothers est inspiré de l’œuvre de l’historien Stephen E. Ambrose) ou des mémoires de Marines (The Pacific est fondée sur With the Old Breed d’Eugene Sledge et Helmet for My Pillow de Robert Leckie), elles commencent par des témoignages de ceux qui ont vécu et fait cette guerre. Le récit commence par le moment précédent le débarquement, en Normandie pour la Easy Company, un régiment d’infanterie parachutée, de Band of Brothers et sur l’île de Guadalcanal pour les trois marines Eugene Sledge, Robert Leckie et John Basilone. Le récit s’achève logiquement au moment de la reddition de l’ennemie et sur le retour des troupes.
Même si la qualité de ces deux mini-séries n’est pas égale, puisque The Pacific n’atteint pas Band of Brothers, on y retrouve le même souci du témoignage. En offrant ainsi la parole à ceux qui ont fait l’Histoire la fiction recherche une tonalité touchante et donne à voir une certaine authenticité qui restera dans les esprits. On retrouve par ailleurs ce même souci de « donner à voir » et de témoignage dans une autre mini-série : Generation Kill, qui présente le récit de « l’histoire en train de se faire » par la restitution de ce qu’à vécu Evan « Scribe » Wright, un journaliste embarqué[13] dans un bataillon de reconnaissance de marines lors de la récente invasion de l’Irak. Cette série, menée par les créateurs de The Wire est inspirée par l’aventure d’Evan Wright, qui a réellement accompagné la compagnie. Ce n’est dès lors pas un hasard si l’immersion du spectateur dans la série se fait par le regard quelque peu froid, sans fioriture du moins, et surtout critique d’un journaliste quasiment muet.
Il est comme nous – spectateur – d’une histoire qu’il ne maîtrise pas et qu’il suit et vit, comme nous – embarqué.
Delphine Dubs
[1] Généralement on trouve deux type de cliffhanger : un « assez important » placé à la fin d’une saison d’une série afin de nous pousser à suivre la série , et un plus mineur, placé avant la pause publicitaire afin de conserver le spectateur devant son écran. 24 a repris le modèle du cliffhanger final pour le placer à la fin de chaque épisode.
[2] Cette phrase est un leit motiv de la série. Pour une analyse des conséquences morales nous vous conseillons le chapitre qui est consacré à la série dans l’ouvrage de T. de Saint Maurice, Philosophie en séries, Paris, Ellipses, 2009.
[3] Notons que les saisons de 24 s’organisent suivant un même schéma : la première moitié de la saison (ou de la journée), Jack poursuit une enquête qui se révèle finalement secondaire quand on découvre le véritable complot qui se tramait derrière.
[4] Notons aussi que certaines pratiques se sont diffusées à cause du format de 24, comme les « marathons 24 » : vivre une journée de Jack Bauer, c’est-à-dire regarder une saison en une journée.
[5] Guillaume Soulez, « Au-delà du récit, le temps ouvert », in MédiaMorphoses, Hors-Série n.3, « Les raisons d’aimer les séries télé », 2007, p. 174.
[6] Ibid., p. 176.
[7] On pourra en particulier se reporter à l’excellente analyse de Th. Sinaeve sur les boucles temporelles dans Lost : http://seriestv.blog.lemonde.fr/2010/01/27/lost-week-comprendre-les-boucles-temporelles/
[8] Voir le résumé de l’intervention lors de la journée HBO de Marjolaine Boutet (http://godsavemyscreen.blog.lemonde.fr/2010/07/26/hbo-et-lhistoire/ )
[9] Pour un panorama et une analyse de ce genre sériel, on pourra écouter le podcast « The World Séries » consacré à la guerre sur le blog de P. Sérisier.
[10] Cette mini-série est fondée sur la biographie de David McCullough (prix Pulitzer en 2002). Notons aussi qu’elle a été produite notamment par Tom Hanks pour HBO, tout comme Band of Brothers et The Pacific.
[11] Comme Pierre Sérisier le souligne « La série créée par Matthew Weiner était une entreprise audacieuse. Car elle ne peut pas se fonder sur la nostalgie. Ceux qui ont vécu cette période, en tant qu’adultes, ont aujourd’hui atteint l’âge de la retraite et ne constituent pas le public privilégié de ce genre de programmes », http://seriestv.blog.lemonde.fr/2008/02/14/mad-men-comme-au-bon-vieux-temps/.
[12] Pierre Sérisier, « Mad Men. « Comme au bon vieux temps », http://seriestv.blog.lemonde.fr/2008/02/14/mad-men-comme-au-bon-vieux-temps/
[13] Cf. les remarques à ce sujet de Th. St Maurice : https://www.implications-philosophiques.org/implications-de-limaginaire/philosophie-des-series/generation-kill-embedded-au-coeur-de-la-question-de-la-guerre-juste-1/














