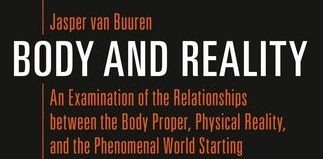Le toucher, entre objets et ob-jectivité (I)
Ces publications sont une reprise de certaines interventions prononcées dans le cadre des journées d’études « L’objet de la perception », à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne , École Doctorale de Philosophie (ED 280), Philosophies contemporaines (PhiCo EA3562) EXeCO – CEPA, organisées par Roberta Locatelli et Pauline Nadrigny
Travailler sur ce que peut être l’objet du toucher impose de renoncer à toute définition préliminaire de ce que peut être un objet perceptuel. Car l’un des intérêts principaux d’un tel travail, dont le programme nous a été proposé par Roberta Locatelli et Pauline Nadrigny à l’occasion des journées d’étude sur « L’objet de la perception », consiste à tenter de penser l’objet de la perception hors du paradigme visuel, paradigme dont on pense généralement qu’il domine la philosophie de la perception selon une idée qui dispose d’une indéniable justesse historique, bien qu’existent – en nombre limité certes, même si son accroissement semble s’accélérer ces derniers temps – des travaux consacrés à d’autres sens, ou attentifs à leur spécificité. Si ce paradigme est donc dominant en philosophie de la perception comme on le dit souvent, toute définition a priori de l’objet de la perception est ainsi suspecte d’être propre au sens visuel, ou déterminée par des caractères propres à ce sens. Ne serait-ce que pour rendre possible l’apparition de déterminations de l’objet du toucher que n’aurait pas dévoilées une analyse de l’objet visuel, ou bien même sonore, gustatif ou odorant (quoique ces deux derniers objets n’aient été que très peu analysés à notre connaissance, et qu’il y ait donc peu de risque que leur considération nous aveugle à l’égard du toucher), travailler sur l’objet du toucher nécessite donc la plus grande prudence à cet égard. Partons donc de l’idée que nous ne savons pas du tout ce qu’est l’objet de la perception et tâchons de prendre, par une sorte de mesure d’hygiène, le problème progressivement, en partant de faits linguistiques simples, afin de dégager un concept possible, ou des concepts possibles, d’un objet du toucher.

Avant de nous engager dans ce programme, il nous faut cependant dire un mot de cette feuille de route qui consiste à essayer de penser l’objet de la perception en s’émancipant du paradigme visuel, c’est-à-dire à penser par lui-même l’objet du toucher, de manière à faire apparaître ce qui, dans notre conception usuelle de l’objet de la perception, est en fait relatif à la seule vision et ne peut donc être considéré comme généralisable à l’ensemble de la perception. Son objectif est ainsi de tenter, en réfléchissant sur l’objet du toucher, de proposer une autre conception possible de l’objet de la perception.
Mais un tel projet pose, en son principe, dès son énoncé même, un problème important : car y a-t-il seulement un objet du toucher ? Le toucher a-t-il affaire à des objets ? Et ce problème en entraîne d’autres : la notion même d’objet appliquée au domaine perceptif – en l’occurrence au toucher –, n’est-elle pas la trace de cette fameuse domination du paradigme visuel dans le champ perceptif ? À moins qu’elle ne soit la trace de la domination, dans le champ visuel lui-même, de problématiques extrinsèques à la perception proprement dite, tel par exemple le souci de la vérité ? L’avantage, à cet égard, de l’analyse du toucher, sens très peu exploré dans la littérature classique et contemporaine, est sa nouveauté : moins analysé, le toucher serait davantage susceptible d’être considéré avec un regard « neuf ». L’intérêt du travail sur l’objet du toucher serait à ce titre multiple : il donne l’occasion, d’une part, d’explorer différents aspects de ce sens, négligé mais d’une importance considérable et constante dans nos vies ; il permet de plus, évidemment, de considérer différemment la question de l’objet de la perception en mettant l’accent, non sur la vue, comme souvent, mais sur le toucher ; enfin, et surtout, il permet de se soustraire – ou de tenter de se soustraire – non seulement au paradigme visuel, mais surtout aux préjugés encombrant, à son corps défendant, l’analyse de la vue. Il s’agit donc non seulement de penser le toucher contre la vue, mais à cette occasion, de penser peut-être différemment la vue (et aussi l’ouïe, le goût, l’odorat…) grâce au toucher. Cet article ne se propose évidemment pas d’accomplir ce programme, mais de proposer quelques pistes pour l’aborder.
Tentons donc à présent de dégager un concept possible d’« objet du toucher » à partir de l’étude de faits linguistiques simples, et tout d’abord de celui-ci, dont le caractère massif impose le « privilège » d’initier notre étude : il nous semble tout simplement faux de dire que nous touchons toujours des objets, ou même que nous touchons le plus souvent des objets. Car, premièrement, ce que nous touchons le plus, dans nos vies quotidiennes, c’est le sol, sous toutes ses formes. Or, le sol n’est pas un objet. Notons que le constat très basique que nous faisons ici s’apparente à celui que fait John Austin dans Le langage de la perception. Il argumente ainsi l’idée que nous ne percevons pas toujours, ni même en général, des objets :
« Mais l’homme de la rue croit-il vraiment que ce qu’il perçoit est (toujours) quelque chose de semblable aux meubles ou aux autres « objets » (des spécimens de dimensions moyennes de denrées solides). Nous pouvons penser aussi, par exemple, aux personnes, à leur voix, aux fleuves, aux montagnes, aux flammes, aux arc-en-ciel, aux ombres, aux images apparaissant sur un écran de cinéma, aux tableaux accrochés aux murs ou aux images qu’on trouve dans les livres, aux vapeurs, aux gaz – toutes choses que les gens disent voir ou (dans certains cas) entendre ou sentir, c’est-à-dire « percevoir ». »[1]
L’argument employé ici par Austin concerne la perception en général, et il nous semble très aisé de montrer sa pertinence pour le toucher, ne serait-ce donc qu’en faisant valoir le fait que ce que nous touchons le plus souvent, c’est le sol.
Cette remarque doit alors attirer notre attention sur un ensemble plus vaste de faits : ce que nous touchons le plus fréquemment, c’est donc le sol mais, plus généralement, et d’une manière proche – quoique pas tout à fait identique – ce sont des sièges de toutes sortes, des lits, toutes choses que l’on pourrait qualifier d’objets en certaines circonstances, mais dont il nous semble que nous ne les touchons pas le plus souvent comme tels. En effet, ces sièges, ces lits, nous les touchons le plus souvent comme des repères dans notre environnement, dont le contact nous permet de nous orienter physiquement, de nous situer, de nous « tenir » debout, assis ou couché, c’est-à-dire d’adapter notre posture. Lorsque nous sommes assis sur une chaise, nous la touchons, croyons-nous, non pas comme un objet, mais comme un prolongement du sol, sur lequel nous nous appuyons pour tenir notre position assise, en jouant sur la force de gravité, la répartition de notre poids dans les différentes parties de notre corps… Nous sommes donc en contact avec des choses – pour le dire le plus vaguement possible –, qui, dans ce contact, sont pour nous comme le sol, c’est-à-dire qu’elles nous permettent de nous situer physiquement et de placer notre centre de gravité dans le monde que nous habitons.
Cependant, à ce stade de la réflexion, une question semble s’imposer : ces choses qui servent de prolongement au sol, peut-on bien leur donner parfois le nom d’objet ? Y a-t-il des occasions où cela se justifie ? Car il nous semble qu’apparaît là une difficulté : en fait, ces choses sont en général davantage des meubles que ce que l’on appellerait spontanément des objets, notion qui implique à nos yeux, dans le langage courant, une certaine maniabilité, et donc des dimensions réduites. Il semble donc qu’un meuble ne soit pas vraiment un objet. Ou plutôt que certains meubles, lorsque nous sommes dans un certain type de rapport avec eux, ne soient pas des objets. Remarquons ainsi que, sur ce point, nous pensons nécessaire de nuancer l’amalgame entre meuble et objet auquel semble procéder Austin dans la citation précédente, en insistant sur le fait que, même si les meubles peuvent être parfois considérés comme des objets et qu’ils ont donc de fait plus d’affinités avec eux que les arcs-en-ciel et les montagnes (ce qui justifie qu’Austin les analyse de concert), il y a aussi des cas où ils ne fonctionnent pas comme tels, où ils ne peuvent être considérés tels (ce qui justifie selon nous que nous leur réservions un traitement différent dans ce développement). Prenons l’exemple du tabouret pliable. Le tabouret pliable est bien un objet, et même un objet assez ingénieux. Pourtant, il nous semble que le tabouret pliable, lorsque nous sommes assis dessus, n’est plus vraiment un objet, mais un prolongement du sol, c’est un support, quelque chose qui résiste à notre poids, qui s’oppose à la force de gravité qui s’exerce sur nous. Voilà ce que sont le sol, les sièges, le lit et toutes ces choses que nous touchons sans que nous puissions dire tout à fait que nous touchons alors des objets. Et il y a donc parmi ces choses que nous touchons de cette manière des choses que nous pouvons parfois qualifier d’objet – comme le tabouret pliable – mais qui parfois, lorsque nous sommes assis dessus par exemple, ne peuvent plus l’être.
Mais pour quelle raison ? Pourquoi la qualification d’objet semble-t-elle étrange dans ce cas où nous sommes assis sur le tabouret et non pas dans le cas, par exemple, où nous sommes en train de le mettre dans un camion pour procéder à son déménagement ? Un élément de réponse se trouve peut-être dans l’étymologie du mot objet : un objet c’est bien sûr quelque chose que l’on a placé devant soi, ce qui est jeté devant soi. Une chose est sûre : l’objet est « devant ». Or, dans les exemples qui nous intéressent, où est le « devant » ? Il n’y a pas de « devant » évident pour le toucher, car nous touchons avec tout notre corps. Ou, s’il y a bien un « devant » pour le toucher, la cause en est l’orientation de nos mains et de nos bras, laquelle est conforme à l’orientation de notre vision. Or, ce « devant » là n’est un « devant » que pour une petite partie de notre sensibilité tactile, laquelle n’a pas, en son ensemble, de « devant » évident. Il peut y avoir des « devant » pour la plante des pieds (si l’on se frotte par exemple le pied sur un appareil à massage), pour notre dos, mais ce sont, pour tout être qui dispose de ses quatre membres, des cas très marginaux. Peut-on alors considérer que l’on a une moindre propension à affirmer que le toucher a affaire à des objets car le toucher est moins orienté vers l’avant que la vue ? Se trouve là peut-être un point commun, au moins négatif, avec l’ouïe : ce que l’on touche n’est pas nécessairement « devant » nous et se situe même bien plus souvent « sous » nous ou « derrière » nous que « devant » nous. Il est d’ailleurs probable que les choses soient différentes à cet égard pour un être humain en bonne santé, disposant de ses quatre membres, ou pour un homme ne disposant plus de l’usage de ses bras, dont le « devant » serait, pour le toucher, bien plus fréquemment « dessous » ou « derrière » que pour nous. Car la détermination du « devant » n’est évidemment pas uniquement une question d’orientation, il semble que ce soit, plus fondamentalement, une question d’usage : ce qui est devant n’y est pas par hasard. Ce qui est devant nous a été placé ou jeté devant nous, parce que nous voulons le connaître ou l’utiliser, parce que nous voulons faire porter notre attention sur lui et que les organes qui nous permettent de connaître ou d’utiliser sont orientés vers l’avant. Comme le fait remarquer Platon dans le Timée, nous avons (en général, donc) un avant et un arrière. Lorsque nous touchons un siège, ce siège n’est pas devant nous et ne peut donc, par ce simple fait, être un objet. Attention, cependant, à ne pas se méprendre sur ce point : cela ne signifie pas que n’est un objet pour nous que ce qui est devant nous. Cela signifie bien plutôt que ne sont des objets pour nous que ce que nous avons placé devant nous, ou ce qui est fait pour être placé devant nous, c’est-à-dire ce que nous voulons utiliser ou connaître. Et de fait, il nous semble que, en un certain sens, nous n’utilisons pas le siège sur lequel nous sommes assis, de même que nous n’utilisons pas le sol, mais que nous nous reposons, nous nous appuyons sur lui. Le siège serait alors un objet au moment où nous le plaçons convenablement devant notre bureau, puis il perdrait ce statut d’objet pour devenir le prolongement du sol au moment où nous nous asseyons sur lui. Notre idée serait finalement celle-ci : nous ne touchons pas nécessairement des objets car nous ne sommes pas dans un rapport d’usage ou de connaissance à tout ce que l’on touche.
Avec cette question de l’usage, nous abordons un problème important, et qui concerne le projet même de cet article et du colloque qui a donné l’occasion de son élaboration. Car se demander ce qu’est l’objet du toucher, ce que nous touchons n’a rien de naturel. Ou cela n’est naturel que dans des situations très particulières. Le problème de l’intentionnalité de la perception est ici en jeu : lorsqu’on pense que la perception vise toujours quelque chose, la raison n’en est-elle pas qu’on lui demande ce qu’elle vise ? Analyser la perception et le perçu, c’est entrer dans un rapport particulier avec la perception, et en l’occurrence surtout avec le perçu, un rapport d’analyse qui n’est évidemment pas le rapport que l’on entretient avec le perçu en général. Lorsque nous nous demandons « quel est l’objet de la perception ? », il faut prendre garde à ce biais analytique, à ce biais qui fait que ce que nous analysons, nous le mettons « devant » nous pour l’analyser et nous en faisons ainsi un objet. Or, dans un grand nombre des exemples évoqués précédemment, il semble que, en général, nous ne nous demandons pas ce que nous touchons. Car nous touchons sans cesse un grand nombre de choses, sans leur accorder de l’attention. Et, pour être plus précis, nous pourrions même dire : en général, nous ne touchons pas, à proprement parler, mais nous sommes en contact. Et nous sommes en contact avec un environnement, et non pas avec tel ou tel objet particulier.
Si l’on veut rendre compte de ce qu’est le toucher en général, voici donc ce qu’il semble d’abord nécessaire de noter : nous touchons le sol sous nos pieds, la chaise sous nos jambes, le lit sous notre dos et, dans tous ces cas là, nous ne touchons pas des objets. Ce que nous touchons, ce sont donc d’abord des repères posturaux.
Se pose alors une question relative à la délimitation de ce qui relève du sens du toucher : ces repères posturaux ne sont-ils pas, tout autant que tactiles, kinesthésiques (proprioceptifs) ? La kinesthésie est en effet le « sens du mouvement », c’est-à-dire une forme de sensibilité qui renseigne sur la position et les déplacements des différentes parties du corps – la question de savoir si ce sens est un sixième sens, distinct du toucher, ou si on peut les unir nourrissant un débat complexe. Lorsque nous touchons le sol, les sièges, etc., cela ne met-il pas tout autant en jeu notre sensibilité dite « extérieure » que notre sensibilité kinesthésique ? Nous ne pouvons ici entrer dans le détail de ce débat, qui mériterait évidemment un traitement bien plus approfondi, mais, pour répondre au point qui intéresse notre problème, il nous semble qu’il n’y a pas de sens à distinguer le toucher de la conscience que l’on a de ses propres membres et de leurs mouvements. Car le toucher n’est pas une simple sensibilité – pour autant qu’une telle chose existe – des choses extérieures : toucher c’est toujours mettre en rapport son propre corps et un corps extérieur. La raison en étant que le toucher semble nécessairement avoir à faire à la résistance des choses, même minimale, même passive, et donc à la résistance des choses à notre force, à nos mouvements. On pourrait cependant imaginer que cette force résistant aux choses puisse se limiter, dans un cas de détente totale des muscles, à la force de gravité ou disons, aux forces dont nous sommes que le véhicule, le support, sans en être l’instigateur. La pertinence de ce qui suit doit donc être mise sous caution en ce qui concerne cette situation, qui n’a rien de marginale, du repos complet. Quoi qu’il en soit, s’il n’y a avait pas de force en jeu, dans un idéal de toucher sans aucune efficace, sans incidence aucune, il n’y aurait tout simplement pas de résistance, et pas de toucher. Or, qui dit résistance, dit force et donc, en général (le cas du repos complet étant mis de côté), implication de la kinesthésie. Nous atteignons le problème plus général de l’ensemble des gestes que l’on associe au sens du toucher : toucher, est-ce aussi soupeser, actionner, éprouver de ses mains de toutes les manières possibles ? Lorsque nous bougeons une clé dans une serrure pour chercher la position dans laquelle elle va permettre de l’ouvrir, que faisons-nous si nous ne touchons pas ? Lorsque nous touchons, nous faisons souvent bouger, nous mouvons, nous émouvons ce que nous touchons. Toucher à une bulle de savon pour éprouver sa résistance, c’est la faire éclater. Toucher une chose, c’est souvent la palper et l’explorer. Car toucher quelque chose peut consister à atteindre un point de contact avec cette chose – ce qui correspond à l’idéal du toucher du bout du doigt, tel le contact entre Dieu et Adam que Michel-Ange a représenté sur le plafond de la chapelle Sixtine dans la célèbre fresque « La création d’Adam » –, mais cela peut consister aussi, et tout aussi usuellement, à en toucher toutes les faces, à en éprouver la résistance, la texture, la température. Nous pourrions penser que, lorsque nous touchons, nous sommes supposé ne pas mettre de force dans ce touché, ne pas vouloir éprouver, modifier ce que nous touchons. Et de fait, et en principe, pour qu’il soit pertinent de dire que nous avons touché quelque chose, il n’est pas nécessaire que nous ayons exercé intentionnellement notre force sur cette chose. Mais toucher sans mouvoir, cela suppose non seulement de ne pas mettre de force, mais aussi de retenir sa force (ainsi que les forces qui s’exercent sur nous), car nous vivons dans un monde régi par la gravité, où la force est donc omniprésente. Si nous voulons toucher une bulle de savon sans la faire éclater (certaines résistent à un contact très doux), il nous faut retenir notre main attirée par la pesanteur vers le sol. Toucher, dans ce cas, c’est entrer en contact matériel avec quelque chose, éprouver sa résistance et s’arrêter là, ne pas tester davantage cette résistance, ne pas agir sur la chose. Notons cependant que, même dans le cadre de cette définition du toucher comme non efficace, toucher implique de toute façon une conscience motrice, le toucher n’étant pas dissociable d’une conscience de nos gestes et de notre corps. Il n’en demeure pas moins qu’une telle définition semble très restrictive, spécifique, relative, peut-être, à une compréhension scientifique ou cognitive du toucher, et qu’elle ne rend pas compte de toutes ses dimensions. Le sens du toucher, dans la vie, ne permet pas seulement de savoir si quelque chose existe, ou si cette chose est dure, molle, froide, chaude… on en use dans bien d’autres circonstances, où la force et le mouvement sont beaucoup plus clairement impliqués. La mise en évidence par Jean-Luc Nancy dans Corpus de tout un « corpus du tact » nous semble à cet égard tout à fait pertinente. Il fait la liste suivante :
« effleurer, frôler, presser, enfoncer, serrer, lisser, gratter, frotter, caresser, palper, tâter, pétrir, masser, enlacer, étreindre, frapper, pincer, mordre, sucer, mouiller, tenir, lâcher, lécher, branler, regarder, écouter, flairer, goûter, éviter, baiser, bercer, balancer, porter, peser… »[2].
Tous ces actes qui correspondent à des usages du toucher engagent évidemment une conscience de notre corps et de nos mouvements. Toucher, c’est se confronter à la résistance du réel autour de nous, mais tout autant prendre conscience de notre corporéité propre puisque, comme nous l’avons dit précédemment, l’un ne va pas sans l’autre. La sensibilité tactile est donc indissociable, en un certain sens, de la sensibilité kinesthésique.
Essayons de tirer un premier enseignement de notre analyse : le toucher est d’abord le sens du contact avec ce qui nous entoure, des repères dans l’espace, dans l’environnement, sens du contact qui ne va pas sans une sensibilité à notre propre corps. Avant de chercher à identifier et à connaître les choses qui nous entourent, nous prenons tout simplement des repères et nous nous tenons, debout, assis, couché… La notion d’objet semble ainsi avoir l’inconvénient de trop insister, de ce point de vue, sur l’intentionnalité, la visée, qui suppose une conscience, une attention de notre part, alors que nous touchons, nous sommes en contact, le plus souvent, avant toute activité, tout acte, pour prendre position dans le monde. À cet égard, l’avantage du toucher comme objet philosophique est qu’il met en première ligne non pas tout ce sur quoi nous tendons notre attention, mais tout ce qui nous entoure, et cela très immédiatement, très intuitivement. Si l’on essaye de se remémorer des sensations de toucher, de quoi se souvient-on ? Du fait d’entrer dans un bain chaud, dans des draps frais, de poser les pieds sur le sable : le sable, le bain, la literie fraîche ne sont pas des objets. Il n’y a alors pas d’unité, de foyer objectif que l’on touche, mais le monde autour de nous. Méthodologiquement, il convient peut-être, à cet égard, de se méfier du verbe « toucher », qui suppose pour nous une intentionnalité. Il faut laisser une place à l’ensemble du corpus du tact et du contact, plus que du toucher.
Un second enseignement que l’on pourrait tirer des analyses qui précèdent serait en outre qu’il n’y a pas d’objet en soi, par nature, par essence, mais uniquement des choses (nous souhaiterions ici ne préjuger en rien de la nature exacte de ce que sont « ces choses » lorsqu’elles ne sont pas des objets), qui parfois peuvent être qualifiées d’objet, parce qu’on les met devant soi et qu’on veut les examiner, comprendre leur fonctionnement ou les manipuler. Être un objet, en somme, cela ne serait qu’une possibilité parmi d’autres pour les choses dont le monde est fait.
Jeanne-Marie Roux (Paris I, Phi-co / ExEco) –