Le travail des républicains (1)
Quelques remarques au sujet de l’intégration du concept de travail dans le républicanisme contemporain (du 19e siècle à nos jours)
Vincent Bourdeau est MCF en philosophie à l’Université de Franche-Comté et membre du laboratoire Logiques de l’agir (EA 2274).
Dans la tradition républicaine, le travail n’a pas toujours joui d’une très bonne réputation, l’économie –l’oikos en grec– était renvoyée du côté de la sphère domestique, où l’accomplissement de l’homme en tant qu’homme ne pouvait avoir sa place. Le républicanisme dans une forme humaniste civique, entendait réserver aux activités civiques –à l’intervention du citoyen dans les assemblées, ou bien à ses actions militaires lorsque la Cité était en danger– le premier rôle pour qualifier positivement l’individu. Cette opposition entre république et travail fut longtemps inscrite dans une version élitiste de la république où la catégorie non inclusive de citoyenneté laissait hors de ses frontières les étrangers, les femmes, les travailleurs et les esclaves[1].
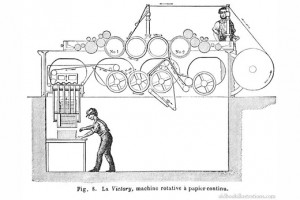
Mais cette opposition ne fut pas le propre de l’Antiquité. Elle s’est rejouée à un niveau d’intensité sans doute même jamais égalé au moment où l’économie politique –comme langage politique, c’est-à-dire comme discours visant à se substituer aux représentations traditionnelles de la distribution du pouvoir– a émergé au XVIIIe siècle[2]. Cette période fut celle de tensions entre la vertu et le commerce, entre langage républicain et langage de l’économie politique[3]. Il y aurait eu au cours du XVIIIe siècle, un fossé de plus en plus grand entre les nouvelles activités économiques caractéristiques des sociétés commerciales et les valeurs traditionnellement affichées par le républicanisme. Une synthèse libérale l’aurait emporté, caractéristique de la modernité, privilégiant la protection des individus, la promotion de leurs droits et la satisfaction de leurs besoins, plutôt que la constitution d’une communauté de citoyens égaux[4].
Toutefois une autre approche, par le bas et par les acteurs ordinaires, plutôt que par le haut et par les discours, permet de complexifier cette première lecture. Les travaux[5] d’E. P. Thompson ou, plus récemment, les essais de Christopher Lash, font apparaître que dans le milieu des artisans, un univers par essence focalisé sur le travail et la production, s’est bien opérée une forme d’imprégnation du discours républicain et radical[6].
Pour Lash, en effet, si la dimension commune qui caractérise les différentes variantes du républicanisme doit être cherchée du côté d’une définition de la vertu comprise comme ce qui permet, une fois possédé, « le développement le plus complet des capacités et pouvoirs humains », il n’est pas impossible, dans la sphère du travail, d’envisager certains modes organisationnels plus aptes que d’autres à favoriser ce développement[7]. Une telle perspective suppose une valorisation de la petite propriété privée, garante de l’indépendance individuelle, une maîtrise du processus de production (avec un travail guidé par la tâche plutôt que par le temps), une forme d’humilité dans la consommation ou de frugalité, autant d’éléments qui se retrouvent dans ce que R. Dagger juge caractéristique d’une économie civique aujourd’hui[8]. Au XIXe siècle, cela se traduit par une hostilité non au travail mais au travail tel qu’il se met en place sous le capitalisme industriel, et en particulier par un rejet de l’instauration du salariat.
Si le noyau théorique du républicanisme consiste en une définition de la liberté comme non domination, reste à saisir comment l’articulation de l’univers des artisans et celui des penseurs républicains a pu se faire[9]. Intégrer le travail dans le récit républicain revient à s’attaquer aux formes de domination qui lui seraient propres. Cette prise en compte de la ou des dominations liées au travail peut se comprendre théoriquement de plusieurs manières, on peut en caractériser au moins trois principales :
1- une domination personnelle, liée à la hiérarchisation des fonctions et à la subordination des ouvriers aux entrepreneurs, chefs, maîtres, etc. ; en résumé le travail comme lieu d’exercice arbitraire du pouvoir ;
2- une domination impersonnelle, liée à la nature même du travail tel que le capitalisme industriel naissant le modifie –notamment en exerçant une domination sur le temps sans précédent du fait même de la manière dont la valeur, en régime capitaliste, s’établit sur la base d’un travail social abstrait ; en résumé le travail comme instrument per se de domination[10] ;
3- enfin une inversion des valeurs, perçue comme telle du moins par les républicains et les travailleurs imprégnés des idées radicales, que le monde moderne a opérée au point de faire du travail l’activité sociale dominante, décrétant par là même la part (infime) qui est laissée à d’autres modes d’expérience de soi ; en résumé le travail s’imposant comme valeur des valeurs sociales en circulation.
La conscience de l’existence de « dominations » sévissant dans la sphère économique a pu nourrir le désir d’une « République appliquée » selon la formule utilisée par Ledru-Rollin en 1848 lors du débat sur le droit au travail et sur l’inscription de ce dernier dans la nouvelle Constitution. Nous pourrions définir cette république « appliquée » comme une république « répliquée » au sein même des unités de production[11]. La forme associative ou coopérative (dont l’histoire se prolonge jusqu’à Charles Gide au moins –économiste et militant coopérateur infatigable sous la IIIe République) est ainsi perçue comme l’introduction de la république au travail[12]. Si les milieux républicains bourgeois et intellectuels ont favorisé longtemps la version politique de la République, cette attitude change sous l’effet même de l’échec de 1848. Non pas tant l’échec de la Révolution, mais plutôt la conséquence effrayante de ce qui avait pourtant été à leurs yeux son succès : l’élection, au suffrage universel, d’un candidat, Louis Napoléon Bonaparte, qui s’était empressé aussitôt élu de renverser la République. L’opposition, constitutive du débat républicain dans la sphère publique, entre république « sociale » et république « tout court » s’est forgée dans cet entre deux que constitue l’histoire de la IIe République entre février et juin 1848, et s’est prolongée de façon larvée sous le Second Empire[13].
J’aimerais montrer comment, dans le cas de la France, ces deux variantes du républicanisme, « politique » (ou « élitiste ») et « radicale » (ou « populaire »), ont eu une trajectoire parallèle dans la décennie 1840 pour se rejoindre après l’échec de 1848 sur la critique du salariat, cette rencontre étant malgré tout rapidement reléguée au second plan dès la fin du Second Empire. J’indiquerai pour terminer comment des thématiques identiques sont réactivées dans les débats néo-républicains actuels centrés sur l’économie civique.
La république morale des ouvriers (1830-1848)
Comme a pu le suggérer J. Rancière dans La nuit des prolétaires, la révolution de 1830 est perçue par les travailleurs comme l’éclair qui a laissé entrevoir un monde nouveau aussitôt disparu[14]. On attendait l’introduction de la république dans l’atelier, la mise en place d’une « république morale » au sens d’une république qui irriguerait les mœurs – à « hauteur d’hommes » dit Proudhon à la même période. Si les travailleurs travaillent tout le jour, ils ne s’identifient pas exclusivement à leur métier : ils veulent pouvoir en garder ou en obtenir la maîtrise pour parvenir à maîtriser leur temps et faire fructifier, par cette maîtrise, la part de rêve qui anime leur nuit. Cette description n’est pas très éloignée de ce que décrit E. P. Thompson dans son essai « Temps, discipline du travail et capitalisme industriel »[15]. Dans ce dernier, Thompson montre à quel point les résistances aux nouvelles temporalités industrielles ont été fortes dans la première moitié du XIXe siècle en Angleterre et ailleurs en Europe, notamment en France. Le refus de la domination du travail sur l’existence elle-même est un trait partagé des deux côtés de la Manche. Rancière cite ainsi l’ouvrier Corbon, ancien petit rattacheur de fil, puis peintre en lettre, métreur, typographe, sculpteur sur bois, sur marbre, député de la IIe République, et sénateur de la IIIe, grand penseur du journal L’Atelier, pour qui le bon rapport au travail consiste à « dépenser le moins possible de force intelligente pour le meilleur salaire possible »[16].
L’association ouvrière va ainsi être pensée comme un lieu de maîtrise retrouvée, non seulement sur l’ouvrage mais aussi sur le temps et la sociabilité. Le travail devient un lieu de vie, avant d’être simplement réduit pour l’ouvrier à un lieu du travail sans phrase, comme dira Marx[17]. Ainsi, Rancière note-t-il que la réappropriation du procès de production par le travailleur ne se joue pas « dans le rapport entre ses instruments (qui sont à lui chez le maître autant qu’ici [dans l’association]) et son produit, mais d’abord dans le renversement de son rapport au temps »[18]. Ce renversement se traduit aussi par le refus de se laisser guider uniquement par les exigences internes de la production. Rancière donne ainsi l’exemple des facteurs de pianos réunis en association, dont le premier bénéfice, loin d’être transformé en capital donne lieu à un banquet, « un repas fraternel qui réunit les femmes et les enfants ». Et Rancière de commenter : « la République morale des ouvriers ne s’identifie pas exactement au règne du travail producteur »[19].
Lors de la Révolution de 1848, les débats sont vifs pour établir une « république » sociale. On connaît l’histoire des Ateliers nationaux, l’histoire de leur échec dans un contexte de chômage massif, et de leur retournement en ateliers d’aide aux sans-travail, d’assistance en somme, bien loin de l’idéal de l’association ouvrière défendue dans les années 1840. Pour les partisans convaincus de l’importance de l’installation de la république, comme régime politique, le sacrifice des aspects sociaux de la Révolution de Février, paraît un moindre mal. Beaucoup sont d’ailleurs convaincus que la République n’a pas à irriguer l’ensemble des activités sociales, mais doit s’incarner dans les grandes institutions politiques (État, Assemblée, etc.), c’était le sens de leur engagement dans les années 1840, notamment lors de la campagne des Banquets. La victoire de Louis Napoléon Bonaparte à la première élection présidentielle au suffrage universel, la dérive impériale du régime, puis le renversement de la République ne manquent pas de susciter doutes et interrogations sur la voie privilégiée jusqu’alors.
Prévenir les dominations économiques ou pourquoi la république doit entrer dans l’atelier après 1848
Un bon indice de l’acclimatement de la pensée républicaine à la question du travail est donné par la place que lui accorde Vacherot dans un ouvrage de 1859 alors célébré : La Démocratie. Ce texte, en grande partie de circonstance puisque écrit dans les années 1850 alors que l’échec de 1848 est encore présent dans les esprits, et que le terme même de république a été banni du discours public, se présente, de manière à peine voilée, comme un appel à renouer avec l’idéal républicain contre la dérive autoritaire du Second Empire[20].
Le programme de la démocratie indiqué au début de l’ouvrage permet de prendre la mesure du travail de redéfinition du terme « démocratie » dont les années 1850 ont été le théâtre, et de la nécessité qui se manifeste alors d’y inclure une dimension économique : « Dans l’ordre économique, affirme Vacherot, elle remplace partout où cela est possible, le salariat, le patronage par l’association libre. En un mot elle veut la liberté sous toutes les formes, pour toutes les conditions de la sociétés »[21].
Si les thèmes « classiques » du républicanisme sont rappelés, les conditions sociales et économiques de la démocratie sont désormais mises en avant. Il s’agit de prendre en compte toutes les conditions qui doivent être réunies pour assurer l’autonomie du citoyen. Le projet économique de la démocratie est ainsi immédiatement avancé, qui préconise de remplacer le salariat par l’association libre :
Tant que le travail conservera l’organisation actuelle, l’ouvrier sera plus ou moins sous la main du maître. Un pareil état de choses, alors même que l’ouvrier y trouverait le bien-être et les loisirs qui lui manquent, n’en serait pas moins contraire par ce côté au principe démocratique[22].
Exclure les formes de domination qui perdurent dans une société salariale, n’implique pas seulement une intervention protectrice de la part de l’État selon Vacherot, mais une promotion réelle des conditions économiques de l’autonomie, qui se ramènent à la démocratisation de la propriété via l’association[23]:
En somme, sauf le cas exceptionnel des fonctionnaires publics, on peut dire que les conditions d’indépendance pour les diverses classes de la société, se résument toutes en une, la propriété […]. Le travail n’est libre que dans la propriété ; le travailleur n’est indépendant que par la propriété. Tout autre régime du travail est un patriciat plus ou moins libéral, plus ou moins doux, dont le démocrate ne peut s’accommoder[24].
Le recours à l’association va jouer ainsi sur un triple ressort. 1) Elle est d’abord la condition classique d’accès à la citoyenneté puisqu’elle assure aux associés le statut de propriétaires. 2) Mais, contrairement à la petite propriété des paysans, qui isole l’individu, elle relève en plus d’un apprentissage moral de la démocratie dans la mesure où elle intègre l’idée que la propriété privée peut être soumise aux contraintes de décisions communes (celles de l’association) : on doit faire appel à elle, comme le suggère Vacherot, parce qu’elle permet de dépasser les limites de la propriété individuelle. 3) Elle bénéficie enfin de l’avantage certain de sa compatibilité avec les développements les plus récents de l’activité économique, bref de son caractère résolument moderne. Elle seule permet de répondre à la question que posait Vacherot lorsqu’il se demandait « quelle serait l’organisation du travail qui satisferait » au principe démocratique. Une expression résume cet démocratisation du travail que Vacherot appelle de ses vœux : « travailler pour soi en travaillant pour tous »[25]. Vacherot renverse ainsi la définition de la liberté du travail, que l’on trouvait chez les Économistes, selon laquelle c’est en travaillant pour soi que l’on travaille pour tous :
Le régime de l’association, écrit-il, substitué au régime du patronage, serait un immense progrès, quant à la dignité, à la liberté, à la démocratie. Un atelier où chacun ne dépend que de tous, où le seul maître est la société elle-même ; où toute autorité est élective, toute direction une fonction amovible ; où tout ordre personnel n’est que la voix du règlement librement convenu entre tous les membres de cette société ; où tout ouvrier est propriétaire, et travaille pour soi en travaillant pour tous […] quel beau spectacle comparé à la servitude de nos ateliers actuels ! C’est la démocratie réalisée dans l’industrie[26].
Cette position, qui suscite l’adhésion de la majorité des républicains, se voit toutefois remise en question par ceux des républicains pour qui seul le régime politique républicain –et non une société ou une économie républicaine– doit être défendu. Une autre option, qu’incarne Cernuschi, banquier et républicain, consiste à valoriser le salariat en reconnaissant qu’il est compatible avec l’idéal républicain si certaines conditions de sa mise en œuvre sont précisées.
Les prises de position sur le salariat de Cernuschi s’inscrivent dans le contexte de mise en discussion du projet de loi sur les associations qui aboutira à la loi du 24-29 juillet 1867 dit loi sur les sociétés. L’opposition d’un républicain convaincu, comme l’est H. Cernuschi, aux sociétés coopératives illustre l’option, assez rare chez les républicains du Second Empire, d’une défense du travail qui ne passe pas par le souci de diminuer le rôle du salariat dans l’organisation des activités économiques, mais qui nécessite au contraire d’en fortifier le statut et les droits. De son exposé fait devant la Commission du Corps législatif, il tirera la matière d’un ouvrage au titre explicite : Illusions des sociétés coopératives[27].
Cette option, qui finira par l’emporter sous la IIIe République, jusqu’à la création d’un droit du travail, est encore minoritaire chez les républicains du Second Empire. Selon Cernuschi, la seule spécificité que l’on peut reconnaître aux sociétés coopératives est qu’elles se constituent généralement avec peu de capital, il faut donc simplement aménager un cadre juridique qui leur permette d’accroître ce capital sans complication : il faut qu’elles puissent accueillir de nouveaux associés, que le nombre de titres de propriété puisse s’étendre tout en étant adossé à de faibles apports. Mais une telle formule, selon lui, comporte un risque social important : celui, pour l’ouvrier, de perdre le peu de capital qu’il parvient à épargner, qui pourrait se voir engloutir dans la structure coopérative. Ici ce n’est plus le thème classique du maître et de l’esclave – récurrent dans l’ouvrage de Vacherot – qui est mobilisé, mais celui, tout aussi républicain, de la « Fortuna », les aléas ou hasards de l’existence, contre lesquels la République, classiquement, se veut un rempart.
Pour le dire autrement, le républicanisme d’H. Cernuschi n’est pas opposé par principe au salariat, contrairement au sentiment majoritaire dans le camp républicain qu’illustrait bien le texte de Vacherot. L’association comme sortie du salariat est une mauvaise solution, qui desservira le bien-être des ouvriers. Avec Cernuschi, apparaît une forme d’accommodement du républicanisme à l’idée que toutes les sphères sociales ne sont pas également accueillantes aux principes républicains, ce qui n’empêche pas de promouvoir un rôle protecteur de l’Etat là où une application de tels principes n’est pas souhaitable. Si elle est minoritaire sous le Second Empire, l’option qui consiste à accorder les principes de la démocratie avec ceux de l’économie politique, en subordonnant les seconds aux premiers, se fera de plus en plus inaudible sous la Troisième République, elle devient alors bien souvent confondue avec l’aventure communiste. Il faut, me semble-t-il, attendre les années les plus récentes pour voir surgir à nouveau ce thème au sein des théories républicaines[28].
[1] Sur cette question, voir : Pettit P., « Préface », in V. Bourdeau et R. Merrill (dir.), La république et ses démons. Essais de républicanisme appliqué, Paris, éditions è®e, 2007, p. 7 et suivantes. Et plus généralement : Pettit P., Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, Gallimard, 2004[1997], en particulier chapitre 1.
[2] Hont I. & Ignatieff M., Wealth and Virtue : the Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightment, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
[3] Pocock J.G.A., Vertu, commerce et histoire, Paris, Presses Universitaires de France, 1998[1985].
[4] La pensée sociale écossaise, et l’économie politique de Smith en particulier, apparaissent ainsi comme : « [u]ne théorie d’une pluralisation de la personnalité humaine […] présentée comme une alternative idéologique à l’idéal classique de la personnalité unifiée par la pratique de la vertu civique et par une économie relativement statique », in J. Pocock, « Cambridge Paradigms and Scotch Philosophers : a Study of the Relations between the Civic Humanist and the Jurisprudential Interpretation of Eighteenth-Century Social Thought », in Wealth &Virtue, op. cit., p. 245 [ma traduction]. Voir aussi: Spitz J.-F., La liberté politique. Essai de généalogie conceptuelle, Paris, Presses Universitaires de France, 1995.
[5] Thompson E.P., La Formation de la classe ouvrière anglaise, Hautes études/Gallimard/Seuil, 1988 ; Lash Ch., Le Seul et vrai paradis. Une histoire de l’idéologie du progrès et de ses critiques, Paris, Champs/ Flammarion, 2006[1991].
[6] La liste des caractères de ce radicalisme populaire est la suivante : « Ses traits distinctifs […] incluaient une défense des petits fermiers, artisans et autres « producteurs » ; une opposition aux organismes de crédit publics, aux spéculateurs, banquiers, et intermédiaires ; une opposition à la culture entière de l’ascension sociale et du « progrès » ; et un réquisitoire de plus en plus détaillé et éloquent dirigé contre l’humanitarisme, la philanthropie, la réforme sociale et la bienveillance universelle – ce que Cobbett nommait avec mépris le « réconfortant système » », Lash C., op. cit., p. 219.
[7] Idem, p. 207.
[8] Dagger R., « Neorepublicanism and the Civic Economy », Politics, Philosophy, Economics, Juin 2006, Vol. 5, N°2, pp. 151-173.
[9] Pettit définit la liberté comme non domination de la manière suivante : « Les individus sont libres dans la mesure où ils ne sont pas dominés par d’autres agents, que ces agents soient privés ou publics, individuels ou collectifs. Par domination, on entend que A domine B si A a le pouvoir (qu’il l’exerce ou non) d’interférer de façon arbitraire dans la liberté de B », in « Remanier le républicanisme », V. Bourdeau & R. Merrill, La République et ses démons, op. cit., p. 5. Le fait d’éradiquer les interférences arbitraires est l’objectif d’un gouvernement républicain. Cet objectif peut emprunter deux voies selon Pettit : 1) celle d’un dispositif constitutionnel par laquelle l’Etat protège les citoyens et prévient toute domination ; 2) celle de la réciprocité des pouvoirs qui consiste à doter les individus d’atouts personnels pour les mettre en situation de lutter par eux-mêmes contre les phénomènes de domination, voir : Pettit P., Républicanisme, op. cit.
[10] Sur ce sujet, voir Postone M., Temps, travail et domination sociale, Paris, Mille et Une Nuits, 2009.
[11] Ledru-Rollin, discours lors du débat sur le droit au travail à l’Assemblée en 1848, in J. Garnier (éd.), Le droit au travail à l’Assemblée, recueil de tous les discours prononcés dans cette mémorable discussion, Paris, Guillaumin, 1848, p. 123.
[12] Les deux termes ont des usages similaires mais décalés dans le temps : l’association est le terme en usage jusqu’en 1848, la coopérative prend le pas sur l’association à partir des débats du Second Empire. Il permet pour ses promoteurs d’éviter la confusion avec le terme « association », disqualifié en partie par le Ateliers nationaux en 1848.
[13] Voir M. Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la république, Paris, Seuil, 1972. L’histoire même de 1848, selon M. Agulhon, est travaillée par l’opposition entre deux versions de la République : février 1848 et juin 1848. Cette tension historique est constitutive de deux modèles républicains qui travaillent toujours, selon lui, notre modernité politique : un modèle politique et un autre plus social.
[14] Voir en particulier le chapitre 2, « La porte du paradis », in J. Rancière, La Nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Paris, Hachette/ Pluriel, 1997, pp. 36-60.
[15] Voir Thompson E.P., Temps, discipline du travail et capitalisme industriel, Paris, La Fabrique, 2004.
[16] Cité in Rancière J., Nuit des prolétaires, op. cit., p. 74.
[17] Marx K., Introduction générale à la Critique de l’économie politique (1857), in Philosophie, Folio/Essai, p. 476.
[18] Idem, p. 89.
[19] Ibid., pp. 328-9.
[20] Cela vaudra à son auteur condamnation et emprisonnement. Sur le contexte de parution, le procès, l’importance de l’ouvrage pour les républicains, voir : Sudhir Hazareesingh, « The Ambiguous Republicanism of Étienne Vacherot », Intellectual Founders of the Republic : Five Studies in Nineteenth-Century French Republican Political Thought, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 129-65.
[21] Vacherot E., La Démocratie, Chamerot, 1859-60, p. XVII.
[22] Idem, p. 151.
[23] Le verbe « démocratiser » fait son apparition dans ces années-là précisément, Vacherot l’utilise dans La démocratie, en prenant le soin d’excuser l’usage d’un néologisme : « il est possible de démocratiser (qu’on nous passe le barbarisme) », Ibid., p. 272.
[24] Ibid., p. 153.
[25] Ibid., p. 183.
[26] Ibid.
[27] Cernuschi H., Illusions des sociétés coopératives, Paris, Librairie internationale A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, Guillaumin, 1866.
[28] On peut considérer que la première synthèse, signe d’un champ d’études en voie de constitution, date de 2006. Le premier colloque sur la question s’est tenu en France en 2007. Voir : Politics, Philosophy & Economics, Juin 2006, Vol. 5, N°2.














