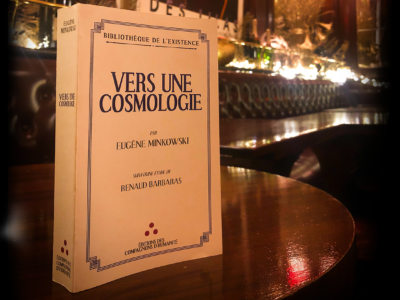L’épistémologie de l’obstétrique masque-t-elle les problématiques de genre?
Claire Michel est psychologue clinicienne et doctorante en contractuelle en psychopathologie et psychanalyse à l’Université de Paris, rattachée au Centre de recherches psychanalyse, médecine et société (CRPMS).
Résumé :
Quelle place pour le genre en obstétrique ? Du fait de l’histoire de sa constitution scientifique, de sa diffusion, des conditions de sa mise en pratique, de son objet, de ses effets, cette interrogation paraît particulièrement pertinente. Par son ancrage dans un référentiel biologique et son désir de s’inscrire dans ce qui fait actuellement les normes de la scientificité, l’obstétrique semble en effet méconnaître les problématiques politiques et sociales qui la traversent pourtant, et dont les répercussions sont visibles dans le discours des femmes ayant accouché il y a peu. Cet article se propose d’interroger l’épistémologie médicale au prisme des études de genre, en s’appuyant sur les travaux existants ainsi que sur une recherche menée en service de maternité. Sont alors mis en lumière de nouveaux enjeux, qui permettent de replacer la médecine dans le contexte d’émergence qui est le sien, et qui en fonde les ressorts.
Mots-clés : obstétrique ; épistémologie ; genre ; corps féminin
Abstract :
What place for gender analysis in obstetrics ? Due to the history of its scientific formation, its diffusion, the conditions for its application, its area of interest, its impacts, this question intensifies. Obstetric’s establishment in a biologic reality that answers to the current scientific paradigm seems to keep political and social issues at stake unseen, while these issues can be noticed in new mothers’ discourse. This article aims at examining medical epistemology through reflexions brought by gender studies, building on both existing works and a research conducted in maternity wards. By doing so, new matters are emphasized, and medicine can be placed in the context in which it emerged, and which established its foundations.
Keywords : obstetric; epistemology; gender; women’s body
Introduction
Si la médecine peut tout entière être interrogée par le regard apporté par les études de genre, l’obstétrique est une spécialité qui paraît s’y prêter tout particulièrement, en raison de son objet d’étude et de pratique : la grossesse et l’accouchement. Se pencher sur la constitution progressive du savoir obstétrical ainsi que sur sa mise en œuvre dans le cadre d’une prise en charge hospitalière permet alors de dégager ce qu’il construit du corps – tout particulièrement féminin -, selon des modalités, des effets, et des points aveugles persistants spécifiques.
Au cours du XXe siècle, les différentes approches des sciences humaines ont montré comment les corps et leurs représentations étaient largement façonnés par leur époque, au travers des normes qui les traversent, en induisent les représentations, et modèlent la façon dont ils sont manipulés par les acteurs sociaux – institutions, collectif, individus. Ainsi, les corps, dans la façon dont ils se pensent mais également dont ils se vivent, ne pourraient être envisagés en dehors d’un référentiel socialement et historiquement situé faisant appel aux sciences les plus diverses, depuis la médecine jusqu’à la politique, en passant par la biologie et la sociologie. Plus spécifiquement, depuis le XVIIIe siècle et de façon exponentielle au fil de ses avancées, la médecine « incarne dans nos sociétés un savoir en quelque sorte officiel sur le corps »[1]. Ce processus est en lien étroit avec ce que l’on nomme médicalisation, qui se définit par le fait que « certaines conditions, situations ou données – organiques, psychologiques, sociales ou comportementales – de la vie quotidienne deviennent des questions médicales, auxquelles médecins et autres professionnels de la santé […] se doivent d’apporter un certain nombre de réponses »[2]. Pris dans ce référentiel qui en devient donc la principale source d’informations, le corps devient anatomie, se retrouve pris dans une dialectique divisant santé et maladie, se lit dans ses organes et se mesure dans ses constantes vitales. De façon plus spécifique, l’histoire de l’émergence de l’obstétrique, en tant que spécialité médicale qui s’occupe d’individus n’étant a priori pas malades, illustre de façon exemplaire, mais également propre à son objet, ce processus de médicalisation en tant qu’ « extension du domaine sanitaire sur le social »[3].
À ces réflexions, l’émergence des études de genre dans la seconde moitié du XXe siècle et leur enrichissement constant amène l’idée selon laquelle il est possible de penser non seulement la dimension située du corps, mais également la spécificité des représentations et du traitement de certains corps par rapport à d’autres, en tant que le corps est un lieu d’expression du genre. Ici, le genre peut alors être défini comme un « système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées (masculin/féminin) »[4].
 Ainsi, les études de genre, lorsqu’appliquées à l’obstétrique, amènent à une réflexion épistémologique de cette discipline, celle qui consiste en « une analyse de sa structure interne actuelle »[5], qui s’intéresse à la façon dont un savoir s’est constitué et aux effets de ce processus en tant qu’il est historiquement et socialement situé. La médecine moderne, et l’obstétrique ne fait pas exception, tend depuis son émergence à produire un savoir autour du corps humain qui se voudrait universel et objectif[6], suivant des principes qui souhaiteraient se rapprocher de la définition actuelle de la science, en produisant « autour de [l’individu] un langage rationnel »[7]. Or, présenter un champ de connaissance comme objectif, c’est aussi nier l’influence sur sa production de ses conditions d’émergence et de diffusion, ce qui présente le risque d’une décontextualisation du savoir, donnant l’illusion d’une vérité apolitique, asociale et anhistorique. Il semble alors qu’apporter à l’étude de l’épistémologie médicale les apports des études de genre permettrait de replacer l’obstétrique dans ce contexte d’émergence, de théorie et de pratique qui est le sien, par le biais de l’étude des normes et des représentations de genre autour desquelles elle a émergé, et qu’elle contribue aujourd’hui à produire.
Ainsi, les études de genre, lorsqu’appliquées à l’obstétrique, amènent à une réflexion épistémologique de cette discipline, celle qui consiste en « une analyse de sa structure interne actuelle »[5], qui s’intéresse à la façon dont un savoir s’est constitué et aux effets de ce processus en tant qu’il est historiquement et socialement situé. La médecine moderne, et l’obstétrique ne fait pas exception, tend depuis son émergence à produire un savoir autour du corps humain qui se voudrait universel et objectif[6], suivant des principes qui souhaiteraient se rapprocher de la définition actuelle de la science, en produisant « autour de [l’individu] un langage rationnel »[7]. Or, présenter un champ de connaissance comme objectif, c’est aussi nier l’influence sur sa production de ses conditions d’émergence et de diffusion, ce qui présente le risque d’une décontextualisation du savoir, donnant l’illusion d’une vérité apolitique, asociale et anhistorique. Il semble alors qu’apporter à l’étude de l’épistémologie médicale les apports des études de genre permettrait de replacer l’obstétrique dans ce contexte d’émergence, de théorie et de pratique qui est le sien, par le biais de l’étude des normes et des représentations de genre autour desquelles elle a émergé, et qu’elle contribue aujourd’hui à produire.
Cette démarche pourrait être résumée dans l’interrogation suivante : dans quelle mesure ce positionnement du savoir dans l’obstétrique entretient-il, tout en les invisibilisant, des représentations des corps féminins profondément situées dans un contexte social, qui se font à la fois causes et conséquences d’un façonnement de ces corps ?
Dans cette optique, le recours à l’histoire permet de mettre en lumière les ressorts de la construction de l’obstétrique comme science, définissant alors les modalités de la médicalisation de la grossesse et de l’accouchement, et ainsi de comprendre les fondements qui déterminent les conditions de son développement et de son exercice en tant que ces derniers sont socialement et historiquement situés. Cette démarche d’historicisation révèle la façon dont cette discipline s’est constituée sur un ensemble de déplacements, qui définissent également les modalités de transmission du savoir obstétrical. Sans être anachronique, une telle démarche permet de souligner l’inscription effective de la science obstétricale dans un tel référentiel, ce qui permet ensuite d’en circonscrire les effets sur les corps. Mis en lien avec le façonnement des corps en obstétrique, cela a également pour effet de resituer le savoir dans un dispositif au sens foucaldien du terme, celui qui désigne « un ensemble hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref : du dit aussi bien que du non-dit »[8].
I – Le savoir en obstétrique : trajectoire et déplacements
« Ce n’est certainement pas à l’épistémologie de juger de la véracité des allégations scientifiques, mais à la science. Il lui importe, par contre, d’en restituer le passé, d’insister moins sur le caractère temporaire d’une résolution que sur l’actualité d’un questionnement »[9]. Une démarche épistémologique – qui plus est, historique, suivant la pensée d’auteurs tels que Georges Canguilhem ou Michel Foucault – cherche donc non pas à évaluer les concepts ou les pratiques, mais bien à forger une théorie de la connaissance en tant qu’elle s’intéresse aux « conditions constitutives »[10] d’un savoir. Ainsi, la façon dont l’obstétrique s’est constituée en tant que discipline scientifique spécifique et délimitée n’a rien d’anodin : c’est cela qui coud les pratiques, sous-tend la prise en charge, et guide le regard médical. Depuis maintenant plusieurs siècles, la prise en charge de la grossesse et l’accouchement s’inscrit dans un mouvement de médicalisation, qui hisse le savoir médical au rang de savoir légitime et officiel sur ces événements[11]. Or, si la légitimité du savoir obstétrical, alors dominant, a entraîné la dévalorisation, voire l’effacement, d’autres formes de savoir pré-existantes alors considérées comme erronées, superflues ou infondées[12], l’historicisation de cette légitimité apporte à cette dernière une nuance importante.
« Jusqu’au XVIIIe siècle, l’accouchement ne se conçoit pas sans accoucheuse »[13], et est un événement essentiellement féminin. Les femmes accouchent chez elles, entourées de femmes proches et accompagnées par cette figure centrale, celle de l’accoucheuse – ou matrone[14]. À cette dernière, « on ne demandait aucune science spéciale, l’expérience lui venait avec la pratique »[15], son savoir et son savoir-faire s’enracinent souvent dans son expérience propre de maternité, ainsi que dans celle des femmes accompagnées. Ce savoir que l’on peut qualifier d’empirique, car basé sur l’expérience et l’observation, répond essentiellement à des modalités de transmission orales[16], qui soutiennent un tissage de connaissances autour du corps des femmes et de ses mécanismes. Le savoir s’inscrit dans des gestes, dans des regards, dans des sensations, et ne s’outille qu’assez peu, si ce n’est par les objets du quotidien détournés[17].
Dans ce paysage, peu de personnages masculins, puisque « de l’accouchement, les hommes étaient en général exclus, sauf en cas d’extrême urgence »[18]. Si cette exclusion concernait le père de l’enfant lui-même, elle s’appliquait également aux médecins, qui n’étaient appelés qu’en dernier recours – ou par des femmes de milieux aisés[19]. Peu d’hôpitaux également, puisque, si l’Office des accouchées de l’Hôtel Dieu, première forme de maternité, est créé à la fin du XIVe, la mortalité à l’hôpital est extrêmement élevée. Y accouchent les femmes appartenant aux classes sociales les moins aisées, ou chez lesquelles la grossesse induit une situation précaire[20], la plupart des femmes donnant naissance à domicile.
C’est au début du XVIIIe siècle que la plupart des historiens de la naissance situent le début du processus de médicalisation de la grossesse et de l’accouchement. Les raisons en sont, comme pour tout changement de paradigme, complexes et variées. D’une part, « la mortalité infantile […] commence à être perçue comme un gaspillage scandaleux »[21]. L’État, mû par le désir d’une puissance nationale accrue reposant notamment sur une population nombreuse et en bonne santé, porte un intérêt nouveau à la grossesse et à l’accouchement en ce qu’ils ont un impact surla santé de la population, femmes ou nouveau-nés. D’autre part, au-delà de questions sanitaires, le XVIIIe siècle est également une période de profonds changements sociaux, tandis que s’amorce le siècle des Lumières. Ainsi, « la famille est alors ébranlée dans ses fondements »[22] : les liens entre les acteurs familiaux se modifient, l’individu lui-même n’est plus perçu ou représenté de la même façon, ainsi que ses liens avec le monde qui l’entoure[23].
Puisque du taux de mortalité maternelle et infantile dépendent la santé et l’accroissement de la population, petit à petit, la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement commence à être envisagée comme relevant de la compétence des médecins : la naissance devient « scène médicale »[24], dans une perspective qui lie donc médecine et sécurité. Dès le début du XVIIIe siècle, des statuts, des règlements, des amendements organisent progressivement le nouvel ordre des professionnels de l’accouchement. La matrone devient « suspecte : sa pratique est mal connue, on la suppose imprégnée de magie »[25], et tend à disparaître.
Ceci dit, si ce processus de médicalisation bouleverse les pratiques établies et mène à la prise en charge obstétricale que nous connaissons actuellement, il ne se fait pour autant pas sans résistances – institutionnelles, sociales, individuelles. Les réticences ayant accompagné l’arrivée des hommes sur la scène de l’accouchement s’en font l’illustration. En effet, si les sages-femmes sont des femmes, les médecins, eux, sont des hommes – la première inscription d’une femme en études de médecine datant de 1866[26]. Or, « l’accoucheur n’est pas pour autant accepté d’emblée par la femme en couches. […] Le recours à l’accoucheur introduit en effet une dimension nouvelle dans les rapports entre la femme et l’homme de l’art : celle de la morale sexuelle »[27]. Les médecins accoucheurs sont alors toujours « [suspects] d’intentions lubriques »[28], et il s’agit à la fois de ne pas rendre le mari jaloux et de préserver la pudeur de la femme, qui hésitent alors à consulter un homme pour cette raison[29]. Si ces réticences sont finalement et progressivement surmontées, non sans heurts, et au prix de « la désexuation et de la sécularisation [de l’accouchement] »[30], c’est que « le souci de l’intégrité et de la sécurité l’emporte progressivement sur la pudeur »[31] : les complications de l’accouchement ne sont plus perçues comme faisant partie de la vie, mais comme un risque que les femmes souhaitent de moins en moins prendre. En effet, avec l’arrivée de la médecine sur la scène de la grossesse et de l’accouchement, ce ne sont pas seulement les pratiques qui en sont redéfinies, mais également les représentations. En devenant un acte médical, l’accouchement en prend aussi la portée : la médicalisation a pour effet de « transformer l’heureux événement en une prouesse scientifique et technique »[32] qui, en tant qu’événement comportant des risques mortels, se doit d’être entouré par un registre médical perçu comme sécurisant.
 Le changement de paradigme que représente la médicalisation de l’accouchement entraine donc une série de mutations, qui concernent directement le savoir, sa détention, sa transmission et ont des effets sur les pratiques actuelles. L’opposition classiquement présentée entre empirisme et démarche scientifique en est un exemple, et est l’un des ressorts centraux de l’histoire de la constitution de la science obstétricale. En effet, aux débuts de la médicalisation, savoir et savoir-faire sont présentés comme clivés entre les professions : « à la pratique sans la théorie, qui caractérise l’exercice des matrones, les accoucheurs ne peuvent guère opposer pendant longtemps que la théorie sans la pratique »[33]. Petit à petit, au fil de l’arrivée de la médecine dans ce champ, le vocabulaire s’étoffe et s’inscrit dans un référentiel médical, l’utilisation de la langue latine – langue savante – devient fréquente, les corps sont représentés par des coupes anatomiques, les enseignements se font plus théoriques[34]. Or, si la médecine se base historiquement sur un savoir-faire au plus près du corps des personnes prises en charge, l’avènement de la médecine moderne dans les siècles derniers n’a pu se faire qu’en articulant ce savoir avec un discours rationnel, correspondant au référentiel scientifique dominant : « on pourra enfin tenir sur l’individu un discours à structure scientifique »[35]. Si l’objet de la science médicale est toujours le sujet et son corps, on cherche à construire autour de cet objet un discours scientifique, qui par là même « devient l’apanage […] d’un groupe de spécialistes »[36]. Ainsi, progressivement, l’empirisme, qui représenterait un savoir d’expérience, ne fait plus foi, et en vient même à s’opposer à la démarche scientifique en tant qu’elle circonscrit désormais le savoir clinique. Avec la disparition des matrones, c’est donc aussi la disparition d’un savoir d’expérience traditionnel féminin qui se joue et qui est considéré comme dangereux par le nouveau paradigme médical, qui le qualifie d’obscurantisme[37]. Par la création de cette opposition que l’on a défini par celle entre empirisme et scientificité, « le monde des femmes, empirique, coutumier, affectif, sera peu à peu disqualifié face au monde des hommes, qui se veut rationnel, novateur, volontaire. […] La science s’empare de l’heureux événement »[38].
Le changement de paradigme que représente la médicalisation de l’accouchement entraine donc une série de mutations, qui concernent directement le savoir, sa détention, sa transmission et ont des effets sur les pratiques actuelles. L’opposition classiquement présentée entre empirisme et démarche scientifique en est un exemple, et est l’un des ressorts centraux de l’histoire de la constitution de la science obstétricale. En effet, aux débuts de la médicalisation, savoir et savoir-faire sont présentés comme clivés entre les professions : « à la pratique sans la théorie, qui caractérise l’exercice des matrones, les accoucheurs ne peuvent guère opposer pendant longtemps que la théorie sans la pratique »[33]. Petit à petit, au fil de l’arrivée de la médecine dans ce champ, le vocabulaire s’étoffe et s’inscrit dans un référentiel médical, l’utilisation de la langue latine – langue savante – devient fréquente, les corps sont représentés par des coupes anatomiques, les enseignements se font plus théoriques[34]. Or, si la médecine se base historiquement sur un savoir-faire au plus près du corps des personnes prises en charge, l’avènement de la médecine moderne dans les siècles derniers n’a pu se faire qu’en articulant ce savoir avec un discours rationnel, correspondant au référentiel scientifique dominant : « on pourra enfin tenir sur l’individu un discours à structure scientifique »[35]. Si l’objet de la science médicale est toujours le sujet et son corps, on cherche à construire autour de cet objet un discours scientifique, qui par là même « devient l’apanage […] d’un groupe de spécialistes »[36]. Ainsi, progressivement, l’empirisme, qui représenterait un savoir d’expérience, ne fait plus foi, et en vient même à s’opposer à la démarche scientifique en tant qu’elle circonscrit désormais le savoir clinique. Avec la disparition des matrones, c’est donc aussi la disparition d’un savoir d’expérience traditionnel féminin qui se joue et qui est considéré comme dangereux par le nouveau paradigme médical, qui le qualifie d’obscurantisme[37]. Par la création de cette opposition que l’on a défini par celle entre empirisme et scientificité, « le monde des femmes, empirique, coutumier, affectif, sera peu à peu disqualifié face au monde des hommes, qui se veut rationnel, novateur, volontaire. […] La science s’empare de l’heureux événement »[38].
Les mutations qui concernent le savoir obstétrical participent alors toutes à faire de l’obstétrique le savoir de référence autour de la grossesse et de l’accouchement, et des médecins les détenteurs quasi exclusifs de ce dernier. L’histoire et ses déplacements, bien loin d’indiquer une continuité dans ce savoir et dans ce qu’il complique des représentations du corps des femmes, pointent plutôt un choc épistémologique. Or, nous l’avons vu, de la légitimation d’un savoir découle l’effacement au moins partiel de son caractère situé, ce qui entraîne du même coup l’effacement des caractéristiques sociales du contexte dans lequel ce savoir émerge et est nécessairement pris : un aspect de la construction du savoir que nous permet de penser le concept foucaldien de régime de vérité[39]. Ainsi, « les systèmes de savoir […] fournissent les critères d’énonciation et de diffusion de ce qui est reçu, à un moment, comme vrai »[40]. « À un moment », souligne l’auteur. Or, retiré de ce contexte historique et social, le savoir s’en trouve presque déraciné, perçu comme ayant une existence anhistorique et apolitique.
Par l’analyse de ces modalités de constitution du discours scientifique, une autre perspective peut être pensée qui propose de « sortir d’une pensée opposant [savoir d’expertise et savoirs d’expérience] »[41], et permet de penser l’accouchement comme un moment mobilisant des vécus corporels et psychiques qui peuvent être soutenus par un savoir qui ne s’y oppose pas, mais les accompagne. Or, il semble que le genre puisse être dans cette démarche un outil de pensée crucial permettant de mettre au jour une « coconstruction de la santé et du genre »[42]. Par le biais de cette dernière, la médecine naît d’une société pétrie par des représentations de genre qui transparaissent dans son histoire et en conditionnent la pratique, mais devient également vectrice de normes, jusqu’à « produire une norme de santé féminine »[43]. Penser l’épistémologie et les pratiques obstétricales en faisant appel au genre, c’est se donner la possibilité d’une mise au jour des ressorts du discours médical qui, bien loin d’être neutre et objectif, est au contraire largement situé, et a des effets sur son objet : ici, le corps des femmes.
II – De la détention du savoir et de sa transmission
« Les filles de mon entourage, elles en parlent pas trop, parce que j’ai pas arrêté de leur poser des questions sur leur accouchement, elles me disent “non, ça va !”. Et en fait non, parce qu’une fois que j’ai accouché et que j’ai un peu parlé avec elles, elles me disent “non mais en fait c’était horrible”, mais elles le disent après, moi j’aurais préféré le savoir avant ! »
Parmi les thèmes dégagés d’entretiens de recherche menés en maternité dans le cadre d’un travail de doctorat[44], ceux du savoir et de la transmission occupent une place particulièrement importante, et s’entendent dans les paroles de nombreuses femmes. Les paroles rapportées ici en constituent un exemple, dans lequel se perçoit alors la façon dont, pour certaines femmes, un savoir sur l’accouchement est venu à manquer, parfois jusqu’à faire violence. Dans ces phrases est évoquée une forme de tabou que l’on retrouve régulièrement dans les entretiens, couplée d’un appel à des figures féminines proches – mère, tante, grand-mère, amie, etc. – qui auraient entretenu un secret jusqu’à ce que la femme soit elle-même initiée.
La question du savoir et des modalités de sa transmission, quand il est possible de la rattacher à ses impacts sur le vécu d’une expérience à travers les paroles des personnes concernées, prend alors toute son épaisseur. Ainsi, si les femmes, et notamment celles de l’entourage, sont souvent perçues par les femmes enceintes comme les relais de la transmission d’une expérience de l’accouchement, celle-ci fait malgré tout défaut et une rupture s’exprime dans la diffusion de ce savoir : l’appel aux figures féminines que l’on entend dans la phrase citée ici se heurte à un silence ou à une minimisation qui ne permet pas de soutenir l’expérience subjective. Dans cet exemple, malgré de nombreuses questions de la part de la femme enceinte, la minimisation ne peut être dépassée qu’après l’accouchement. Le savoir d’expérience ne semble alors pas perçu socialement comme support possible de compréhension et de représentation de l’événement à venir, mais ne peut se dire que dans un partage réciproque d’expériences : paradoxalement, pour obtenir le savoir empirique, il faudrait avoir soi-même vécu au préalable l’expérience qu’il concerne, ce qui lui retire sa potentialité de mise en sens dans l’anticipation de l’accouchement. Ces modalités de transmission – ou de non-transmission – peuvent ainsi être reliées à ce que nous avons évoqué de l’histoire du savoir en obstétrique, de sa trajectoire et des déplacements qui la caractérisent, et pourraient même en être la manifestation : en incarnant le savoir légitime sur l’accouchement, l’obstétrique n’entre pas dans un champ de savoirs dans lequel chacun aurait une place équivalente, elle s’en fait le canal principal, ne permettant pas aux formes de savoir empirique et féminin de prendre une place suffisante dans la transmission. Avec la médicalisation, « de sujets sachants, les femmes se convertirent progressivement en objets de savoir »[45] : l’arrivée de la médecine sur la scène de l’accouchement, créant par sa constitution ces deux pôles et les rendant incompatibles, effacent la possibilité d’un savoir empirique subjectivant. De ce fait, le savoir d’expérience plus spécifiquement détenu par les femmes est perçu autant par les soignant.e.s que par les femmes elles-mêmes comme moins fiable, voire parfois comme source d’angoisse : si les récits d’accouchement ne se disent qu’à demi-mots, c’est notamment pour « ne pas traumatiser les autres », comme le formulait une autre femme en entretien.
Or, si cette rupture dans la transmission s’exprime de façon si insistante dans le discours des femmes, c’est également parce qu’elle n’est pas sans effets. L’analyse des entretiens de recherche met en lumière la façon dont ces modalités de transmission participent au sentiment d’impréparation exprimé par de nombreuses femmes. D’autant plus lorsqu’il s’agit d’un premier accouchement, une grande majorité exprime en effet la façon dont un savoir est venu à manquer, quelle que soit la nature de ce savoir : l’important, et c’est là une des fonctions du savoir, étant de pouvoir mettre du sens sur une expérience passée ou à venir. En exprimer le manque, c’est donc aussi exprimer la façon dont l’expérience vécue n’a pas pu être pensée, être mise en sens par le sujet, faute d’éléments signifiants à laquelle la raccrocher, parfois jusqu’à faire violence. Si un savoir sur l’accouchement existe, nous l’avons vu, la constitution de l’obstétrique comme science en fait un savoir d’expertise, dont les modalités de transmission sont celles de la verticalité, la relation de soin au sein de laquelle il se transmet étant par définition asymétrique : « d’un côté celui qui sait et sait faire, de l’autre celui qui souffre »[46]. L’appel à un savoir horizontal vient donc également marquer la façon dont ces modalités de transmission verticales peuvent amener un manque de représentations qui enraye la mise en sens de l’événement, qui reste alors comme suspendu. La rupture dans la transmission, ou a minima les changements historiques dans les modalités de circulation du savoir entre femmes, loin de rester des considérations épistémologiques, ont des effets jusque dans les corps et les psychismes.
Ainsi, les modalités de transmission du savoir en obstétrique et de sa trajectoire tendent à en faire un discours sur : sur les femmes, sur le corps féminin, sur une expérience vécue, au sens d’une distance qui se fait presque surplombante, mais dont les résultats excèdent de simples considérations théoriques. Dans la subjectivité du discours, d’une circulation du savoir sur l’expérience vécue peuvent se déceler tant dans sa dimension psychique, émotionnelle, que corporelle.
III – Le point aveugle de l’épistémologie médicale ?
« Il faut plutôt admettre […] que pouvoir et savoir s’impliquent directement l’un l’autre ; qu’il n’y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d’un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. »[47]. Le discours des femmes entendu en entretien permet de saisir certains des enjeux de l’articulation entre pouvoir et savoir amenée par Foucault, leur vécu d’accouchement illustrant bien souvent la façon dont le pouvoir s’inscrit dans les corps.
En effet, articuler un « discours sur » à la verbalisation d’une rupture dans la transmission, ainsi qu’aux vécus de passivation[48] ou de déshumanisation, c’est également pointer le fait que la coupure se situe, plus que dans le discours, dans le rapport au corps propre du sujet. Les modalités actuelles de détention, de transmission et de circulation du savoir entrainent ainsi un éloignement de son propre corps, qui devient objet étranger, dont la possibilité de compréhension n’appartient pas au sujet lui-même, mais ne peut venir que de l’extérieur. La question du pouvoir se retrouve alors mise en lumière, et serait à entendre au sens large : celui de la capacité à disposer, et à disposer, ici, de son propre corps. Si savoir implique pouvoir, l’articulation les liant ne peut être vue comme une causalité univoque, mais bien comme un enchevêtrement. La dimension historique, évoquée plus haut, le pointe nettement : la constitution du savoir obstétrical s’est accompagnée de la réorganisation des rapports hiérarchiques entre les différents acteurs obstétricaux. « Retournement des rapports de pouvoir, et constitution d’un savoir »[49], deux faces d’une même pièce.
Or, lorsque l’on se recentre sur l’obstétrique, ces enjeux prennent une dimension bien particulière, en ceci qu’ils concernent de façon très spécifique le corps des femmes, leurs organes génitaux, et la fonction de reproduction qui leur est rattachée. Ainsi, aux problématiques de morcellement du corps propres à la médecine moderne[50], et que l’on retrouve dans la théorie et la pratique de la plupart des spécialités médicales, se mêlent dans l’obstétrique celles de genre, à travers sa focalisation unique sur le corps féminin. Le savoir obstétrical vient ainsi donner forme et contour à cet objet qui est le sien, par le biais d’un vocabulaire scientifique, d’un ensemble de gestes, de pratiques, de protocoles qui n’ont rien d’anodin, en tant aussi que « nommer […] constitue un pouvoir sur le corps »[51]. En formant les contours de l’expérience de l’accouchement, de la grossesse, ou du corps féminin, en en nommant les mécanismes ou les dysfonctionnements, le discours obstétrical expert constitue les contours mêmes de ce corps dans une verticalité qui en conditionne la transmission, et dépossède du même coup le sujet de son corps. En faisant le « pari du corps »[52], l’obstétrique en oublie sa dimension incarnée, jusqu’à le penser comme dissocié du sujet. Par le pouvoir que cela induit sur les corps, par les modalités de transmission de ce savoir, par ce que cela implique pour le corps féminin qui « [n’échappe] pas au contrôle social, encore moins au pouvoir médical »[53], des effets de domination se rejouent dans l’obstétrique qui ont besoin, pour être pensés, d’être replacés dans le référentiel scientifique et social actuel, encore défini par « sa construction androcentriste »[54]. Les études de genre permettent de comprendre et repérer les représentations de genre qui traversent le savoir, sa production et sa mise en pratique. Ainsi, par ces outils de réflexion, pointer l’aspect de nomination du discours obstétrical ne peut qu’aller de pair avec une redéfinition du caractère situé de ce dernier, en tant que « cette nomination en dit davantage sur les conditions de sa production que sur l’objet qu’il prétend nommer »[55]. C’est par la capacité des études de genre à historiciser l’épistémologie obstétricale qu’il devient alors possible de penser les effets d’une telle production du discours.
 Cependant, la légitimité d’un savoir et son ancrage dans un référentiel scientifique commun et partagé a pour corollaire l’effacement de sa dimension historiquement et socialement située. Plus qu’une expertise dans son domaine d’application, ce savoir est perçu comme point d’ancrage incontournable ayant une existence indépendante, antérieure à celle de son objet. Les conditions de sa constitution sont ainsi effacées, ramenées à une pure contingence, voire même retournées : plutôt qu’un savoir construit dont les contours ont tenté d’épouser une forme de l’objet visé, ce serait l’objet qui serait venu se loger dans une forme préexistante et l’englobant tout entier.
Cependant, la légitimité d’un savoir et son ancrage dans un référentiel scientifique commun et partagé a pour corollaire l’effacement de sa dimension historiquement et socialement située. Plus qu’une expertise dans son domaine d’application, ce savoir est perçu comme point d’ancrage incontournable ayant une existence indépendante, antérieure à celle de son objet. Les conditions de sa constitution sont ainsi effacées, ramenées à une pure contingence, voire même retournées : plutôt qu’un savoir construit dont les contours ont tenté d’épouser une forme de l’objet visé, ce serait l’objet qui serait venu se loger dans une forme préexistante et l’englobant tout entier.
Ce faisant, ce que l’épistémologie rejoue de représentations et de normes de genre, de dynamiques de pouvoir-savoir ou d’effets de domination, est invisibilisé. Ce que nous avons nommé, sous la forme interrogative, « point aveugle », n’est donc pas un point aveugle des médecins, mais bien de l’épistémologie médicale, en tant que celle-ci infiltre les pratiques, les institutions et leurs formes, et façonne les représentations tant du côté des soignant.e.s, que, par jeux de reflet, du côté des soigné.e.s. L’invisibilisation de ces problématiques devient alors la trace des dynamiques de pouvoir qui traversent l’épistémologie, bien plus qu’elles n’en découlent. Interroger l’épistémologie obstétricale par ce biais, c’est donc pointer la façon dont elle rejoue, en théorie comme en pratique, des problématiques politiques, et notamment de genre, pourtant masquées par cette même épistémologie, son contexte de constitution, et celui de sa mise en application.
En gardant à l’esprit ce qui a été développé plus haut concernant les effets de tels mécanismes jusque dans l’existence même de chaque sujet, le discours obstétrical, lorsqu’il est étudié sous le prisme de ce qu’il construit du corps, à travers ses modalités, ses effets, et ses points aveugles, révèle ainsi ses dimensions performatives, celles qui marquent les corps au-delà même de la pratique médicale elle-même – car ce n’est pas que dans le geste médical que se jouent les effets corporels. Le corps féminin voit ainsi se former ses contours, en plein comme en creux : ce qui est de l’ordre de l’impensé dans le savoir même est souvent impensable pour le sujet, mais n’est pas pour autant absent de la constitution des représentations de son corps. Ainsi, pour reprendre les paroles de femmes évoquées plus haut, ce manque exprimé autour d’un savoir de l’accouchement ne serait pas pure absence, mais voie de retour d’un élément rendu presque trop présent par son invisibilisation.
Conclusion
L’obstétrique est une spécialité spécifique, dont la constitution, le savoir, la pratique et les effets ne peuvent être entièrement rabattus sur une médecine prise comme ensemble indistinct. Par son objet qui le sort d’une médecine centrée sur le pathologique et qui touche au corps féminin et ses organes génitaux, par ce que l’histoire nous apprend des conditions de sa constitution (conditions masculine, scientifique, et hospitalière), l’obstétrique doit être associée au contexte scientifique et social de sa pratique pour que puisse être mise au jour la totalité des enjeux qui la traversent, mais aussi qu’elle induit. En effet, si le savoir obstétrical contribue à constituer les représentations individuelles et collectives du corps féminin, jusqu’à infiltrer l’expérience individuelle de ce dernier, la place depuis laquelle il le fait, caractérisée par une verticalité de la transmission du savoir, masque une grande partie des problématiques sociales avec lesquelles il entretient pourtant un rapport étroit. En effet, si ce savoir se constitue en étant traversé par les normes de genre des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, menant à une certaine représentation de la femme qui affecte sa théorie et ses pratiques, le savoir obstétrical est aujourd’hui producteur de représentations sur le corps des femmes et sur ses mécanismes dans un référentiel scientifique qui met de côté les enjeux sociaux.Si les effets de cette production, qui est également production de normes, ne sont pas pensées par la science qui en est à l’origine, ils sont pourtant bien visibles dans la parole et dans le corps des parturientes.
Ainsi, cause et conséquence des représentations de genre qui traversent le savoir et les pratiques sans pouvoir ni se dire ni se penser – ce qui, par ailleurs, contribue à en renforcer les effets -, la science obstétricale se présente pourtant comme étant « d’apparence naturelle »[56], entretenant l’illusion d’une vérité apolitique et que l’on pourrait extraire de son contexte historique et social. Le genre, alors perçu comme outil de pensée, donnerait alors la possibilité d’une mise en pensée historicisante et resocialisante, ayant là aussi des répercussions sur la clinique en obstétrique, en ouvrant l’écoute et le regard des praticien.nes.
Questionner ces représentations, mais également leur ancrage dans une épistémologie qui les dépasse, permet alors de sortir cette dernière de l’illusion du caractère apolitique, objectif et universel que sa légitimité et sa dimension d’expertise lui confèrent, et de la redéfinir par ses conditions de production. Par ailleurs, une telle réflexion rend possible l’écoute des éléments invisibilisés lorsqu’ils font retour. Ainsi, à titre d’exemple, le sujet de la violence obstétricale[57], à l’origine de nombreuses polémiques ces dernières années, pourrait être lu par ce prisme. Pris par certain.e.s soignant.e.s comme une attaque directe et violente à leur éthique professionnelle et personnelle, il pourrait également être reçu comme une forme de retour de ce qui, dans la science obstétricale même, vient à manquer : un savoir incarné sur le corps propre, qui, quand il en est destitué, ne peut élaborer des gestes et des pratiques qui peuvent alors, sur un tel terrain, déployer leur potentialité effractante.
[1] David LE BRETON, Anthropologie du corps et modernité, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, p. 17.
[2] Francesco PANESE, Vincent BARRAS, « Médicalisation de la vie et reconfigurations médicales », Revue de sciences sociales, no 39, 2008, p. 16-25.
[3] Mathieu AZCUE, Julien TARDIF, « L’engendrement vu du don. Ce qu’accoucher dans un monde biomédicalisé veut dire », Revue du Mauss, no 39, 2012/1, p. 163-179.
[4] Laure BERENI, Sébastien CHAUVIN, Alexandre JAUNAIT et Anne REVILLARD, Introduction aux Gender Studies. Manuel des études sur le genre, Bruxelles, De Boeck, 2008, p. 10.
[5] Bernard-Marie DUPONT, « Epistémologie du raisonnement médical contemporain », in Emmanuel Hirsch (dir.), Traité de Bioéthique, Paris, Eres, 2010, p. 625
[6] Ces éléments sont tirés de la préface de Michel FOUCAULT, Naissance de la clinique, Paris, PUF, 1963, p. V-XV. Ils sont accompagnés d’une réflexion concernant la façon dont la production d’un savoir fondé d’abord sur la clinique implique des enjeux spécifiques, que nous ne détaillerons pas ici.
[7] Ibid, p. X.
[8] Michel FOUCAULT, Dits et écrits, tome II, Paris, Gallimard, 1994, p. 299.
[9] Gilles Renard, L’épistémologie chez Georges Canguilhem, Paris, Nathan, 1996, p. 9.
[10] Jean-Michel BERTHELOT (dir.), « Avant-propos », Epistémologie des sciences sociales, Paris, PUF, 2012, p. 34.
[11] Voir Yvonne KNIBIEHLER, Catherine FOUQUET, La femme et les médecins : analyse historique, Paris, Hachette, 1983.
[12] Ibid.
[13] Jacques GELIS, La sage-femme ou le médecin : une nouvelle conception de la vie, Paris, Fayard, 1988, p. 18.
[14] La matrone se distingue de la sage-femme tout en en étant, en quelque sorte, l’ancêtre : « les sages-femmes ont un diplôme reconnu par l’Etat […], est formée par le médecin et non par ses pairs. » (Azcue, Tardif, op. cit.).
[15] Yvonne KNIBIEHLER, Catherine FOUQUET, op. cit., p. 177.
[16] Sophie GUILLAUME, « De l’intimité imposée à l’intimité maîtrisée », in Muriel FLIS-TREVES, René FRYDMAN (dir.), Intimités en danger, Paris, PUF, 2019, p. 13.
[17] Jacques GELIS, op. cit., p. 346.
[18] Stéphanie CHAPUIS-DESPRES, « Le genre en gynécologie et obstétrique. Médecins et sages-femmes dans le Saint-Empire Romain Germanique », Transtext(e)s Transcultures : Journal of Global Cultural Studies, 11, 2016.
[19] Ibid.
[20] Jacques GELIS, op. cit., p. 319.
[21] Yvonne KNIBIEHLER, Histoire des mères et de la maternité en Occident, Paris, PUF, 2002, p. 49.
[22] Ibid, p. 47.
[23] Voir Jacques GELIS, op. cit, p. 319
[24] Mathieu AZCUE, Julien TARDIF, op. cit.
[25] Yvonne KNIBIEHLER, Catherine FOUQUET, op. cit., p. 178.
[26] Yvonne KNIBIEHLER, Catherine FOUQUET, op. cit., p. 196.
[27] Jacques GELIS, op. cit., p. 306.
[28] Stéphanie CHAPUIS-DESPRES, op. cit.
[29] Ibid.
[30] Mathieu AZCUE, Julien TARDIF, op. cit.
[31] Jacques GELIS, « L’évolution des savoirs en obstétrique et en pédiatrie aux siècles classiques », in Marie-France MOREL (dir.), Accueillir le nouveau-né, d’hier à aujourd’hui, Paris, Eres, 2013, p. 66.
[32] Paul CESBRON, Yvonne KNIBIEHLER, La naissance en Occident, Paris, Albin Michel, 2004, p. 119.
[33] Jacques GELIS, 1988, op. cit., p. 329.
[34] Ibid.
[35] Michel FOUCAULT, Naissance de la clinique, Paris, PUF, 1963, p. X.
[36] David LE BRETON, op. cit., p. 102.
[37] Jacques GELIS, 1988, op. cit., p. 98.
[38] Paul CESBRON, Yvonne KNIBIEHLER, op. cit., p. 116.
[39] Michel FOUCAULT, 1994, op. cit.
[40] Pierre LASCOUMES, « Foucault et les sciences humaines, un rapport de biais : l’exemple de la sociologie du droit », Criminologie, vol. 26, no 1, 1993, p. 35-50.
[41] Mathieu AZCUE, Julien TARDIF, op. cit.
[42] Ibid.
[43] Elsa DORLIN, « Genre, santé, nation à l’âge classique », in Virginie VINEL (dir.), Féminin, masculin : anthropologie des catégories et des pratiques médicales, Strasbourg, Edition Le Portique, 2007, p. 32.
[44] Dans le cadre d’une recherche en psychopathologie et psychanalyse portant sur l’expérience de la violence dans l’accouchement, des entretiens de recherche ont été menés avec treize femmes ayant accouché un mois plus tôt. Ce sont les paroles d’une de ces femmes qui sont ici rapportées. Au cours de cette étude, je me suis rendue entre septembre et octobre 2019 dans trois maternités différentes, toutes situées en zone urbaine. Dans chaque service, un questionnaire a été distribué chaque jour sur une période de deux semaines à chacune des femmes présentes. L’étude ne comportait pas de critères d’inclusion spécifiques, hormis le fait que les femmes devaient être âgées de plus de 18 ans, afin de prendre en compte tous les types d’accouchements. Le questionnaire était accompagné d’une note d’information, ainsi que d’un recueil oral et écrit du consentement des femmes après explication de la recherche. Il était composé de sept questions courtes qui visaient à recueillir des informations sur la femme et sur son accouchement (âge, statut marital, mode d’accouchement, etc.). La dernière question concernait plus spécifiquement le vécu de l’accouchement : il a été demandé aux femmes de décrire leur expérience d’accouchement par un nombre limité de mots qui, selon elles, circonscrivaient au mieux leur vécu. Au total, 268 questionnaires ont été récoltés, leur but initial étant de mener par la suite des entretiens de recherche avec les femmes interrogées, portant sur leur accouchement. Lors de la distribution des questionnaires, il a donc été proposé aux femmes de transmettre leurs coordonnées afin que je puisse, en fonction des résultats du questionnaire, les recontacter pour un entretien en post-partum. Si les femmes ne souhaitaient pas transmettre leurs coordonnées, le questionnaire était alors anonyme. Au dépouillement des questionnaires, ont été recontactées les femmes dont les réponses témoignaient d’un vécu difficile de leur accouchement par le biais des mots employés pour décrire leur expérience. Treize entretiens de recherche non-directifs ont été menés un mois après l’accouchement, dans le but de recueillir un récit détaillé de la période périnatale, en se focalisant sur le déroulé de l’accouchement et son vécu. Ces entretiens ont été enregistrés, retranscrits, puis analysés au moyen d’une analyse thématique.
[45] Katharine PARK, Secrets de femmes : le genre, la génération et les origines de la dissection humaine, Paris, Broché, 2009, p. 71.
[46] Paul RICOEUR, Le juste 2, Paris, Esprit, 2001, p. 229.
[47] Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 36.
[48] Ce terme désigne l’expérience, très souvent exprimée par les femmes en entretien, de s’être sentie en position passive lors de l’accouchement.
[49] Ibid., p. 187.
[50] David LE BRETON, op. cit., p. 138.
[51] Laurie LAUFER, « Une vie nue : ou le biopouvoir des mots », in Danièle BRUN (dir.), Le statut de la femme dans la médecine : entre corps et psyché, Paris, Editions Etudes Freudiennes, 2010, p. 408.
[52] David LE BRETON, op. cit., p. 14.
[53] Yvonne KNIBIEHLER, op. cit., p. 99.
[54] Cécile STRATANOVITCH, « Genre et médecine », Chimères, no 39, 2009/1, p. 135-147.
[55] Laurie LAUFER, op. cit., p. 408.
[56] Cécile STRATANOVITCH, op. cit.
[57] Claire MICHEL, Claire SQUIRES, « Entre vécu de l’accouchement et réalité médicale : les violences obstétricales », Le Carnet Psy, 2018/8, no 220, p. 22-33.