Recension – Révolution pour la vie. Philosophie des nouvelles contestations.
Nestor Engone Elloué est docteur en philosophie et chercheur postdoctorant rattaché au Laboratoire CRISES de l’Université Paul Valéry. Son adresse mail : nestor-rodrigue.engone-elloue@univ-montp3.fr
Eva Von Redecker, Révolution pour la vie. Philosophie des nouvelles contestations, traduction Olivier Mannoni, Paris, Essais Payot, Editions Payot, 2021.
L’ouvrage est disponible ici.
Introduction
Le livre d’Eva Von Redecker, philosophe et journaliste allemande, envisage de renouveler et d’actualiser la critique du capitalisme en recentrant la réflexion sur sa dimension violente et mortifère : « le capitalisme détruit la vie » (p. 7). Cette réflexion qui s’ancre dans la critique marxiste du capitalisme éclaire ce par quoi le capitalisme détruit : un mode de relation aux choses fondé sur la « maîtrise absolue » et la recherche effrénée du profit. Pour l’auteure, la lutte contre le capitalisme et ses conséquences néfastes (sociales, climatiques, environnementales) doit consister à défaire ce mode de relation partout où il conduit à détruire les vies, comme s’y emploient plusieurs mouvements de contestation contemporains : Extinction Rebellion, Black Lives Matter, #MeToo, Ende Gelände, Fridays for Future, Ni Una Menos, etc.
Le livre est composé de neuf chapitres qui articulent la réflexion de l’auteure en deux grands mouvements. Le premier englobe les quatre premiers chapitres. Dans cette partie, l’auteure décrit les fondements, les modalités et les conséquences de la domination capitaliste de la vie : la maîtrise totale, l’exploitation des corps et l’exploitation de la terre, l’épuisement pour le profit et la destruction du monde. La deuxième partie de sa réflexion englobe les cinq chapitres suivants. L’auteure y décrit comment parvenir à renverser la domination capitaliste à partir des quatre objectifs que doivent viser une révolution pour la vie, féministe, long-termiste et solidaire : sauver, régénérer, partager et prendre soin.
La domination capitaliste : maîtriser, exploiter, épuiser, détruire
La réflexion s’ouvre sur la description de la domination capitaliste. Le premier chapitre montre que le système capitaliste repose sur une logique de « maîtrise absolue de la chose » qui tire son origine dans une conception moderne de la propriété. Dans la lignée de Karl Marx et des travaux d’auteurs comme Peter Garnsey (2013) ou Brenna Bhandhar (2018), Eva Von Redecker explique que le passage de l’économie féodale à l’économie capitaliste débouche sur l’approbation d’un ordre moderne d’appropriation despotique : « la propriété moderne donne au détenteur le droit de contrôler l’objet et d’en faire usage, mais aussi celui d’en abuser et de le détruire » (p. 20). Cette conception moderne de la propriété qui conduit à la chosification et la possession violente ne s’est pas limitée à la maîtrise de la terre que l’on privatise. Il y a une « maîtrise de la chose », comme il y a une « maîtrise raciste de la chose » (p. 32), ou une maîtrise patriarcale de la chose. Or, en imposant un ordre de maîtrise et de chosification, l’ordre moderne de la propriété qui structure le capitalisme introduit un mode de dévoilement du réel – pour reprendre une expression heideggerienne – qui empêche de voir les êtres autrement que comme des biens que l’on peut posséder et exploiter.
Dans le second chapitre, l’auteure soutient que l’ordre moderne de la propriété fait également du capitalisme un système orienté vers la recherche du profit. Elle assimile le capitalisme à un « gigantesque entonnoir » qui aspire « tout ce dont il espère retenir la vie ultérieure sous forme de profit » (p. 55). Le capitalisme opère ainsi un changement épistémique majeur en faisant de la valeur-profit une valeur supérieure à toutes les autres. L’économie du marché permet au capitalisme de créer une séparation effective entre ce qui a de la valeur et ce qui n’en a pas. S’opère ici ce que Karl Marx nommait le fétichisme de la marchandise par lequel, dans le système capitaliste, la valeur des choses échappe aux individus. Elle échappe à l’acheteur autant qu’au producteur. Elle devient soumise à la loi du marché et à la « maîtrise objective » ou la « tyrannie du profit » (p. 58) qui transforme toute chose en marchandise dont on peut espérer tirer profit, y compris les « os de chevaux et d’hommes » vendus comme farines dans les années 1800 pour l’agriculture (p. 46). Cette allusion historique que l’auteure reprend chez Marx est pertinente pour montrer que les limites morales du marché ne portent pas seulement sur des cas contemporains. Il est intéressant de croiser cette analyse avec la réflexion menée par Michael Sandel (2014) sur les dangers de la logique mercantile du capitalisme. Pour Eva Von Redecker, cette logique mercantile instaure une boucle sans fin liée au fait que le profit tiré de l’exploitation incite à « exploiter totalement le pouvoir d’exploiter » (p. 52), au détriment des conséquences néfastes qui peuvent en découler : « la tempête de l’exploitation ne se soucie ni des dégâts ni des dommages : la seule chose qui la préoccupe, c’est le différentiel de pression entre l’investissement et le rendement » (p. 59). L’exploitation pour le profit s’inscrit dans une perspective de mise-à-mort lente qui se traduit par un épuisement généralisé.
Dans le troisième chapitre du livre, l’auteure montre que l’exploitation de la marchandise dans la logique de maximisation du profit a pour conséquence d’épuiser le travailleur et l’environnement. Selon elle, les travailleurs sont aliénés par le système capitaliste à travers l’illusion qu’ils ont de posséder entièrement leur corps. Cette illusion de « possession complète de soi » (p. 90) peut conduire le sujet à penser qu’il décide librement de se « tuer à la tâche », comme on déciderait librement d’user de son corps comme on l’entend. Cette « possession fantôme » ou possession illusoire de soi, conduit à lutter contre la fatigue, le stress ou le burn out par tous les moyens, en pensant lutter ainsi par sa volonté et pour-soi. L’illusion de propriété de soi empêche le sujet de voir la réalité de la nature et du travail qu’il exécute. Il s’agit d’un travail qui épuise en exploitant la main d’œuvre de la même manière que les ressources naturelles sous l’ordre de la maîtrise absolue et objective de la chose. Le capitalisme exploite à l’usure le travailleur et l’environnement : « Tant de mains. Enchaînées, derrière des barreaux, à la chaîne, au clavier, à l’évier, dans le sol. Et tellement plus que des mains. L’eau, le feu, l’air et la terre » (p. 88). Cet épuisement de la vie est à l’origine de sa détérioration, de sa destruction. La crise d’extinction des espèces, la crise climatique et l’ensemble des crises socio-environnementales contemporaines résultent de cet épuisement généralisé.
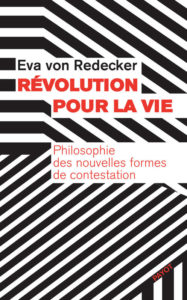 Le quatrième chapitre tire la principale conséquence des trois caractéristiques de la domination capitaliste que sont la maîtrise, l’exploitation et l’épuisement : « le capitalisme dilapide la vie » (p. 96). Pour l’auteure, les mobilisations pour le climat apportent un éclairage sur la nature mortifère de ce système en structurant leurs protestations autour des die-in (p. 97), à savoir des actions visant à simuler la mort. Le mouvement Extinction Rebellion est l’exemple d’un mouvement de protestation qui articule ses actions de conscientisation autour de la représentation de la mort : « ils miment la maîtrise de la chose : leur mort imitée est une manière d’approcher les objets de la dévastation écologique » (p. 102). Eva Von Redecker soutient que cette dévastation écologique doit être perçue comme un processus de « perte du monde » enclenché depuis des siècles. Appréhender la crise écologique globale actuelle dans cette perspective suppose de mieux décrire le processus long par lequel la destruction du monde s’opère. Pour cela, elle considère qu’il ne faut pas simplement « transposer la vérité scientifique du changement climatique en buts techniques ambitieux » (p. 107). Elle estime qu’il faut recourir à de nouveaux récits permettant d’éveiller la conscience existentielle de la catastrophe et d’éprouver la communauté de destin. Elle propose à cet effet de recourir à une forme de « narration douce » (p. 131) en s’inspirant de la proposition formulée par Olga Tokarczuk (2020) : un récit à la « quatrième personne » permettant une prise en compte de la diversité des voix, pour « tout voir » du monde. Il serait intéressant de voir en quoi une telle proposition pourrait être une alternative au récit à la première personne du pluriel que l’on retrouve dans le récit de l’anthropocène que certains remettent en question pour sa dimension totalisante. C’est par exemple le cas de Jason Moore (2016) qui préfère le récit du capitalocène ou de Malcom Ferdinand (2019) qui préfère le récit du plantationocène.
Le quatrième chapitre tire la principale conséquence des trois caractéristiques de la domination capitaliste que sont la maîtrise, l’exploitation et l’épuisement : « le capitalisme dilapide la vie » (p. 96). Pour l’auteure, les mobilisations pour le climat apportent un éclairage sur la nature mortifère de ce système en structurant leurs protestations autour des die-in (p. 97), à savoir des actions visant à simuler la mort. Le mouvement Extinction Rebellion est l’exemple d’un mouvement de protestation qui articule ses actions de conscientisation autour de la représentation de la mort : « ils miment la maîtrise de la chose : leur mort imitée est une manière d’approcher les objets de la dévastation écologique » (p. 102). Eva Von Redecker soutient que cette dévastation écologique doit être perçue comme un processus de « perte du monde » enclenché depuis des siècles. Appréhender la crise écologique globale actuelle dans cette perspective suppose de mieux décrire le processus long par lequel la destruction du monde s’opère. Pour cela, elle considère qu’il ne faut pas simplement « transposer la vérité scientifique du changement climatique en buts techniques ambitieux » (p. 107). Elle estime qu’il faut recourir à de nouveaux récits permettant d’éveiller la conscience existentielle de la catastrophe et d’éprouver la communauté de destin. Elle propose à cet effet de recourir à une forme de « narration douce » (p. 131) en s’inspirant de la proposition formulée par Olga Tokarczuk (2020) : un récit à la « quatrième personne » permettant une prise en compte de la diversité des voix, pour « tout voir » du monde. Il serait intéressant de voir en quoi une telle proposition pourrait être une alternative au récit à la première personne du pluriel que l’on retrouve dans le récit de l’anthropocène que certains remettent en question pour sa dimension totalisante. C’est par exemple le cas de Jason Moore (2016) qui préfère le récit du capitalocène ou de Malcom Ferdinand (2019) qui préfère le récit du plantationocène.
Pour une révolution long-termiste, féministe sociale et écologique : sauver, re-générer, partager, soigner
La deuxième partie de la réflexion de l’auteure s’articule autour d’une proposition de renversement du capitalisme par le biais d’une « révolution » qu’elle conçoit comme un engagement sur le long-terme. Selon elle, la révolution anticapitaliste « ne doit pas être obligatoirement comme un grand renversement (…), c’est une refonte lente mais omniprésente du quotidien. » (p. 153). Cela suppose de vouer la vie à la révolution en acceptant « la mission, plus complexe, consistant à transformer nos modèles de vies quotidiens » (p. 154). Le renversement du capitalisme est ici envisagé comme un long processus de rupture avec pour objectif de réorienter « totalement nos activités fondamentales dans le prolongement des combats menés par les mouvements sociaux existants » (p. 155). Le mérite de cette idée de réorientation qui concernerait le sens que l’on doit donner au travail, aux échanges, à la propriété et aux relations, est d’attribuer une importance au changement des mentalités et à la responsabilité individuelle.
Dans le sixième chapitre, l’auteure relève que la « révolution pour la vie » implique de lutter pour la « vie digne » en renversant le règne de la possession partout où la « maîtrise de la chose opprime » et ou la « maîtrise objective exclut » (165). En relevant les actions des mouvements tels que Black Lives Matter ou Critical Resistance, elle montre qu’il faut organiser le sauvetage de la vie en luttant contre « les plus grandes violences systémiques modernes – le racisme, l’exploitation capitaliste, et les normes de parenté bourgeoises et patriarcales » (p. 171). Dans cette perspective, la « révolution pour la vie » permet de repenser l’altérité pour fonder une « attention salvatrice que l’on porte aux autres » (p. 200), notamment à celles et ceux dont l’oppression persistante de possession des uns, rend la respiration des autres impossible. De ce point de vue, le cri de détresse i can’t breathe de George Floyd doit aussi bien mobiliser contre les violences policières que contre la « concentration de richesse capitaliste » qui se fait au détriment de la paix sociale, de l’habitabilité et la respirabilité du monde.
Le septième chapitre poursuit la description de ce vers quoi doit tendre une « révolution pour la vie » : une alternative féministe à la logique capitaliste du travail en vue de passer d’un travail « qui tue » à un travail « qui prend soin » et qui n’est pas centré sur la recherche permanente du profit (p. 219). Ce travail doit garantir « d’être vivants et libres » (p. 221) au lieu d’exploiter jusqu’à l’épuisement. Il ne s’agit pas d’un travail pour soi, pour la survie, ou uniquement pour l’intérêt d’un groupe, mais d’un travail pour tous qui instaure une relation solidaire entre les êtres. Cette conception du travail ne réduit pas le travail à la production de marchandises dont on souhaite tirer profit. Elle vise au contraire à faire du travail une expérience de la création, de la mise en commun, du soin, du don de soi et de la médiation entre les besoins. Cette approche du travail comme source d’épanouissement individuel et collectif revêt une dimension utopique qui semble en faire un idéal qu’une planification économique et politique devrait viser.
Dans le huitième chapitre Eva Von Redecker esquisse la dimension politique de la « révolution pour la vie » en plaidant en faveur d’un « socialisme écologique » qui transformerait le travail et les modes de production de manière à concilier les « conditions d’un travail humain » et les « conditions de la régénération naturelles » (p. 273). Pour l’auteure, cette volonté de conciliation du souci humain et du souci écologique rejoint les revendications des mouvements activistes pour la justice climatique qui s’opposent à la logique capitaliste du marché et remettent en cause ses modes de production (p. 247). Comme elle le relève, les actions de blocage et d’occupation des infrastructures charbonnières n’incitent pas seulement à œuvrer pour la réduction du réchauffement climatique. Au contraire, elles invitent également à construire de « nouvelles communautés solidaires » (p. 254) et à fonder une nouvelle manière de partager le monde autrement que par l’appropriation et l’accaparation des ressources naturelles par quelques-uns. Pour y parvenir, le « socialisme écologique » qu’elle propose vise à remplacer le modèle de propriété capitaliste qui ne planifie que « la maximisation des profits » (p. 274) par un modèle de « propriété sociale » (p. 246) qui vise une meilleure répartition des biens et une planification de leur régénération naturelle. Il est étonnant que Murray Bookchin (2003) ne soit pas cité par l’auteure alors qu’il est un des précurseurs de la théorie de l’écologie sociale. La proposition de réinvestir le champ politique qu’il formule – le municipalisme libertaire – est une tentative de réponse concrète à la question de savoir comment instaurer un nouveau régime d’écologie sociale. Cette question n’est pas véritablement abordée par Eva Von Redecker dans ce livre.
Enfin, le neuvième et dernier chapitre du livre prolonge la réflexion sur l’idée de propriété. En s’inspirant de la critique décoloniale formulée par certains mouvements des peuples indigènes à l’instar de Ni Una Menos, l’auteure soutient qu’il faut remettre en cause la prétention coloniale à la propriété sur la terre. Elle relève que les luttes indigènes mettent en avant une « autre qualité de la relation à la terre » (p. 283) qui n’est ni fondée sur « la maîtrise de la chose », ni fondée sur l’appropriation privée. Cette relation non coloniale à la terre vers laquelle il faut tendre est principalement une relation de responsabilité consistant à préserver le monde et à mettre le monde en commun. Cette mise en commun signifie que « tout peut s’organiser en dehors du servage. Et cela signifie aussi : tout est à confier à tous. Tous sont confiés les uns aux autres » (p. 295). La « révolution pour la vie » vise donc à fonder une nouvelle manière d’habiter le monde en commun, une manière responsable et solidaire d’être-au-monde.
Conclusion
L’ouvrage d’Eva Von Redecker est une critique qui ouvre des pistes intéressantes pour actualiser l’analyse des nuisances du capitalisme et pour agir sur la matrice qui les anime. Tout comme Naomi Klein (2015), l’auteure offre ici une grille de compréhension supplémentaire des racines de la violence du système capitaliste et des formes contemporaines de résistances citoyennes et militantes.
Au terme de la lecture, quelques interrogations subsistent. Si les nouvelles formes de contestation pour la préservation de la vie s’inscrivent dans la lutte contre les violences du capitalisme, sont-elles en mesure de constituer un réel contre-pouvoir global capable de renverser le système mondialisé qu’est le capitalisme ? De plus, la non-radicalité qui caractérise ces mobilisations et l’orientation long-termiste donnée à la « révolution pour la vie » ne permettent-elles pas au capitalisme d’avoir le temps de s’adapter aux crises ? Autrement dit, une « révolution pour la vie » qui ne s’inscrit pas à court-terme et au niveau global dans une perspective de rupture radicale peut-elle empêcher la survie du capitalisme ?
Bibliographie
Peter Garnsey, Penser la propriété, de l’Antiquité jusqu’à l’ère des révolutions, Paris, Les Belles Lettres, 2013.
Brenna Bhandhar, Colonial Lives of Property. Law, Land, and Racial Regimes of Ownership, Duke University Press, 2018.
Naomi Klein, Tout peut changer, capitalisme et changement climatique, Arles, Actes Sud, 2015.
Murray Bookchin, Pour un municipalisme libertaire, Lyon, Atelier de création littéraire, 2003.
Olga Tokarczuk, Le tendre Narrateur. Discours du Nobel et autres textes, traduit par Maryla Laurent, Paris, Les Editions Noir sur Blanc, 2020.
Michael J. Sandel, Ce que l’argent ne saurait acheter. Les limites morales du marché, Paris, Seuil, 2014.
Jason Moore, Anthropocene or Capitalocene ? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Oakland, PM Press, 2016.
Ferdinand, Malcom, Une écologie décoloniale : penser l’écologie depuis le monde caribéen, Éditions du Seuil, 2019.














