Recension – L’univers infini, Jean Seidengart
Recension: Jean Seidengart, L’univers infini dans le monde des lumières, Paris, Les belles lettres, 2020.
Corentin Fève, enseignant au lycée d’Aoste Cet article est une recension de l’ouvrage de Jean Seidengart, L’univers infini dans le monde des lumières, publié aux éditions Belles Lettres en 2020. Vous pouvez trouver l’ouvrage sur le site de son éditeur en cliquant ici.
Après avoir étudié, dans son ouvrage Dieu, l’Univers et la Sphère infinie (2006), l’apparition de l’infinité en acte de l’Univers dans les grands systèmes classiques découlant de la révolution copernicienne, Jean Seidengart s’intéresse cette fois à la place de l’infinité cosmologique et aux interactions entre les différents types d’infinis, à la suite de l’édification de la physique newtonienne.
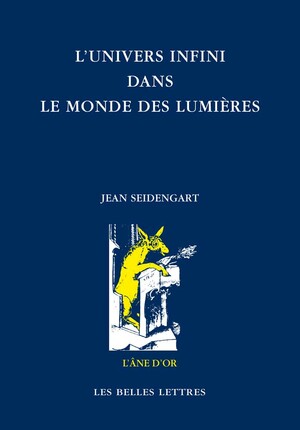 On serait tout d’abord tenté de lire l’ouvrage de Jean Seidengart, L’univers infini dans le monde des Lumières, essentiellement comme une critique, certes mesurée, du travail d’Alexandre Koyré. L’auteur semble reprocher à Koyré un certain simplisme : la remise en cause d’un monde clos n’impliquerait pas nécessairement l’admission une fois pour toute d’un univers infini. Il s’agit ainsi de montrer que « l’infinitisme cosmologique, si ardemment défendu par les philosophes et scientifiques du XVIIe siècle, entre en crise et amorce un retrait non négligeable, peu avant le milieu du siècle suivant » (p.487). Les critiques issues aussi bien de l’empirisme, pointant les limites intrinsèques de notre connaissance, que des théologiens, pour qui l’infinité de l’Univers remettrait en cause la création divine, ou des scientifiques, l’infini échappant à la mesure, viendraient ainsi très fortement fragiliser la défense d’un Univers infini.
On serait tout d’abord tenté de lire l’ouvrage de Jean Seidengart, L’univers infini dans le monde des Lumières, essentiellement comme une critique, certes mesurée, du travail d’Alexandre Koyré. L’auteur semble reprocher à Koyré un certain simplisme : la remise en cause d’un monde clos n’impliquerait pas nécessairement l’admission une fois pour toute d’un univers infini. Il s’agit ainsi de montrer que « l’infinitisme cosmologique, si ardemment défendu par les philosophes et scientifiques du XVIIe siècle, entre en crise et amorce un retrait non négligeable, peu avant le milieu du siècle suivant » (p.487). Les critiques issues aussi bien de l’empirisme, pointant les limites intrinsèques de notre connaissance, que des théologiens, pour qui l’infinité de l’Univers remettrait en cause la création divine, ou des scientifiques, l’infini échappant à la mesure, viendraient ainsi très fortement fragiliser la défense d’un Univers infini.
Il nous semble également que l’auteur parvient à mettre en évidence le rôle fondamental qu’ont pu jouer les problèmes issus d’une cosmologie infinitiste dans l’émergence du criticisme. Seidengart nous offre ainsi un regard plus profond sur la naissance du criticisme chez Kant et sur les problèmes que celui-ci a tenté de dépasser. Ce second point peut d’ailleurs également être considéré comme une critique envers Koyré qui n’a « ménagé aucune place à la philosophie de Kant, dans ses œuvres publiées » (p.486), alors même que celui-ci joue un rôle central dans la cosmologie XVIIIe siècle. La position de Kant est en effet riche d’enseignements, « car elle se situe à la croisée de tous ces divers courants scientifiques, philosophiques et religieux. Kant est un héritier brillant de la tradition métaphysique leibnizienne, mais il est également un grand défenseur de la science newtonienne » (p. 489).
Il s’agit tout d’abord, pour Seidengart, de restituer les principales caractéristiques de la cosmologie infinitiste de Newton ainsi que celles de ses principaux héritiers. L’auteur montre ensuite à quel point celle-ci a été mise à mal au cours du XVIIIe siècle par les empiristes britanniques qui assumaient pourtant l’héritage newtonien, mais également par les rationalistes allemands davantage issus de la tradition leibnizienne. En effet, aussi bien pour les empiristes, pour qui les bornes de notre entendement nous limitent à la connaissance d’objets finis, que pour les rationalistes allemands, défendant la création divine de l’Univers, l’infinité de l’Univers, et particulièrement son infinité en acte, n’est rien moins qu’évidente. Et c’est à partir de ces différentes influences que la cosmologie kantienne va pouvoir émerger et déboucher finalement sur le criticisme, établissant l’impossibilité de connaître l’Univers en soi et donc comme fini ou infini en acte. Kant ne va pas pour autant cesser de s’intéresser à la cosmologie, quitte parfois à frôler voire à dépasser les limites que la Critique de la raison pure avait pourtant posées. Enfin, Seidengart termine son ouvrage en examinant les cosmologies scientifiques de Laplace et d’Olbers, ce qui lui permet d’insister sur l’influence de Buffon et de Kant sur la cosmologie du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle et d’apporter, une fois pour toutes, une très forte nuance à la vision qu’Alexandre Koyré en avait proposée.
Cosmologies newtoniennes
Si le monde sensible, pour Newton, est bien fini, l’espace est lui infini en acte et le temps illimité a parte ante et a parte post. Et c’est en tant qu’ils sont des émanations de Dieu que l’espace et le temps sont infinis. En outre, « Newton s’élève du Monde à Dieu, car force est de constater que ce sont les questions proprement cosmologiques qui débouchent directement sur l’existence et sur l’action de Dieu. » (p. 52). Plus précisément, « les principes de sa mécanique ne peuvent rendre compte à eux seuls de la formation de l’Univers, de sa stabilité, de sa destination » (p. 53). La conservation de la quantité globale de mouvement dans l’Univers, tout comme l’interaction gravitationnelle, requiert ainsi une intervention divine.
Cette cosmologie newtonienne a pour premier défenseur Samuel Clarke qu’il défend face à Leibniz. Non seulement ce dernier rejette la loi d’attraction d’universelle, mais il écarte l’idée d’un espace, d’un temps et d’un mouvement absolus. En tant qu’ils ne sont que des « systèmes de relations entre choses créées » (p. 72), l’espace et le temps absolus sont de pures fictions. Enfin, si Leibniz admet l’infinité de l’Univers et par là-même l’infinité en acte de l’espace, il ne saurait accepter que le monde matériel soit fini, précisément parce qu’il rejette l’idée d’un espace vide. Toutefois, cette infinité n’est qu’a parte post, puisque l’Univers a été créé. L’infinitisme aussi bien en théologie, qu’en cosmologie et en mathématiques n’est certes pas remis en cause, mais les raisons justifiant les différentes formes d’infinités ainsi que la manière d’envisager leurs rapports divergent.
John Toland reprend pour l’essentiel la conception leibnizienne du temps et de l’espace. John Toland est ainsi le moins newtonien des newtoniens, puisqu’il rejette tout autant la loi d’inertie, un temps et un espace absolus, l’existence du vide, que la divisibilité de la matière. Il défend en revanche une cosmologie infinitiste de l’Univers, qui s’inscrit dans le sillage laissé par Giordano Bruno, « en lui donnant une forte coloration matérialiste » (p. 84-85). Le free-thinker sera ainsi le premier, ou presque, à parler de « panthéisme ».
L’ultime cosmologiste newtonien qu’examine Seidengart est d’une importance capitale dans l’influence qu’il a eu sur les œuvres cosmologiques de Kant et de Laplace. En effet, avant ces deux derniers, Buffon a cherché à étendre la mécanique newtonienne au-delà des domaines où Newton l’avait restreinte : « L’originalité de Buffon apparaît dans ce refus de faire intervenir la “main de Dieu” pour rendre compte scientifiquement de la formation et de la structure du système solaire. » Ainsi, la force d’impulsion, qui permet de contrebalancer la force d’attraction accélérant les planètes et leurs satellites vers le centre de gravité du soleil, est-elle issue d’une collision d’une comète avec le Soleil, qui déplace ce dernier en en détachant une portion de matière. Enfin, Buffon s’oppose à l’idée d’un infini existant en acte, car, comme les empiristes, il estime que seul le fini est positif, l’infini n’étant qu’une idée de privation, sans objet réel. En effet, comme l’auteur l’expose, dans le second chapitre de son ouvrage, les empiristes sont pour le moins réticents à l’idée d’un Univers infini, notre entendement étant borné à la connaissance d’objets finis.
La crise de l’infinitisme cosmologique
C’est à partir de la mise en évidence des bornes de l’esprit humain que les empiristes vont remettre en cause la conception rationaliste de l’infinité de l’Univers. Bayle, Collier, Hobbes, Locke, Berkeley ou encore Hume, tous défendent que l’idée d’infini ne saurait avoir un caractère positif, car, contrairement à ce que défendait encore Newton, le fini n’est pas une négation de l’infini. Comme l’expose Locke dans son Essai sur l’entendement humain (1690), notre idée d’infini n’est issue que de notre capacité à répéter une opération de l’esprit de manière illimitée et de l’idée du « reste inépuisable », c’est-à-dire la suite illimitée des opérations de l’esprit que nous pourrions en droit répéter de manière illimitée. Toutefois, le rapport critique qu’entretient Locke vis-à-vis de l’idée d’infini ne l’empêche pas de partager la conception newtonienne de l’espace, tout comme l’existence de l’Être infini qu’est Dieu, et cela car chez Locke, « ce qui est inconcevable ou incompréhensible pour nous ne laisse pas d’être cependant » (p. 183). Quant à Berkeley, d’un côté il semble vouloir réduire à néant ce qui restait d’entités métaphysiques dans l’œuvre scientifique de Newton, d’un autre côté, dans la Siris (1744), le philosophe irlandais paraît mettre de côtés les leçons qu’il avait tirées de sa théorie de la connaissance sur l’idée d’infini. Il faudra par conséquent attendre David Hume, « pour que le puissant dissolvant des systèmes métaphysiques parvienne à ses fins en ruinant les idées de substance spirituelle et de causalité. » (p. 190). Hume rejette aussi bien l’infiniment petit, car notre connaissance part nécessairement de minima sensibles, que l’infinité extensive, relevant de la cosmologie, car elle outrepasse largement nos capacités finies. La cosmologie ne saurait par conséquent devenir une science et par là-même constituer une preuve a posteriori de l’existence de Dieu. C’est ainsi que l’infinitisme cosmologique issu de la Renaissance et de l’âge classique entra « dans une période de crise et de profonds bouleversements dont il ne se remit jamais véritablement » (p. 200).
En Allemagne, Christian Wolff, pour qui l’un des objectifs principaux est de démontrer l’existence de Dieu par la contingence du monde s’inscrit à bien des égards dans la continuité de la cosmologie leibnizienne. Wolff considère néanmoins, comme Baumgarten, que précisément parce que le monde est contingent, il ne saurait être infini que potentiellement. Seul Dieu, c’est-à-dire l’Être nécessaire et hors du temps qui justifie l’existence du monde, est infini en acte, contrairement à l’Univers, soumis à l’infinité a parte post du temps. Toutefois, la nécessité pour le monde de la philosophie allemande, au XVIIIe siècle, de démontrer la compatibilité des enseignement de la foi avec ceux de la raison, ont poussé certains à contester la durée illimitée de l’Univers et l’infinité de l’étendue cosmique, avec pour fin principale d’assurer à l’Univers un commencement et par là-même une création.
La cosmologie kantienne va précisément se trouver au point d’intersection de ces différents courants de pensée. C’est en grande partie de la convergence du rationalisme allemand, davantage issu de la philosophie de Leibniz, et de la physique newtonienne, que la cosmologie kantienne précritique va naître ; cela, avant que l’empirisme humien ne vienne sortir Kant de son « sommeil dogmatique » et ne participe à l’émergence du criticisme.
La cosmologie précritique
C’est à partir de la physique des Principia de Newton que Kant va construire sa cosmologie dans sa Théorie du Ciel (1755), en tentant, au moyen du principe d’analogie, d’étendre la portée des lois de la mécanique : « l’universalité des lois fondamentales de la mécanique devait donc permettre à Kant de passer […] suivant un ordre croissant de systèmes hiérarchiquement emboîtés, de la partie au Tout » (p. 229). C’est la conjonction de cet emboîtement des systèmes de corps célestes au moyen de lois physiques universelles, de l’infinité de Dieu, et de la manifestation de l’infinité divine qui permet à Kant d’établir l’infinité de l’Univers (p. 240). Toutefois, malgré le lien étroit que Kant établit dans ce texte entre la physique et la théologie, c’est uniquement à l’aide des lois de la mécanique qu’il cherche à expliquer la formation de l’Univers. À partir d’un chaos originel, la matière va, depuis un point central, s’organiser progressivement, dans l’espace infini en acte et avec une durée illimitée : « la sphère d’ordre, la sphère actuellement formée ne cesse de s’étendre, mais si grande soit-elle, elle demeure toujours finie. Elle ne fait que tendre vers l’infini » (p. 259). Kant peut ensuite formuler ce qu’Helmholtz appellera l’hypothèse Kant-Laplace.
L’originalité du Beweisgrund (1963) est de montrer que l’ordre de la nature possède une unité nécessaire, permettant de démontrer l’existence de Dieu. Cette fois-ci, Kant écarte l’idée d’infini du domaine de la cosmologie et préfère le terme d’« omnisuffisance » de Dieu pour caractériser la perfection de celui-ci. Appliquer le terme d’infini aux mathématiques, au monde matériel et à Dieu, risque d’introduire des équivoques ainsi que des analogies entre Dieu et les choses créées, ce qui ramènerait Kant vers une forme de spinozisme.
Pour comprendre ensuite le moment où Kant a commencé à basculer dans la période critique, Seidengart nous invite à comparer Du premier fondement de la différence des régions de l’espace (1768) avec la Dissertation sur la forme et les principes du monde sensible et du monde intelligible de 1770. Dans le premier opuscule, Kant s’efforçait de démontrer le caractère absolu et indépendant de toute matière de l’espace cosmique, quand dans le second, Kant fait de l’espace une forme a priori de la sensibilité. Ceci étant dit, « Kant se trouvait encore dans l’incapacité de rendre compte du fondement des sciences de la nature et plus particulièrement de la physique » (p. 305). Cet espace et ce temps, Kant les pose comme des infinités données. Parce qu’ils sont donnés immédiatement, de manière intuitive, leur infinité ne saurait être le résultat d’une composition progressive et intellectuelle.
Les limites posées à la cosmologie
Kant va reprendre cette conception de l’espace et du temps dans l’Esthétique transcendantale de la première Critique (1781). Mais, selon Seidengart, qui s’appuie sur les propos de Kant lui-même, « c’est la question des antinomies qui mit Kant sur la voie de l’idéalisme transcendantal » (p. 331). En effet, la première partie de la Critique de la raison pure va établir que notre pouvoir de connaître a priori ne nous permet pas de dépasser les limites de l’expérience possible : « l’Antinomie est donc le lieu où la Critique élucide l’expérience de la transgression des limites de la raison pure théorique en tentant de connaître entièrement a priori l’Univers pris comme chose en soi. » (p. 338). L’échec de cette expérience permet de démontrer la nécessité de limiter les prétentions de la raison pure, cette dernière cherchant notamment à ériger l’espace, qui est une grandeur infinie donnée, en totalité absolue. Dans la première antinomie, Kant ne remet pas en cause l’infinité de l’espace et du temps, mais l’infinité ou la finitude du Monde dans l’espace et le temps. L’illusion transcendantale consiste à prendre pour une réalité en soi l’exigence subjective d’inconditionné propre à notre raison. La première Critique a ainsi permis à Kant de délimiter clairement les territoires de la science, de la métaphysique et de la théologie qui étaient encore intrinsèquement liés dans la cosmologie précritique de 1755. Désormais, la perception du spectacle du Monde ne nous permet plus d’arriver à une preuve concluante de l’existence de Dieu, mais seulement à une philosophie de l’espérance. La beauté et la sublimité de la nature « nous rappelle à notre vocation morale » (p. 417) et ainsi à l’infinité de notre destination suprasensible.
Ceci étant dit, les enseignements issus des Antinomies n’ont pas empêché Kant de continuer à s’intéresser aux questions cosmologiques dans son texte Sur les volcans lunaires (1785), sans transgresser les limitations strictes du champ de la connaissance. Kant y reprend les éléments de la Théorie du Ciel sur la formation du Soleil et des planètes en voulant les compléter au moyen des nouvelles découvertes scientifiques survenues entre-temps.
Il faut cependant attendre 1786, dans les Premiers principes métaphysique de la nature, pour que Kant traite à nouveau de la question de l’infinité cosmique. La force d’attraction s’exerçant à l’infini dans l’Univers et de manière immédiate, on peut la décrire comme infinie en acte. L’espace n’est ici plus la forme pure de notre sensibilité, ni une chose en soi, mais il s’agit de l’espace physique. Kant ne viole peut-être pas ici les limites posées par la première Critique, mais « il laisse indéterminé le statut du rapport entre l’espace physique et la forme pure du sens externe » (p. 414). L’Übergang aura précisément pour tâche dans l’Opus postumum de surmonter cet écart au moyen de l’éther.
À partir de l’Opus Postumum en effet, l’éther possède un rôle transcendantal afin de garantir le passage des principes métaphysiques de la nature à la physique. L’éther assure l’unification de la diversité des phénomènes dans une sorte de matière première. Selon Kant, l’espace que nous intuitionnons comme vide est rempli par l’éther, sans quoi, en tant que forme a priori de l’intuition externe, il coordonnerait du néant. De plus, l’éther étant illimité et tout ce qui est dans l’espace et le temps étant plongé dans l’éther, l’Univers est infini. Si Kant, selon Seidengart, avait écarté momentanément la possibilité d’un Univers infini à l’époque des trois Critiques, c’est d’une part pour éviter les ravages que pourrait produire l’infinitisme dans la morale et la religion, d’autre part pour éviter de tomber dans le panthéisme et par là-même le spinozisme. Enfin, pour parvenir au système de la philosophie transcendantale, il semble nécessaire d’unifier les idées transcendantales. Et c’est à l’Homme d’opérer l’ultime synthèse de l’idée de Dieu et de celle de Monde ; car, en tant que Cosmotheoros, il est à la fois « un habitant et un spectateur de l’Univers liant, grâce à son statut d’être pensant, le Monde […] à Dieu » (p. 448).
Ce qui permet de rapprocher Laplace et son Exposition du système du monde (1796) de Kant, c’est que tous deux se sont inspirés de Buffon, en cherchant à expliquer la formation du système du Monde sans recourir à une explication sortant du cadre de la physique newtonienne. Quant à l’infinité de l’Univers, pour Laplace, elle n’est pas une question d’ordre scientifique, « mais plutôt une interrogation philosophique aux confins de la science qui repose sur l’inconcevabilité d’un Univers borné » (p. 472). En revanche Heinrich Olbers sera lui l’un des derniers grands défenseurs du modèle d’Univers infini fondé sur la métaphysique précritique de Kant. Pourtant, son paradoxe, selon lequel, si l’Univers était infini, il contiendrait une infinité d’étoiles et le ciel devrait par là-même être entièrement illuminé, constituera une des réfutations les plus célèbres à cette infinité.
Seidengart se sépare ainsi de Koyré dans l’analyse qu’il fait de l’infinitisme cosmologique à partir du XVIIIe siècle. Non seulement celui-ci connaîtrait une forte remise en cause, mais il ne déboucherait pas brusquement « sur une crise intellectuelle qui consacre simultanément le succès de la connaissance scientifique et le désenchantement du monde », avec notamment chez Laplace, « un Univers infini, mais totalement dénué de signification, de valeur et de consistance ontologique » (p.485). L’Univers est en effet considéré par Laplace comme infini, mais seulement indirectement, en raison de la grande difficulté qu’il a à l’envisager comme limité.
Pour finir, malgré la grande exhaustivité de l’auteur dans son analyse de la question de l’infinité de l’Univers au XVIIIe siècle, on aurait pu également apprécier que soient prises en compte certaines analyses d’épistémologues et d’historiens des sciences contemporains. Ainsi, « l’extinction momentanée du problème de l’infini dans le champ de la cosmologie » (p.490) n’est-elle pas précisément la conséquence d’une science que Thomas Kuhn qualifierait, dans sa Structure des révolutions scientifiques, de « science normale » ? En effet, comme le rappelle Seidengart dans sa conclusion, avec le triomphe de la physique newtonienne les scientifiques ont fini par admettre l’infinité de l’espace cosmique: « Les astronomes du siècle des Lumières se débarrassaient purement et simplement du problème en posant, à titre d’hypothèse commode, l’infinité de l’Univers pour signifier que la question nous dépasse » (p.489). La cosmologie ne serait-elle pas entrée, au cours du XVIIIe siècle, dans une phase de science normale dont le paradigme aurait été défini par Newton et ses principaux héritiers ? Cette science normale cosmologique consisterait pour les scientifiques à ne plus s’interroger sur les cadres et les fondements du paradigme préalablement posé, comme l’infinité de l’Univers, mais à tenter de résoudre les nouvelles énigmes posées par celui-ci. En outre le criticisme n’est-il pas une tentative pour Kant, après avoir poursuivi la cosmologie newtonienne dans sa période précritique, de chercher à en solidifier les fondements en se départissant de toute théologie et de toute ontologie ? Le fait, comme le signale ultimement l’auteur, que cet intérêt pour l’infini se soit concentré dans le domaine mathématique au milieu du XIXe siècle (géométries non-euclidiennes, théories des ensembles infinis, etc.), a permis, quelques décennies plus tard, de fournir les instruments mathématiques à la révolution einsteinienne qui, en remettant en cause les bases mêmes de la physique newtonienne, a fragilisé grandement le criticisme kantien.














