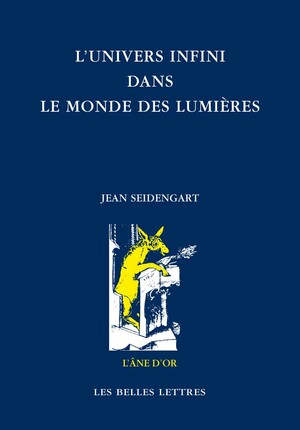Recension – Sexe et genre. De la biologie à la sociologie
Agathe du Crest est doctorante en philosophie à l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques (IHPST) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cet article est une recension de l’ouvrage collectif dirigé par Bérengère Abou et Hugues Berry : Sexe et genre. De la biologie à la sociologie, publié aux Éditions Matériologiques en mai 2019. Vous pouvez trouver l’ouvrage sur le site de son éditeur en cliquant ici et le consulter en ligne sur Cairn.
Sexe et genre entre naturalisme et constructivisme
Dans le monde académique comme dans l’espace public, les notions de sexe et de genre constituent un enjeu autant épistémique qu’éthique, social et politique, car elles renvoient aux questions du naturalisme et des normes. L’ouvrage collectif Sexe et genre. De la biologie à la sociologie dirigé par Bérengère Abou et Hugues Berry se propose d’élaborer une réflexion relationnelle entre les deux concepts, ainsi qu’entre les disciplines auxquelles ils sont traditionnellement assignés — la biologie face aux sciences humaines et sociales. Publié en 2019, il est le résultat perfectionné de l’édition 2015 de l’École de Berder (l’École thématique interdisciplinaire d’échanges et de formation en biologie, interne au CNRS), qui organise depuis 2002 des rencontres interdisciplinaires afin de mieux répondre aux grandes problématiques contemporaines en biologie. Le croisement des approches est conçu comme un ressort puissant de découvertes scientifiques, grâce aux transferts de concepts, d’outils, de méthodes. Au fil de ses cinq parties, le présent ouvrage mêle et équilibre les approches issues de perspectives diverses : biologie évolutive, génétique, écologie, sciences sociales histoires, sociologie, philosophie, neurobiologie, socio-anthropologie, ou encore sciences de l’information et de la communication. Sa lecture peut ainsi profiter non seulement aux non-spécialistes, mais également aux spécialistes d’une discipline souhaitant développer une vision plus globale. Il est moins question de proposer une thèse radicalement nouvelle, que de faire l’état des recherches relatives au sexe et au genre en synthétisant les points de vue disciplinaires et en cherchant à les harmoniser.
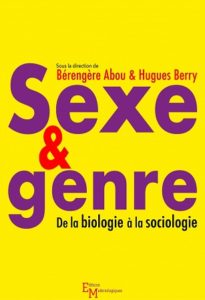 Le sexe est-il entièrement déterminé génétiquement ? Les normes de genre peuvent-elles influencer le développement du corps ? La notion de genre est-elle pertinente pour comprendre la façon dont la recherche se fait ? D’un côté, les sciences biologiques sont traditionnellement plus enclines aux arguments « naturalistes », en affirmant qu’il y a entre les deux sexes une discontinuité ainsi que des différences innées et irrémédiables. À l’inverse, les sciences sociales (notamment la sociologie) se sont construites sur des présupposés anti-innéistes1 et étudient les contributions socio-culturelles, environnementales : le concept de « genre » permet de penser la différence sexuée comme un rapport de force construit socialement. Est-il possible de concilier ces approches ? Il s’agit ici de reprendre les avancées théoriques que l’on doit à ces deux perspectives, en se plaçant plutôt du côté constructiviste. Les contributions intègrent ainsi la critique fondamentale des idéaux d’impartialité, de neutralité et d’autonomie de la science formulée par l’épistémologie féministe à la fin des années 1970. Elles reprennent aussi la réflexion sur la « fabrication » réciproque du sexe et du genre, dans la lignée notamment des travaux d’Anne Fausto-Sterling, Judith Butler, Thomas Laqueur, Thierry Hoquet ou encore Rebeca Jordan-Young. Cette critique porte ici sur les défaillances relatives à la définition de la notion de « sexe » et à l’absence d’une corrélation avec celle de « genre », sur les normes qui en découlent sur les plans théorique et pratique, ainsi que sur les angles morts qui demeurent de fait dans la recherche.
Le sexe est-il entièrement déterminé génétiquement ? Les normes de genre peuvent-elles influencer le développement du corps ? La notion de genre est-elle pertinente pour comprendre la façon dont la recherche se fait ? D’un côté, les sciences biologiques sont traditionnellement plus enclines aux arguments « naturalistes », en affirmant qu’il y a entre les deux sexes une discontinuité ainsi que des différences innées et irrémédiables. À l’inverse, les sciences sociales (notamment la sociologie) se sont construites sur des présupposés anti-innéistes1 et étudient les contributions socio-culturelles, environnementales : le concept de « genre » permet de penser la différence sexuée comme un rapport de force construit socialement. Est-il possible de concilier ces approches ? Il s’agit ici de reprendre les avancées théoriques que l’on doit à ces deux perspectives, en se plaçant plutôt du côté constructiviste. Les contributions intègrent ainsi la critique fondamentale des idéaux d’impartialité, de neutralité et d’autonomie de la science formulée par l’épistémologie féministe à la fin des années 1970. Elles reprennent aussi la réflexion sur la « fabrication » réciproque du sexe et du genre, dans la lignée notamment des travaux d’Anne Fausto-Sterling, Judith Butler, Thomas Laqueur, Thierry Hoquet ou encore Rebeca Jordan-Young. Cette critique porte ici sur les défaillances relatives à la définition de la notion de « sexe » et à l’absence d’une corrélation avec celle de « genre », sur les normes qui en découlent sur les plans théorique et pratique, ainsi que sur les angles morts qui demeurent de fait dans la recherche.
Le rôle des représentations implicites dans la production de savoir
Malgré une prétention à l’objectivité, les recherches en sciences biologiques s’érigent sur des valeurs de genre implicites et non-scientifiques2 qui altèrent leur rapport à la réalité. C’est ce que les sept premiers chapitres s’emploient à démontrer, en étudiant les notions puis les explications en biologie. C’est le caractère « situé » du savoir qui se voit questionné, autrement dit le fait qu’il reflète toujours la perspective particulière d’un sujet.
Anne Atlan ouvre la discussion en décrivant l’origine évolutive des sexes et l’ancrage du paradigme dualiste en biologie. Elle expose les raisons de l’existence de deux sexes et deux sexes seulement chez les organismes unicellulaires, avant de traiter de l’anisogamie et des dimorphismes sexuels qui l’accompagnent3. Selon le paradigme actuel, hérité de la théorie de la sélection sexuelle de Darwin, c’est la distinction entre deux types de gamètes qui fonde le dualisme des sexes et des rôles assignés à chacun. A. Atlan soutient certes que les différences entre les gamètes sont un facteur fondamental, qui constitue une base sur laquelle un ensemble de distinctions viennent se greffer. Mais, ajoute-t-elle, « en biologie il n’y a pas de loi aussi inébranlable qu’en physique » et, s’il existe des régularités relatives à l’origine évolutive des sexes et qui peuvent fonder la théorie de la sélection sexuelle, il ne peut pour autant y avoir d’explication totalisante de toutes les réalités liées au sexe. En effet, le « sexe quantitatif », c’est-à-dire à la gamme de variation qui touche les organismes hermaphrodites d’une part, les traits physiques et comportementaux de l’autre, ainsi que les soins parentaux mettent en évidence la multiplicité des situations et les nombreuses exceptions auxquelles la biologie doit faire face. La posture intermédiaire entre naturalisme et constructivisme qui guide l’ouvrage est donc posée. Intégrer la notion de genre dans les sciences biologiques ne contraint pas à adopter une vision « ultra-constructiviste » des phénomènes biologiques, consistant à nier la réalité matérielle du sexe et l’existence d’une dualité. Mais c’est la condition pour examiner de façon critique l’impact de l’environnement (la culture, l’éducation) sur la façon dont le sexe est défini et articulé avec d’autres concepts.
Comment le genre construit-il le sexe ? C’est la question de la « biologisation du social » qui est ensuite mise en lumière. Gabriel Marais et Jos Käfer expliquent la multiplicité des facteurs qui entrent en jeu dans le développement du sexe chez les êtres humains et la complexité des systèmes sexuels dans le vivant. À partir de l’idée d’Anne Fausto-Sterling d’une « variation quantitative, voire une continuité » et de la réflexion de Canguilhem sur la frontière entre normal et pathologique, ils refusent d’abolir les deux catégories de sexe : les catégories peuvent être fondées sur les différences quantitatives, tandis que des essences différentes relèveraient de différences qualitatives entre les sexes. Les variables socio-culturelles doivent être intégrées pour mieux comprendre le contexte de développement des dimorphismes sexuels, physiques ou comportementaux. Les deux chapitres suivants retracent l’histoire récente du terme de « genre », défini par Églantine Jamet et Muriel Salle comme un « outil d’analyse, un concept qui permet de penser la différence entre le masculin et le féminin et surtout la hiérarchie et le rapport de force qui s’inscrit dans cette différence. » En considérant cette différence comme un fait social, le point de départ des études de genre semble à l’opposé de la biologie ; et pourtant les sciences sociales interviennent ici comme les vecteurs d’un renouvellement conceptuel, en permettant d’intégrer les réflexions de Simone de Beauvoir, de Françoise Héritier ou encore d’Anne Dafflon-Novelle sur le marketing genré des Lego. Cette première partie s’oppose ainsi à la dichotomie conceptuelle qui pousse, depuis les années 1950, les scientifiques à réduire le réel aux « objets légitimes de leurs espaces disciplinaires » qui leur ont été assignés.
Comment des biais de genre peuvent-ils imprégner la recherche ? C’est la question de la deuxième partie, qui se concentre plus particulièrement sur la biologie évolutive et la neurobiologie. Le cinquième chapitre qui l’ouvre dévoile les échanges entre le monde scientifique et l’espace public par l’intermédiaire de la vulgarisation scientifique. Sur son blog Allodoxia, Odile Fillod produit des analyses des discours de diffusion du savoir, dont elle élabore ici une synthèse. Outre le pont créé entre les disciplines, c’est un deuxième type de relation qui est mis à jour, de façon moins élogieuse puisque les représentations sexistes déforment le réel et les contenus proprement scientifiques. L’autrice montre ainsi que nombre d’allégations en faveur d’une sexuation naturelle des différences cognitives et comportementales reposent sur des références entièrement erronées à des travaux scientifiques, ou au minimum sur des extrapolations et des reformulations de résultats choisis et pris à tort pour acquis. La « confusion entre associations statistique (résultat de l’étude) et lien de causalité (hypothèse interprétative) » est notamment soulignée.
Si les experts et journalistes scientifiques peuvent falsifier le contenu scientifique, la production scientifique est à son tour, et tout autant, altérée par les présupposés relatifs à des valeurs non-cognitives, remettant en cause la neutralité et l’impartialité censées être les conditions nécessaires à la validation d’une théorie comme « scientifique ». Se dessine un cercle d’influence entre les valeurs non-scientifiques, issues de l’espace social, et les connaissances scientifiques : celles-là altèrent les dernières, et les sciences de la nature, qui bénéficient d’un « privilège épistémologique » pour reprendre l’expression d’Alexandre Jaunait, influencent en retour l’imaginaire collectif. En neurobiologie, Catherine Vidal retourne la critique selon laquelle les thèses féministes sont « idéologiques » et « partisanes » contre ceux qui les formulent. Elle présente le concept de plasticité cérébrale comme « fondamental pour aborder la question de l’origine des différences et des similarités entre les sexes » et retrace de façon chronologique l’émergence des différences entre les sexes. Il en ressort l’affirmation de la nécessité des facteurs environnementaux dans le développement du cerveau, afin que les possibilités fournies par la matière neuronale soient rendues effectives. Enfin, le chapitre écrit par Clémentine Vignal porte sur les rôles assignés aux organismes selon leur sexe, depuis la théorie de la sélection sexuelle, alimentée ensuite par Angus J. Bateman et Robert L. Trivers. Elle souligne « la diversité et la variabilité des comportements » par rapport au modèle dichotomique classique entre femelle timide (coy female) et mâle ardent (eager male) et critique non seulement l’attribution de rôle typiques sexuels, mais aussi la tendance à étudier plus souvent les mâles que les femelles. Selon elle, la stabilité du paradigme mâle compétitif-femelle discrète repose sur la persistance de valeurs sociales liées à la domination masculine dans la société humaine. Ce sont ces dernières qui empêchent les chercheurs de questionner les théories dont ils héritent (notamment en ne répliquant pas des modèles explicatifs) et d’ignorer les approches alternatives, féministes ou non.
Améliorer les explications biologiques liées au sexe et au genre
Après un moment critique, l’ouvrage prend un tournant constructif. Dans les quatre chapitres des troisième et quatrième parties, la biologie, enrichie des critiques sur ses représentations, intègre de nouvelles perspectives et de nouveaux objets d’étude.
L’enjeu de la troisième partie intitulée « Sexe et genre en biologie » est donc de présenter deux exemples de la façon dont la recherche en biologie peut être renouvelée. Priscille Touraille propose ainsi de s’intéresser à un sujet peu étudié, le clitoris, et d’interroger les concepts de plaisir et de motivation qui lui sont corrélés. Il s’agit de proposer une nouvelle piste de recherche et de faire exister, du moins de rendre visible, des objets jusque-là ignorés. La thèse qu’elle suit est que le « dispositif de genre » — autrement dit le système normatif d’imposition d’un genre — a caché le plaisir sexuel car c’est une notion qui le met en péril, étant fondé sur une bicatégorisation4 en faveur de la reproduction. Les organes reproducteurs distinguent en effet deux sexes, ce qui permet d’assigner des rôles de genre. Mais les organes sexuels qui servent au plaisir, le pénis et le clitoris, « révèlent une fonction biologique identique, partagée par les individus, non différenciée, non “différenciable”, et par là, piètre prétendante au grand credo de “la-différence-des-sexes” ». Si les organes reproducteurs ont des fonctionnements différents selon leur appartenance à un corps mâle ou femelle, ce n’est donc pas le cas des organes sexuels qui obéissent à la même fonction qu’est l’orgasme. La catégorisation mâle-femelle n’est donc pas fondée sur les clitoris et les pénis, mais sur les gonades et les gamètes — ce qui est caché lorsque la pensée scientifique occidentale assujettissant les organes sexuels aux organes reproducteurs. En choisissant de distinguer deux types d’organes et de fonctions biologiques, l’autrice refuse d’invisibiliser le plaisir sexuel en l’inféodant à la fonction reproductive. Dès lors, l’argumentation se développe en deux axes : d’une part, une critique du présupposé selon lequel seuls les êtres humains (à quelques exceptions) seraient capables d’éprouver du plaisir sexuel, d’autre part l’affirmation du plaisir sexuel comme motivation à la sexualité (au lieu que seule la reproduction ait ce rôle).
Karine Prévot analyse ensuite les recherches sur le développement du sexe et les définitions déterministes convoquées dans ce cadre qui s’appuient sur la génétique et plus généralement la biologie moléculaire. La bactérie Wolbachia pipientis sert d’exemple illustrant le rôle des symbioses (l’association antagoniste ou bénéfique entre deux organismes) dans la détermination des caractères sexuels. Dans le cas présent, Wolbachia a une incidence décisive sur le développement des caractères sexuels, plus encore que les chromosomes. Elle permet donc de mettre en doute le modèle généralisé à toutes les espèces d’une déterminisme exclusivement interne et génétique : l’expression des gènes dépend de facteurs environnementaux, et la coopération interspécifique est un concept qu’il est ici possible de manier, comme celui de codéveloppement (K. Prévot se réfère ici à Scott Gilbert, Developmental Biology, 1985).
Comment prendre en charge les cas qui sortent du cadre normatif du dualisme sexuel ? Les transidentités et l’intersexualité sont au cœur de la quatrième partie. Arnaud Alessandrin propose de retracer les changements définitionnels de la transidentité, des définitions médicales pathologisantes du « transsexualisme » dans les années 1950 aux approches plus « bienveillantes » non seulement en psychanalyse, mais surtout avec la sociologie et l’anthropologie. Il définit ensuite ce qu’est une « identité de genre ». Le corps biologique est ainsi intégré comme une contrainte normative, contrainte de genre à l’intérieur de laquelle se développent les identités et notamment les transidentités : « il n’y a pas d’expériences totalement extérieures aux normes de genre, mais, au contraire, des innovations de genre qui s’appuient sur les normes pour les contrarier ».
Dans le chapitre 11, Sandy Montañola et Natacha Lapeyroux relatent l’intérêt des journalistes sportifs pour Caster Semenya lors des Jeux Olympiques de 2016, sept ans après que l’athlète a été soumise à un « test de féminité » car ses performances sportives avaient jeté le doute sur son identité sexuelle. C’est donc l’occasion de regarder dans quelle mesure les journalistes (et par là, la sphère publique) ont changé leur représentation de l’intersexuation pendant cette période et quelles sont les limites de ce changement. De plus, ce chapitre 11 fait écho au chapitre 5 en montrant à quel point la biologie sert d’argument d’autorité naturaliste auprès des non-spécialistes. La thèse proposée est la suivante : « Les représentations médiatiques définissent la réalité à travers un travail de sélection, de présentation, de structuration, de façonnage et œuvrent activement à ce que les choses aient un sens ». En 2016, les médias ne se concentrent plus sur la question de la détermination de l’identité sexuée de C. Semenya, mais sur le bouleversement produit sur les normes binaires dans le monde sportif, entre les compétitions hommes et les compétitions femmes, ainsi que la capacité de la science à définir le sexe. Ce dernier point rend compte de la porosité entre les changements conceptuels qui s’opèrent dans le monde de la recherche et dans la sphère publique. Les autrices mettent en effet en évidence le questionnement des médias sur la notion de binarité à partir du cas de C. Semenya, reconnaissant ainsi l’existence d’un problème scientifique complexe, et que les institutions sportives ne savent pas gérer. De nombreux journalistes procèdent à un « parcours de réhabilitation » de la sportive en critiquant les tests de féminité et le traitement médical dont elle a fait l’objet. Une nouvelle conception est donc mise à jour : « l’intersexuation est maintenant nommée et expliquée » par les médias, toujours en recourant au champ de la biologie. Cependant les autrices signalent le caractère « ambivalent » de cette remise en cause, qui n’abandonne pas un vocabulaire pathologisant et use de l’argument de « l’équité » dans le sport : les références à l’anormalité ne désignent plus la sportive elle-même, mais ses capacités physiques. L’hyperandrogénie apparaît à la fois comme une maladie et comme ce qui induit « l’absence de suspense sportif pendant la course », autrement dit une anomalie interne au domaine sportif. Le discours normatif demeure, en se fondant sur la distinction naturel – non-naturel.
Les liens entre la recherche et les pratiques qui lui sont liées
C’est un troisième type de relations qui conclut la dernière partie de l’ouvrage : non plus entre les sciences biologiques et les sciences humaines et sociale, non plus entre les sphères académique et publique, mais entre la recherche théorique et les pratiques qui lui sont liées. Est d’abord considéré le traitement différentiel des corps des femmes et des hommes dans le cas médical ; puis les conditions effectives de la recherche s’agissant des carrières des chercheuses et des chercheurs en écologie. Les contributions proposent la thèse de l’intrication des théories produites par la recherche avec des pratiques tout autant imprégnées de valeurs de genre.
Le rapport causal se présente d’abord de manière telle que la théorie fonde des pratiques de genre en médecine. Selon Murielle Salle le XIXe siècle marque la construction du corps des femmes « comme essentiellement différent et pathologique » par les discours médicaux, qui conçoivent le corps des femmes comme naturellement inférieur à celui des hommes, sujet aux pathologies qui touchent les hommes mais aussi à un grand nombre de maladies propres aux femmes. C’est l’usage conjoint des notions de sexe et de genre qui peut permettre des innovations autant théoriques qu’en matière de soins effectifs. L’observation de différences biologiques naturalise l’inégalité à la fois sur le plan des droits naturels et dans le domaine médical. La conclusion de M. Salle à ce propos révèle un argument circulaire : Cette Nature féminine est à la fois la cause et la conséquence des pathologies féminines, une grille de lecture des maladies des femmes en même temps qu’un cadre auquel ces dernières se voient perpétuellement renvoyées, assignées. » Davantage, « le sexe féminin est partout dans la femme et la femme est tout entière comprise dans son sexe » : contrairement à l’homme dont le sexe est extérieur et n’influe pas sur son être, la femme est définie par et assujettie à son corps. L’autrice reprend à son compte la théorie des savoir situés de Sandra Harding et plus généralement les critiques féministes des sciences et en énonce trois buts : souligner l’imposture de la revendication d’un point de vue neutre et objectif du savoir scientifique, valoriser les savoirs des femmes et « produire des théories pour comprendre, analyser et transformer l’existence des femmes ». De là, à partir de la perspective d’origine qui retenait les seules différences entre les corps des hommes et des femmes, les pratiques médicales doivent prendre en compte les similitudes anatomiques et physiologiques qui existent, et ne pas systématiquement imputer les dissemblances au facteur du sexe. M. Salle propose notamment l’exemple du traitement différentiel des infarctus pour illustrer ce propos. L’intégration de la notion de genre permet à la médecine de faire valoir que les inégalités entre les sexes face à la maladie ne tiennent pas qu’au domaine biologique, mais aussi à des facteurs socio-culturels : des différences de comportements, ou une prise en charge thérapeutique inégale.
Le dernier chapitre enfin propose une étude comparative entre la France et la Norvège qui s’applique à « cerner le rôle du contexte national dans la formation des inégalités de carrière ». Elle met ainsi en évidence deux moments créant le « plafond de verre » défavorable aux femmes : le recrutement du personnel dans un poste permanent (plus préjudiciable en Norvège qu’en France), et le processus de promotion permettant de passer du statut de junior à senior (plus préjudiciable en France). Le premier pilier de ces inégalités sont les contraintes liées à la maternité et à l’organisation familiale, ainsi que la productivité des femmes : le taux de publication chute lorsqu’elles fondent une famille, contrairement aux hommes, les femmes prennent plus en charge les tâches liées au foyer, à leurs enfants et apportent plus d’aide professionnelle à leur conjoint lorsque celui-ci est aussi chercheur que la réciproque. Enfin, la répartition des tâches dans la sphère professionnelle constitue le deuxième pilier, les femmes s’occupant plus des tâches d’enseignement par rapport à celles de la recherche.
Quelques observations critiques
L’ouvrage Sexe et genre se distingue par son attachement à créer des passerelles : celle entre les sciences biologiques et les sciences humaines et sociales d’abord, dont le dialogue permet un enrichissement conceptuel. Celle entre la sphère scientifique et l’espace public ensuite : si les médias sont souvent vecteurs de déformations et de représentations sexistes, le caractère accessible de l’ouvrage, de par sa clarté et son esprit synthétique, donne lieu à un autre type de médiation scientifique. Enfin, la dernière partie met l’accent sur l’impact réciproque entre le produit théorique et les pratiques à l’œuvre au sein de la recherche scientifique.
On pourrait néanmoins regretter l’absence d’un usage de l’épistémologie féministe qui eût été pertinent : celui de la réflexion sur la neutralité épistémologique et son corollaire, la légitimité épistémique. On trouve certes dans l’ouvrage des références explicites à l’épistémologie féministe, comme lorsque Clémentine Vignal rappelle le rôle de Sarah B. Hrdy et de Patricia Gowaty dans l’évolution de la compréhension des rôles typiques des sexes ; ou quand Muriel Salle fait appel à Sandra Harding, à la proposition du standpoint feminism et au mouvement de politisation des sciences. De plus, l’ensemble des contributions reprennent implicitement les analyses féministes essentielles à l’égard des sciences : 1. les définitions et représentations implicites, non-cognitives et collectives imprègnent les sciences, en l’occurrence la biologie ; 2. cela produit une naturalisation des phénomènes et des faits causaux ; 3. il faut donc mettre en doute les valeurs traditionnelles de la science, à savoir l’impartialité, la neutralité et l’autonomie.
Mais puisque les auteurices construisent une critique des valeurs inhérentes aux théories scientifiques, il aurait aussi été pertinent de produire un questionnement réflexif à propos de leurs propres valeurs et du savoir engendré ici. En quoi les thèses anti-naturalistes ont-elles donc plus de légitimité que des thèses naturalistes ? Cette absence pourrait être un acte volontaire de refus d’une auto-justification conçue comme pouvant altérer la légitimité du propos. C’est cependant un enjeu essentiel que de déterminer ce qui fonde la légitimité, et même l’autorité épistémique, qui mérite sa place dans un travail abordable au grand public. Cette autorité est-elle dépendante d’une neutralité de la part des scientifiques ? Ou bien si l’on met en évidence l’existence de biais non-cognitifs inévitables dans la production de savoir, comment déterminer si certains ont plus de légitimité que d’autres, et lesquels ? C’est là un double enjeu. D’abord celui des critères selon lesquels l’autorité épistémique est distribuée dans le champ académique et des conséquences pour les chercheurs. Se joue ensuite la finalité du travail scientifique à travers la gestion des valeurs sociales qui la composent. On peut considérer, comme S. Harding ou H. Longino, qu’il est possible de reconstruire de l’objectivité au niveau de la communauté scientifique à partir de la confrontation de diverses perspectives situées (féministes ou non). Mais on peut aussi revendiquer un horizon politique à la science : Stéphanie Ruphy (2015) se demande par exemple si le succès d’une théorie doit être strictement épistémique ou intégrer une dimension politique, et propose une vision de la science qui réponde aux besoins de la société, ce qui suppose notamment de défendre les intérêts des minorités.
Pour aller plus loin
Judith Butler, 1990, Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity, Routledge.
Anne Fausto-Sterling, 2000, Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality, Basic Books.
Anne Fausto-Sterling, 2000, Corps en tous genres : la dualité des sexes à l’épreuve de la science, La Découverte.
Sandra Harding, 1986, The Science Question in Feminism, Cornell University Press.
Thierry Hoquet, 2014, Le Sexe biologique. Anthologie historique et critique, Hermann.
Thierry Hoquet, 2016, Des sexes innombrables, le genre à l’épreuve de la biologie, Seuil.
Rebeca Jordan-Young, 2010, Hormones, sexe et cerveau, Belin.
Thomas Laqueur, 1992, La Fabrique du sexe : essai sur le corps et le genre en Occident, Gallimard.
Stéphanie Ruphy, 2015, « Rôle des valeurs en science : contributions de la philosophie féministe des sciences », Écologie & politique, vol. 51, no. 2, 41-54.
Priscille Touraille et Anne Fausto-Sterling, 2014, « Autour des critiques du concept de sexe. Entretien avec Anne Fausto-Sterling », Genre, sexualité & Société 12.
Priscille Touraille, 2016, « Mâle/Femelle », in Rennes et al. (dir.), Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux, La Découverte, 369-379.
Catherine Vidal, 2015, Nos Cerveaux, tous pareils, tous différents !, Belin.
1 L’anti-innéisme désigne ici la position selon laquelle certaines caractéristiques liées au sexe sont, au moins en partie, acquises par l’entremise de l’environnement. « L’acquisition » n’a pas toujours le même sens : en particulier, elle peut vouloir dire que ces caractéristiques ne sont pas présentes dès la naissance, ou alors qu’elles ne sont pas encodées génétiquement.
2 Dans le chapitre 9, Karine Prévot évoque les conceptions et définitions « non-scientifiques » car « intuitives » : elles relèvent du sens commun et se distinguent des définitions scientifiques qui font l’objet de discussions et d’un consensus entre les scientifiques.
Cette expression est proche de celle de « valeurs cognitives » ou « non-cognitives » que l’on peut retrouver dans des textes d’épistémologie féministes (e.g., Elizabeth Anderson, « Feminist Epistemology and Philosophy of Science », The Stanford Encyclopedia of Philosophy,Spring 2020 Edition, Edward N. Zalta ed.). Traditionnellement, les valeurs cognitives sont par exemple la simplicité, la précision, la cohérence interne : elles concernent le processus de production de savoir et rendent une théorie connaissable. Par opposition, les valeurs morales, sociales, politiques, sont non-cognitives.
3 L’anisogamie est la différence de taille entre le gros gamète femelle et le petit gamète mâle. Quant aux dimorphismes sexuels, ce sont toutes les différences morphologiques qui accompagne cette disproportion galénique ; ils concernent les caractères sexuels primaires (les organes reproducteurs) et secondaires (comme la taille des individus ou de leurs organes, la pilosité, les ornements …).
4 Une distinction entre deux catégories : en l’occurrence, entre la reproduction (dépendant des organes reproducteurs) et le plaisir (lié aux organes sexuels).