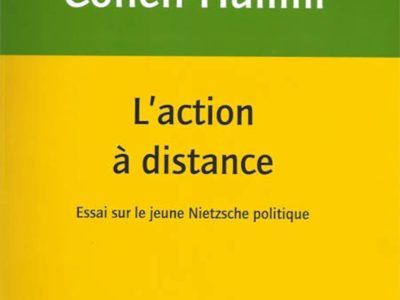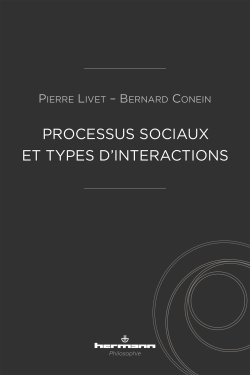Comment et pourquoi faire confiance aux institutions ? 1/2
Lecture croisée de Niklas Luhmann et Frederick Neuhouser
Marc Goetzmann Doctorant Contractuel Chargé d’Enseignements, Centre de Recherches en Histoire des Idées. Université de Nice Sophia Antipolis.
Cet article a pour objectif de proposer une simple lecture croisée des écrits de Niklas Luhmann et de Frederick Neuhouser en se focalisant sur la question de la confiance dans les institutions. Il s’agira d’une part de rappeler que l’œuvre de Luhmann souligne la nécessité, pour les institutions de la modernité, de prendre en compte à un certain degré les raisons subjectives pour lesquelles les individus leur font confiance, bien qu’elle place cette perspective subjective sur un plan secondaire, pour des raisons de cohérence théorique. On utilisera donc la lecture que Frederick Neuhouser propose de la place de la confiance dans les Principes de la philosophie du droit de Hegel, afin d’initier une réflexion sur les critères subjectifs et objectifs qui peuvent renforcer la confiance des individus dans leurs institutions.
This article aims at comparing Niklas Luhmann and Frederick Neuhouser’s writings, focusing on their thoughts about trust in institutions. First, the reader’s attention will be drawn on the fact that Luhmann’s work, despite a theoretical and methodological approach that puts the perspective of the individual on a secondary level, is a reminder of the necessity for institutions to take the reasons why individual trust them into account, to a minimal extent. Second, Frederick Neuhouser’s work will be used to put forward some of the objective and subjective criteria that strenghthen the trust individuals grant to their institutions.
Mots-clefs/Keywords Luhmann, Neuhouser, Hegel, confiance, institutions, trust
Introduction
Il est par trop évident que l’existence de l’ordre social ne dépend pas des quelques personnes que l’on peut connaître et à qui on peut faire confiance. Il doit exister d’autres formes de créations de la confiance qui ne dépendent pas de ce qui est personnel[1].
Ces propos de Niklas Luhmann invitent à dépersonnaliser la confiance dans le cadre des institutions sociales. En effet, comme le note Luhmann, comprendre la confiance dans les institutions à l’aune du sentiment de confiance que nous inspirent des individus isolés semble être le fruit d’une analogie fautive. Le livre de Luhmann La confiance, un mécanisme de réduction de la complexité sociale, est une double invitation à comprendre le rôle essentiel que joue la confiance dans les institutions ou les « systèmes sociaux », et à saisir la différence essentielle qui sépare la confiance « systémique » de la confiance qu’un individu accorde à un autre dans une relation personnelle, que l’on peut nommer confiance interindividuelle. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de demander « pourquoi » nous faisons, en tant qu’individus, confiance aux institutions, mais d’abord « comment ». En effet, poser la question de la raison de notre confiance aux institutions semble presque incongru dans les sociétés modernes qui, telles que les décrit Luhmann, tirent l’essentiel de leur substance de cette confiance. Poser la question du « pourquoi » de la confiance risquerait de nos placer à l’extérieur de ces institutions.
La pensée de Luhmann, ainsi que la lecture que Frederick Neuhouser[2] propose de Hegel dans Foundations of Hegel’s Social Theory, Actualizing Freedom[3], situent donc la confiance dans un cadre principalement fonctionnaliste où elle est une donnée déjà établie, une caractéristique essentielle des sociétés modernes. La confiance possède une fonction, inhérente à des institutions qui nous précèdent en tant qu’individus. Il s’agit donc de comprendre comment la confiance opère. Cela n’implique cependant pas d’écarter la question du pourquoi. En effet, en se focalisant sur la question de la fonction des différentes formes de confiance, Luhmann semble écarter la question du manque de confiance, à ne pas confondre avec la méfiance. Luhmann n’interroge pas les différents degrés de confiance dans les institutions, et les raisons de telles variations. Il semblerait que cela soit la conséquence de ses propres postulats méthodologiques, qui privilégient le macroscopique, la structure, au microscopique, l’individu. Neuhouser nous invite alors, une fois avoir compris les fonctions de la confiance au sein du social, à reprendre la question du « pourquoi », en pensant l’articulation entre celui qui accorde sa confiance, et l’institution qui entend la mériter.
C’est pourquoi nous essayerons de montrer que, malgré leurs postures méthodologiques différentes, les perspectives de Luhmann et de Neuhouser peuvent apporter des éclairages complémentaires sur la question de la confiance dans les institutions. Une lecture croisée de ces deux auteurs semble être justifiée premièrement par des positions divergentes mais non exclusives sur un thème commun, la confiance, et deuxièmement par l’omniprésence de Hegel dans leur réflexion. Nous tâcherons donc de voir comment ils permettent, ensemble, d’esquisser quelques pistes pour répondre à la question : comment et pourquoi faire confiance aux institutions ?
Pour ce faire, une première partie de l’article s’attachera à caractériser précisément la nature de la confiance telle que Luhmann la conçoit. Nous y montrerons qu’une tension habite la démarche de Luhmann : bien que ses postulats le conduisent à écarter la question des motivations strictement individuelles à accorder sa confiance à une institution, Luhmann ouvre cependant une réflexion sur la nécessité pour les systèmes sociaux de la modernité d’être réflexifs, et donc à prendre en compte dans une certaine mesure la confiance que les individus accordent à leurs institutions. Dans une deuxième partie, nous verrons comment la lecture que Neuhouser propose de Hegel permet d’explorer davantage cette question de l’articulation entre d’un côté l’élément individuel de la confiance dans les institutions, et sa dimension supra-individuelle d’un autre côté, en proposant des critères objectifs (concernant les institutions) autant que subjectifs (concernant le vécu individuel) qui favorisent la confiance dans les institutions.
Première partie : la subordination de la confiance « personnelle » à la confiance « systémique » chez Luhmann
1. La confiance et la théorie des systèmes de Luhmann
Comme l’indique le titre de l’ouvrage de Luhmann, la confiance est une réponse à un problème déterminé, celui de la « complexité sociale ». Luhmann décrit en effet la société comme un grand système qui développe une « vie » autonome par rapport à son environnement, le monde. Or « le monde n’est pas un système, puisqu’il n’a aucune frontière »[4], il est caractérisé par une infinité de possibilités absolument contingentes. Le premier système émerge sous la forme de ce que Luhmann appelle des « communications », c’est-à-dire une première sélection contingente face à la complexité. Le système se développe ensuite à partir de cette première communication. La contingence radicale, désignée dans cet ouvrage sous le nom de « complexité », est donc réduite et intégrée au système que représente la société. Cependant, ce processus n’isole pas complètement un système de son environnement. Il traite sélectivement les éléments qui surgissent dans l’environnement selon les cadres fixés par le système, afin de rendre l’action possible[5].
Dans le cadre du système « société », faire confiance aux autres hommes rend en effet possible à chacun de ne pas avoir à envisager une infinité de comportements possibles[6]. À cause de son individualité irréductible, l’autre doit être limité à un certain nombre de comportements prévisibles, et cette forme de confiance dans la permanence de l’identité de l’autre s’accroît à mesure que notre expérience de lui augmente. Il ne faut cependant pas imaginer que la seule fin de la confiance réside dans une réduction simple et absolue de la complexité. Au contraire, la réduction d’une première forme de complexité permet de « développer des formes plus efficaces de la complexité », dont la constitution d’un groupe social est le meilleur exemple. Accepter de coopérer dans la confiance avec un groupe d’individus, c’est s’épargner la complexité qu’une méfiance constante produit et permettre ensuite de mener, ensemble, des actions plus complexes. La réduction de la complexité permet donc de rendre davantage de possibilités réalisables[7]. La prévisibilité et la stabilité que fournit le système dans le temps permet en effet aux membres d’adopter une forme de « rationalité plus complexe »[8], et donc de participer à des formes de coopération qui ne sont pas immédiatement profitables, valorisant ainsi leur intérêt à long terme.
Il faut noter que Luhmann distingue la confiance de la « familiarité » en s’appuyant sur ce rapport spécifique au temps. Alors que la familiarité s’appuie sur une complexité déjà réduite par le passé, la confiance est une forme de pari sur l’avenir, qu’elle se risque à déterminer[9]. Ces deux moyens de réduire la complexité sont complémentaires mais entretiennent des rapports variables. À mesure que l’ordre social devient plus complexe, la familiarité diminue et le besoin de confiance augmente, car le « besoin de déterminer l’avenir » ne peut plus être suffisamment satisfait par la familiarité[10]. D’où le fait que la confiance soit essentielle à l’activité des sociétés élargies.
Faire confiance est, rappelons-le, un outil qui permet à un système de remplir une fonction : la réduction de la complexité. C’est uniquement dans ce cadre que Luhmann envisage de considérer la rationalité de la confiance. Elle n’est ni une évaluation objective des risques, ni un moyen rationnel de parvenir à ses fins, et encore moins un simple « espoir ». Elle n’a pas non plus à voir avec les questions de « principes » éthiques, puisque de tels principes ne sont pas à même d’absorber la complexité du monde social[11]. La confiance n’est surtout pas un calcul rationnel, dans le sens où on ne fait pas confiance parce que les risques sont plus faibles que les bénéfices éventuels. Au contraire, « le dommage lié au bris de confiance » est toujours potentiellement plus grand que « l’avantage à retirer du respect de la confiance »[12]. Ainsi, à l’opposé d’un calcul, la confiance accordée se transforme « graduellement » en « attentes de continuité » qui deviennent le fondement de la « vie quotidienne » et ce « sans faire l’objet d’une réflexion ». Ces constats tiennent à la nature particulière de la confiance au sein de la théorie des systèmes de Luhmann. Selon Luhmann, la confiance nécessite un système, soit un système psychique, l’individu, soit un système plus étendu. Tout système conçoit une forme de représentation extrêmement simplifiée du monde réel qu’il internalise et qui lui permet de répondre au moyen de « processus internes » aux stimulations externes de ce monde réel. Dans le cas particulier de la confiance, il s’agit pour le système de substituer la « certitude interne », celle fournie par la stabilité du système, à la « certitude externe », ce qui signifie que la confiance ne cherche pas absolument à établir une certitude externe quant à la probabilité des événements, d’où l’absence de calcul rationnel.
Puisqu’il faut faire confiance, sans quoi ne seraient possibles que des formes « très simples » de « coopération humaine »[13], le système sera organisé de telle façon qu’un défaut de la part de l’objet de confiance ne portera atteinte qu’à une partie limitée du système. Par exemple : nous n’avons pas besoin de faire confiance à chaque homme ou femme politique pour laisser cependant à la classe politique la charge de nous gouverner. Faire confiance n’implique donc pas l’évaluation d’un risque, n’exige aucune certitude, et ne requiert pas des « gages » de la bonne volonté d’un tiers. On fera donc confiance par nécessité. On comprend alors comment la confiance devient chez Luhmann le tissu même dont est fait lien social.
2. Confiance systémique et confiance « personnelle » s’excluent-elles ?
Ce que nous venons d’exposer semble séparer irrémédiablement la confiance « systémique », nécessaire au fonctionnement du groupe social, de la confiance que nous accordons subjectivement à un individu qui nous inspire ce « sentiment ». Or, Luhmann propose aussi une redéfinition de la confiance dite « personnelle ». En effet, lorsque Luhmann parle de confiance « personnelle », cela n’implique pas qu’il s’agisse d’un sentiment personnel qu’un individu ou un « sujet » libre ressentirait envers un autre individu. La théorie des systèmes n’admet pas un individu transcendant, au sens d’un sujet libre et souverain. Si les hommes conservent un statut dans l’œuvre de Luhmann, ce n’est qu’en étant réduits à l’état de systèmes qui fonctionnent de façon similaire aux systèmes sociaux. Entre eux, les hommes projettent les uns sur les autres des attentes et la confiance qu’ils se portent consiste précisément dans l’attente que les autres feront usage de leur liberté, ce « potentiel inquiétant », en respectant la « personnalité » et les schémas prévisibles déjà manifestés. Par conséquent, « est digne de confiance celui qui est fidèle à ce qu’il a communiqué sur lui-même ». Si une liberté « métaphysique » radicale semble exister sous la forme d’une contingence radicale au stade présocial, il s’agit d’une forme indéterminée de liberté qui ne permet pas d’attribuer aux agents leurs actions. Elle est donc exclue de la pensée de Luhmann. La seule liberté que conçoit Luhmann est seulement une extension de la complexité, permise par la confiance[14].
Ainsi, le premier degré de confiance, la confiance « personnelle », est un outil nécessaire à la réduction de l’incertitude face aux actions des autres. Il est alors important de comprendre que cette forme de confiance est le fruit d’un « processus d’apprentissage » progressif[15]. La famille peut être selon Luhmann le premier lieu de cet apprentissage, car la complexité y est particulièrement réduite, notamment grâce aux « manifestations particulières » de confiance de la part des autres membres de la famille[16]. Ce premier degré de familiarité doit cependant être étendu à d’autres individus. L’élargissement de la confiance ne peut cependant pas simplement consister en une généralisation à partir d’expériences répétées. Il est nécessaire de médiatiser cette accumulation d’expérience par la distinction progressive entre « Je » et « Tu ». En effet, comme nous avons déjà pu le constater, les individus doivent, pour se faire confiance, se considérer mutuellement comme des « complexes symboliques » relativement prévisibles[17].
Parallèlement, il est nécessaire d’apprendre à se considérer soi-même comme responsable de ses actes et prévisible pour apprendre à percevoir ainsi les autres et à leur faire confiance. Il faut donc apprendre à se considérer digne de confiance pour considérer que de nouveaux individus, au-delà du cercle familial immédiat, puissent être dignes de confiance. Pour faire confiance, il est ainsi nécessaire de faire de soi-même un « système » interagissant avec d’autres systèmes, et d’acquérir alors progressivement une forme de disposition à faire confiance[18]. Cela signifie-t-il pour autant que cette forme de confiance « personnelle » est le fruit d’un sentiment individuel et subjectif ? Non, car il s’agit avant tout d’un échange communicatif entre des systèmes psychiques et parce que les conditions de cette confiance sont déjà socialement déterminées. Surtout, la confiance est une nécessité et non le résultat d’une évaluation ou d’un sentiment personnel. En effet, il faut distinguer la confiance personnelle d’un autre mécanisme de réduction de la complexité : celui où nous une relation sentimentale avec un autre être humain, voire des objets. Cette forme de réduction est radicale en ce qu’elle fige en les limitant les possibilités de l’objet du sentiment. La confiance, nécessaire dans les ordres sociaux complexes, s’adresse à des systèmes « pour lesquels on ne peut éprouver aucun sentiment »[19].
Par conséquent, la confiance n’est pas une attitude objective car, comme nous l’avons expliqué, elle n’est pas rationnelle au sens de l’évaluation d’un risque fondée sur des preuves extérieures objectives. Elle n’est pas non plus une attitude subjective, quand bien même elle serait personnelle, car il ne s’agit pas d’un sentiment que l’on accorde à un individu pour ses mérites personnels ou au gré de ses propres envies. Dans un ordre social complexe, la confiance personnelle fait ainsi fond sur une confiance préétablie dans la stabilité de systèmes supra-individuels : la confiance systémique[20]. En effet, la confiance n’est pas accordée à un individu par un autre individu, mais plutôt à un système psychique par un autre système psychique, et ce en respectant les règles instituées au sein d’un système social. On ne confondra donc pas le sentiment de confiance que nous inspire un ami avec la confiance que nous accordons par exemple sans y penser à un voisin dans notre immeuble.
Néanmoins, même si la confiance personnelle s’établit sur fond de la confiance systémique, la première n’est pas à confondre avec la seconde. Cette dernière confiance d’un genre nouveau s’appuie sur un degré d’aveuglement supérieur, mais ne se limite pas à la confiance envers les systèmes sociaux, et s’applique aussi aux hommes, « systèmes personnels »[21]. Ainsi, là où la confiance systémique existe, il n’est pas forcément nécessaire de s’informer sur le comportement d’autrui pour lui accorder notre confiance, car il suffit d’être au fait des « caractéristiques structurelles du système social » dans lequel on vit pour accorder sa confiance malgré un « manque d’information ». Nous n’avons pas d’informations qui nous poussent à accorder notre confiance à un commerçant, mais le simple fait qu’il exerce cette activité et qu’il est d’usage de lui faire confiance au sein d’un système donné suffit. La confiance personnelle n’est cependant pas entièrement effacée dans un ordre social complexe. Elle n’apparaît plus que « là où on en a besoin », c’est-à-dire dans des contextes très particuliers, hors des « relations de rôles qui ne présentent aucun risque »[22]. Un exemple pris par Luhmann est celui du système monétaire. En effet, lorsque l’on accepte la monnaie que l’on nous donne pour payer, c’est que l’on fait confiance à ce système monétaire plutôt que directement à la personne qui nous tend la monnaie[23]. Le système prend donc le pas sur l’individu, ou plutôt sur le « système psychique », au bout d’un processus continu[24]. Pour reprendre un exemple précédent : si nous avons personnellement confiance dans un voisin d’immeuble, c’est parce qu’il est systémiquement établi que nous pouvons faire confiance à nos voisins. La confiance personnelle que nous accordons à notre voisin est donc distincte de la confiance « sentimentale » que nous ressentons pour un ami, et se fonde sur l’existence d’un système dans lequel on peut avoir confiance.
Il est important de noter que la confiance personnelle est plus sensible aux variations et aux possibles trahisons que la confiance systémique, notamment parce qu’elle suppose un « apprentissage » personnel. Or, un tel apprentissage est rendu plus difficile dans le cas de la confiance systémique et les contrôles de confiance deviennent presque impossibles. Cela pose nécessairement la question du traitement par le système des critiques et des revendications soulevées par les individus, notamment dans une société à caractère démocratique.
3. Confiance et réflexivité : la « confiance dans la confiance »
Dans les sociétés les plus complexes, les contrôles du système sont principalement confiés à des experts et non pas aux individus eux-mêmes. Ainsi, le contrôle du système devient une partie du système lui-même, puisque l’expert doit posséder un savoir avancé du système pour remplir son rôle de contrôleur. Luhmann pose donc une question centrale à notre propos : « comment l’individu doit-il se comprendre lui-même dans l’obligation où il se trouve d’accorder sa confiance sans pouvoir contrôler la confiance elle-même ni la produire ? »[25]. En effet, tout individu qui naît dans une société donnée intègre les formes de confiance préétablies et s’y soumet sans condition. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Luhmann, en suivant une longue tradition, s’oppose à la théorie du contrat social. Qui plus est, a fortiori dans les sociétés les plus complexes, les individus isolés n’ont aucun contrôle sur leur système, alors qu’ils sont en mesure de retirer leur confiance personnelle à d’autres individus.
Luhmann propose une forme de réponse à cette question, qui permet d’envisager la confiance systémique dans les sociétés modernes autrement que comme une mise à l’écart pure et simple de l’individu. La réponse de Luhmann s’appuie sur une distinction entre la confiance systémique et la familiarité. La première a repris des aspects de la seconde. En effet, il s’agit d’une confiance presque naturelle au sein du corps social, que l’on ne questionne pas. Cependant, là où la familiarité s’appuyait justement sur une forme de cohésion « naturelle », la confiance systémique se fonde sur des « processus explicites » de réduction de la complexité. En effet, la confiance systémique manifeste malgré tout l’idée que les « opérations » de réduction de la complexité sont « produites ». Cette conscience a lieu au niveau du système mais aussi au niveau individuel. En effet, les individus sont conscients du fait que les institutions dans lesquels ils placent une confiance aveugle n’ont rien de nécessaire mais sont au contraire des productions contingentes[26]. Or, avoir conscience de la contingence signifie avoir conscience de la possibilité pour des institutions d’être autres qu’elles ne sont, et donc éventuellement d’exiger qu’elles changent.
Ce constat conduit finalement Luhmann à s’intéresser aux systèmes tels qu’ils « veulent ou doivent mériter » la confiance. En effet, si la contingence est perçue comme telle dans les systèmes sociaux complexes, il faut s’interroger sur la façon dont la confiance peut être obtenue malgré tout, et donnée par les individus. Les systèmes, notamment contemporains, sont conscients que leur adaptation à un environnement changeant peut être un problème et qu’une certaine adaptabilité est nécessaire pour maintenir le lien de confiance, quoique systémique. La réflexivité devient donc un critère pour ne pas décevoir la confiance que les individus placent dans un système social. Leurs attentes sont en effet conditionnées à la prise en compte de la mobilité de l’environnement. Par conséquent, « à mesure que cette réflexivité devient conscience, la confiance personnelle devient une variante de la confiance systémique »[27]. Cela signifie donc que Luhmann reconnaît une certaine prise en compte de la confiance personnelle dans le fonctionnement des systèmes sociaux, malgré le caractère supra-individuel de la confiance systémique. Bien que la confiance systémique précède et dépasse les individus, et que la confiance personnelle accordée par les individus ne soit en rien une condition sine qua non de la légitimité d’une institution, elle joue un rôle dans le maintien de la confiance systémique. L’argumentation de Luhmann est ainsi particulièrement subtile : la confiance personnelle n’est pas constitutive des systèmes sociaux, qui ne doivent leur existence qu’à la confiance systémique. Cependant, la confiance systémique doit son maintien à une certaine prise en compte de la confiance personnelle, et cette sensibilité passe par une « prise de position modifiable à l’égard des attentes d’autrui »[28]. Sensibilité à la confiance personnelle et réflexivité face à un environnement mobile apparaissent donc comme deux conditions favorables au maintien de la confiance systémique dans les sociétés contemporaines.
La réflexivité particulière aux systèmes sociaux contemporains implique par conséquent d’entretenir une forme réflexive de confiance. L’école devient par exemple une institution favorisant l’apprentissage de la confiance dans le système social. Cet apprentissage n’incombe plus uniquement à l’individu seul, puisque le système lui-même cultive la disposition à lui faire confiance[29]. On assiste donc à l’intégration réflexive de la confiance au sein de mécanismes favorisant la création de la confiance. Ces exemples permettent néanmoins d’éviter de tirer des conclusions trop hâtives de nos précédents développements sur la prise en compte de la confiance personnelle pour le maintien de la confiance systémique. Luhmann, il faut le répéter, n’affirme en aucun cas que le système social devrait en quelque sorte « écouter » les individus pour susciter leur confiance. La réflexivité des systèmes sociaux modernes revient au contraire à renforcer la confiance systémique en cultivant la disposition des individus à faire confiance au système, en développant ce que Luhmann appelle la « confiance dans la confiance ». Cette forme de confiance réflexive, propre aux systèmes sociaux complexes, est à distinguer de la confiance personnelle sous sa forme la plus simple. En effet, bien que la base de cette « confiance de la confiance » s’appuie sur la confiance personnelle, elle désigne différents types de confiance, comme la confiance dans notre propre confiance, la confiance dans le fait que des individus peuvent nous faire confiance et aussi la confiance dans le fait que d’autres individus auront confiance, comme nous, en un tiers, dernière forme de confiance particulièrement pertinente dans le cas de l’association politique[30].
Alors que la confiance personnelle « simple » n’est réflexive qu’exceptionnellement, la confiance systémique se « construit » sur cette idée d’une confiance réflexive. Ainsi, la « capacité fonctionnelle repose sur la confiance dans la confiance », et notre rapport de confiance à différents systèmes, ou plutôt de confiance dans le fait que les autres auront aussi confiance, devient un véritable « comportement ». De manière presque paradoxale, la réflexivité introduite par les systèmes sociaux leur fait prendre conscience de la nécessité de cultiver chez leurs membres une disposition qui va précisément rendre « latents » la « réflexivité de ce mécanisme » et « le risque qu’il comporte »[31]. Il n’y a donc rien de commun entre cette conception du rôle de la confiance et une forme de confiance réciproque, pleinement délibérée et consciente, telle qu’elle pourrait exister dans une fiction du contrat social. Il existe uniquement une forme de « confiance dans la confiance des autres », qui joue le rôle de « base rationnelle » de la confiance systémique. En d’autres termes, Luhmann propose un cheminement inverse à celui qui est commun à de nombreuses théories contractuelles : là où ces dernières se proposent d’expliquer, en partant du bas vers le haut, comment la confiance interindividuelle fonde la légitimité et donc la confiance que méritent les institutions, la théorie de Luhmann agit en renversant cette perspective : la confiance systémique préexiste à la confiance personnelle et interindividuelle, et se trouve renforcée par des sous-systèmes qui encouragent la confiance dans le fait que les autres que soi-même maintiendront aussi leur confiance dans le système. Ces réflexions de Luhmann ouvrent cependant un champ important que la lecture que Frederick Neuhouser propose de Hegel permettra d’explorer davantage : celui de la question de la sensibilité des institutions modernes aux motivations des individus pour leur faire confiance.
[1] Niklas Luhmann, La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale, trad. de l’allemand par S. Bouchard, Paris, Economica, coll. Études sociologiques, 2006, p. 53.
[2] Frederick Neuhouser, professeur à l’université de Columbia, est spécialisé en philosophie allemande du XIXe siècle. Il s’intéresse notamment à Rousseau, Fichte et propose, ce qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de cet article, une lecture de Hegel inspirée de celle d’Axel Honneth.
[3] Frederick Neuhouser, Foundations of Hegel’s Social Theory, Actualizing Freedom, Harvard University Press, 2000.
[4] Luhmann, op. cit., p. 3.
[5] Ibid., p. 5 et 9.
[6] Selon Luhman, la contingence est radicale avant toute réduction. C’est pourquoi il affirme que les possibilités sont infinies tant que la première réduction n’a pas eu lieu.
[7] Luhmann, op. cit., p. 7.
[8] Ibid., p. 25.
[9] Ibid., p. 21-22.
[10] Ibid., p. 23.
[11] Ibid., p. 101-105.
[12] Luhmann, op. cit., p. 25.
[13] Ibid., p. 104.
[14] Luhmann, op. cit., p. 43.
[15] Ibid., p. 30.
[16] Ibid., p. 31.
[17] Ibid., p. 32.
[18] Ibid., p. 31.
[19] Luhmann, op. cit., p. 96.
[20] Ibid., p. 22.
[21] Ibid., p. 24.
[22] Ibid., p. 52.
[23] Luhmann, op. cit., p. 58.
[24] Ibid., p. 42.
[25] Ibid., p. 69. Nous mettons en valeur le propos de Luhmann.
[26] Luhmann, op. cit., p. 70.
[27] Ibid., p. 72. Nous mettons nous-mêmes en valeur le terme.
[28] Ibid., p. 73.
[29] Luhmann, op. cit., p. 78.
[30] Ibid., p. 81-82.
[31] Ibid., p. 82.