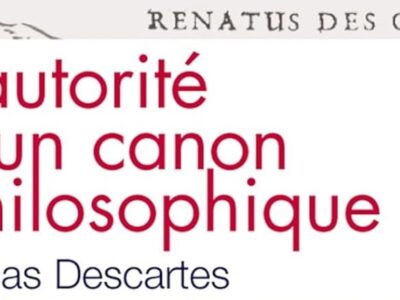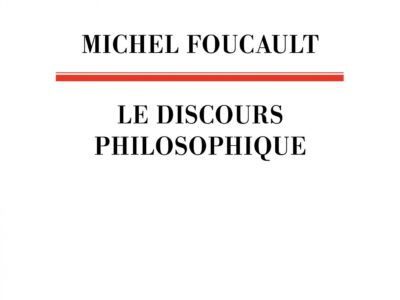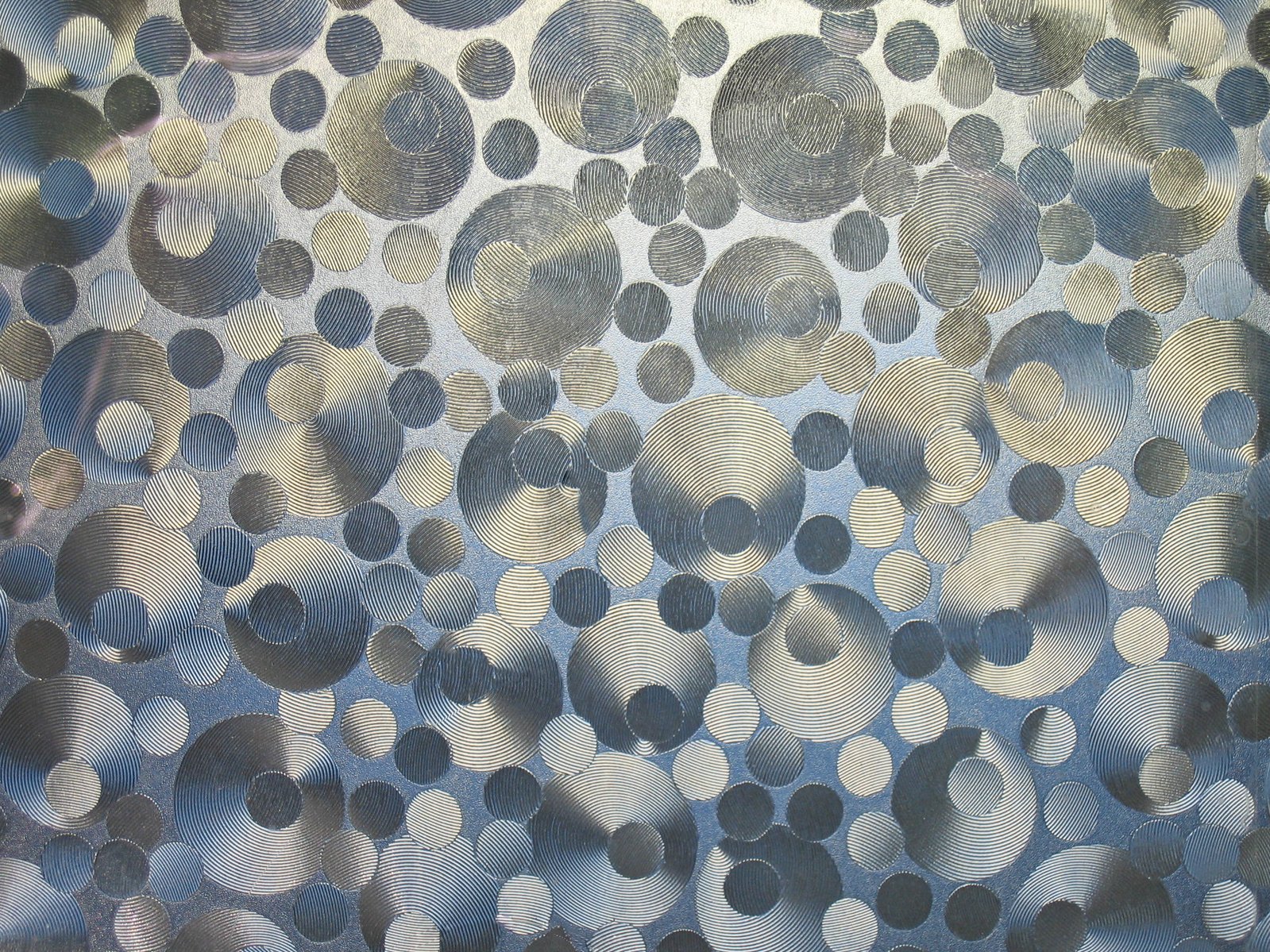Tout peut-il être objet d’addiction ?
Les addictions comportementales face à la notion de plaisir
Mélanie Trouessin, ENS de Lyon.
Le phénomène des addictions comportementales nous a encouragé à réviser la conception médicale de l’addiction en mettant au premier plan l’idée d’une dépendance psychique, liée à la compulsion. La relation entre l’addiction et le plaisir devient intrinsèque : c’est parce qu’un comportement ou une substance procure une expérience qui donne du plaisir que l’individu cherche par la suite à reproduire cette expérience. Alors, tout ce qui procure du plaisir n’est-il pas potentiellement addictif ? Platon, dans le Philèbe, distingue des plaisirs illimités par nature car mesurables et des plaisirs non susceptibles de mesure et d’illimité : les premiers sont liés, ‘mélangés’ à la douleur, tandis que les derniers sont ‘purs’ de toute relation à la douleur. Nous suggérons que seuls les comportements procurant un plaisir mélangé seraient susceptibles de devenir addictifs.
Abstract : The phenomenon of behavioural addiction has encouraged us to revise the medical concept of addiction by bringing to the fore the idea of psychological dependence, linked to compulsion. The relationship between addiction and pleasure becomes intrinsic: it is because a substance or form of behaviour is pleasurable to the person concerned that he or she seeks to repeat the experience. But does it follow that everything which is pleasurable is potentially addictive? In Philebus, Plato distinguishes between pleasures which are “unlimited” by nature because they are measurable and pleasures which are not capable of being measured or of being unlimited : the former are linked to pain or “mixed” whereas the latter are “pure” namely free from any association with pain. We suggest that it is only only those forms of behaviour that bring mixed pleasure that are capable of becoming addictive.
Introduction
Cela fait à peine deux siècles que les addictions ne sont plus exclusivement pensées à l’intérieur d’un cadre moral axé sur l’idée d’une responsabilité individuelle et d’une faiblesse de l’individu face aux désirs. C’est depuis le XXème siècle surtout que l’addiction est envisagée comme une maladie : psychiatrique d’abord, puis cérébrale, comme le montre l’émergence au milieu du siècle de la théorie de la dépendance physique. Celle-ci se manifeste par une neuroadaptation à une substance ingérée de manière chronique, c’est-à-dire une tolérance, qui va produire des symptômes de manque en cas de non consommation de la substance. La tolérance et le manque seraient la raison qui pousserait les personnes à consommer toujours plus (Jellinek, 1960). Les théories suivantes de l’apprentissage et du renforcement viennent compléter cette première conception neuroscientifique. Toutefois, le fait fondamental reste le même : ce qui est central, c’est l’ingestion d’une substance psychoactive (alcool, drogues, tabac). Les addictions considérées sont uniquement des addictions avec produits, dites addictions chimiques.
La conception médicale de l’addiction est alors fortement ébranlée lorsque l’on prend conscience que certaines conduites possèdent des similarités très fortes avec les addictions, à la différence près qu’elles ne se caractérisent pas par l’ingestion d’une substance psychoactive. La prise en compte à l’intérieur du champ des addictions de ces bien nommées « addictions » ou « toxicomanies sans drogue » (Fenichel, 1953) semble rendre impossible une définition des addictions à partir du seul critère de la dépendance physique. Plusieurs réactions adviennent alors : soit trouver dans les addictions comportementales la même réaction chimique qui provoquerait la dépendance physique dans les addictions chimiques; soit refuser aux addictions comportementales le statut d’addiction « réelle » et continuer à assurer aux addictions classiques le statut de maladie biologique ; soit, enfin, reconnaître que la dépendance physique ne constitue peut-être pas le cœur de la définition de l’addiction.
Cette dernière réaction s’est largement imposée et a réorienté la définition intrinsèque de l’addiction vers une autre forme de dépendance, psychique, et vers ce que l’on appelle la compulsion, ou le désir irrépressible d’effectuer un comportement, que celui-ci soit lié ou non à une substance psychoactive. La dépendance physique devient alors une caractéristique possible de l’addiction, mais qui n’est plus ni suffisante ni nécessaire.
Un des premiers comportements à être considéré comme une addiction comportementale est l’addiction aux jeux de hasard et d’argent. Sont venues ensuite l’addiction aux achats, au travail, à l’activité sportive, les troubles alimentaires et la cyberdépendance, selon la liste d’Isabelle Varescon (2009). Cette liste peut varier, diminuer ou s’allonger : il est par exemple courant d’y ajouter l’addiction à l’activité sexuelle, et on entend même parfois parler aujourd’hui d’addiction à la musique, au bronzage ou encore à la lecture. Mais cette liste peut-elle s’allonger encore et encore ? Peut-on être addict aux balades dans la forêt ou au fait de jouer au scrabble ? Ou y a-t-il une limite aux comportements qui pourraient devenir addictifs ?
A cette question de savoir si tous les comportements peuvent devenir addictifs, deux réponses extrêmes peuvent être données : une position restrictive comme celle de Nora Volkow, qui n’admet pas les addictions comportementales ; une position extensive comme celle de Stanton Peele qui ne semble pas admettre de limite a priori à ce qui peut être considéré comme une addiction. Entre les deux, la plupart des théories tranchent au cas par cas. Il est alors fréquent de proposer que le critère qui délimiterait les comportements addictifs serait le plaisir. Il y aurait un lien quasi systématique entre la notion d’addiction et celle de plaisir: un lien qui avait un peu été gommé par les premières conceptions de l’addiction comme maladie, mais qui semble renaître avec l’émergence des addictions sans produit. A tel point qu’il est aujourd’hui courant de soutenir – comme le fait par exemple le psychanalyste Michael Stora – une position selon laquelle « tout objet de plaisir peut devenir une addiction ». Si comme il le propose, tout ce qui produit du plaisir peut effectivement mener à une addiction, alors certes certains comportements seraient bien exclus d’emblée, mais cela signifierait aussi que la liste des addictions n’aurait en principe pour seules limites que celles du plaisir, aussi subjectives soient-elles.
Une nouvelle question émerge alors : tout comportement qui procure du plaisir peut-il réellement conduire à une addiction ? Si c’est le cas, le risque est de voir la notion d’addiction devenir triviale ou banale, ce qui pourrait mener à des implications opposées mais chacune tout aussi délicate : normalisation des conduites addictives, sous-estimation des risques voire retour à une conception morale ou au contraire surmédicalisation. Mais prendre ces implications comme point de départ pourrait produire un biais, une confusion entre le niveau descriptif de la recherche s’intéressant à la nature de l’addiction et celui, normatif, de l’évaluation de ce qui est bon.
Il nous semble qu’un point de départ pertinent pour tenter de répondre à cette question est le terrain philosophique et, sur celui-ci, la réflexion sur la notion de plaisir. Nous nous situons dans une démarche d’analyse conceptuelle, dans laquelle il s’agit de s’attacher à une question précise – ici, est-ce que tout peut devenir addictif ? – ainsi qu’à un ou des concept(s) spécifiques qui pourraient nous permettre de progresser dans la résolution de cette question particulière – ici celui de plaisir.
Le concept de plaisir tel qu’il est utilisé dans les travaux sur l’addiction, possède une connotation philosophique précise, même si celle-ci n’est que très peu souvent mise à jour : un comportement addictif est vu comme quelque chose qui procure un plaisir qui, au bout d’un certain temps, devient nécessaire. Autrement dit, le désir qui mène au plaisir devient de plus en plus vif, conduisant au manque et à l’insatisfaction perpétuels. Certains chercheurs vont dans ce sens en suggérant que, dans l’addiction, la frontière se brouille entre ce qui relève du besoin et du nécessaire d’un côté, et du désir et du contingent de l’autre : dans l’addiction, ce qui était désir devient un besoin vital, auquel il n’est plus possible de résister. Pour Michel Reynaud par exemple, le besoin prime sur le désir dans l’addiction, et il s’identifie au manque, synonyme de douleur :
« Du lien hédoniste au trouble addictif, le glissement est parfois difficilement perceptible : la dépendance se définit comme le stade où l’envie est devenue besoin et l’addiction apparaît lorsque la souffrance prend le pas sur le plaisir ».
Il faut cependant remarquer que cet usage du concept de plaisir, affilié à une connotation précise, ne rend pas justice à la multitude de débats qui ont eu lieu depuis l’Antiquité vis-à-vis de ce concept, ni aux tentatives effectuées par certains philosophes pour « sauver » le plaisir d’une dialectique uniquement négative, liée au manque et à la douleur. Utiliser de cette manière la notion de plaisir comme critère de distinction entre ce qui relève de l’addiction potentielle et ce qui n’en relève pas possède, semble-t-il, une implication philosophique essentielle : penser que la totalité de ce qui procure du plaisir peut donner lieu à une addiction revient en effet à postuler la thèse de l’unité du plaisir, c’est-à-dire penser que tous les plaisirs, malgré leur variété apparente, ont une structure et une essence unique, et que c’est en vertu de cette unité qu’ils peuvent mener à l’addiction. Dire que tout ce qui procure du plaisir mène à l’addiction, c’est postuler un lien nécessaire, intrinsèque entre les deux, et donc admettre que c’est dans les mécanismes mêmes du plaisir que l’on peut trouver les mécanismes de l’addiction. Si la majorité des travaux neuroscientifiques soutiennent une hypothèse de ce genre, en observant dans les comportements addictifs des poussées de dopamine et en associant l’addiction au plaisir, parce que la dopamine est « la molécule du plaisir », de nouveaux travaux émergent cependant, qui vont au-delà de la simple thèse dopaminergique de l’addiction. Cela semble aller, il nous semble, vers une interrogation voire une remise en question de cette thèse initiale selon laquelle tout comportement qui procure du plaisir peut mener à l’addiction et, plus encore, nous donner un principe de différenciation non pas empirique mais a priori. C’est cette interrogation que nous souhaitons poursuivre ici, en utilisant le moyen de l’analyse philosophique.
Fidèle en cela à l’esprit de la philosophie analytique, nous voulons tenter ici d’apporter une réponse claire à une question unique, celle de savoir si tout peut devenir addictif. Afin d’étayer la réponse négative que nous apportons à cette question, il s’agit de mettre en place une démarche argumentative construite sur l’analyse du concept de plaisir. Dans cette optique, nous montrons dans la première partie de l’article que la thèse de l’unité du plaisir n’est pas nécessaire, à la lumière de la théorie platonicienne du plaisir. Nous démontrons ensuite que les addictions ne sont pas concernées par toutes les sortes de plaisir, ce qui contredit ainsi la thèse selon laquelle tout peut devenir addictif, à partir du moment où du plaisir est en jeu.
Une analyse philosophique de la notion de plaisir, en particulier chez Platon
La thèse initiale, selon laquelle la totalité des plaisirs auraient une conséquence commune qui serait la possibilité de l’addiction, nous oriente vers la question de l’unité de la notion de plaisir : étant donné l’immense diversité des sources de plaisirs, peut-on mettre au jour une structure unique du plaisir, qui serait la même indépendamment de l’objet ou au contraire la structure du plaisir diffère-t-elle selon chaque objet particulier ?
S’interroger sur l’unité du plaisir n’est pas qu’une question abstraite : c’est voir si derrière le langage il y a bien quelque chose de réel ou non. Questionner l’unité n’est donc en réalité qu’un angle d’attaque pour approcher la question centrale du philosophe à savoir celle de la nature des choses. La recherche d’une structure commune à tout ce qui procure du plaisir a conduit à la thèse selon laquelle le plaisir consisterait dans l’assouvissement d’un manque, constitué par le besoin ou le désir qui se fait ressentir : à la source du plaisir, on trouve en effet la tendance, l’appétit et le plaisir se produit quand le besoin ou désir est satisfait; le plaisir est donc possible parce que nous sommes des êtres fondamentalement dépendants (du milieu, des autres etc). La structure commune serait donc le fait de combler un manque, d’enlever une douleur et c’est cela qui précisément qui constituerait la nature du plaisir. Cette thèse est largement partagée par les philosophes (Kant, Schopenhauer) comme par les psychanalystes (Freud), et trouve son origine chez les philosophes antiques. Pour eux, le seul point de désaccord majeur portait sur la question de savoir s’il fallait admettre, en plus de la souffrance et du plaisir, un troisième état qui serait un état neutre, un état où l’on ne ressentirait ni souffrance ni plaisir.
Si ce schéma semble bien correspondre à l’expérience des plaisirs, la question qui peut se poser est de savoir si tous les plaisirs ne sont ainsi que le négatif de la douleur. Si cela n’était pas le cas, alors cela contredirait la thèse de l’unité du plaisir.
Concilier l’apparente diversité et un schéma unique de fonctionnement du plaisir semble pourtant être le défi que relève Platon dans son dialogue intitulé Le Philèbe. Il s’agit dans un premier temps pour Platon de donner sens à l’idée d’une diversité des plaisirs. Socrate constate d’abord que l’on parle de plaisir au sujet de situations bien différentes :
« Mais pour le plaisir, je sais qu’il est varié, et, puisque, comme je l’ai dit, nous commençons par lui, il faut considérer et rechercher quelle est sa nature. A l’entendre ainsi simplement nommer, c’est une chose unique, mais il est certain qu’il revêt des formes de toute sorte et, à certains égards, dissemblables entre elles. Vois en effet : nous disons bien que l’homme débauché a du plaisir, mais que l’homme tempérant en trouve aussi dans sa tempérance même, que l’insensé aussi, plein d’opinions et d’espérances folles, a du plaisir, et que le sage lui-même en a du fait même de sa sagesse. Or peut-on soutenir que ces deux espèces de plaisirs se ressemblent, sans passer à juste titre pour un extravagant ? » (Philèbe 12 c-d).
Il construit une « gamme des plaisirs » en fonction de la combinaison de deux « variables ». La première variable consiste dans le lieu de naissance des plaisirs : corps, âme ou corps et âme. La deuxième variable est le lien avec la douleur : il existe pour Platon des plaisirs qui sont liés à la douleur, soit dans la succession soit dans l’ambivalence (plaisir et douleur en même temps), ce qui étend déjà la thèse initiale selon laquelle le plaisir serait seulement un comblement du manque puisqu’il peut aussi être coexistant au manque. Ainsi pour Platon, il existe des plaisirs qui n’ont aucun lien avec la douleur, qui n’ont pas pour prémisse un manque. Platon appelle les premiers des plaisirs « mêlés » ou « mélangés », et les seconds des « plaisirs purs ». Les plaisirs purs sont ceux qui ne sont pas constitués par l’illusion agréable d’une douleur qui disparaît. Ils consistent pour Platon dans la vision de belles couleurs, de belles formes, le fait de sentir de bonnes odeurs, d’écouter des sonorités harmonieuses, ou une certaine forme de plaisir de la connaissance et de la compréhension intellectuelle. Il les définit comme des « jouissances dont le manque n’est ni pénible ni sensible, alors que leur présence nous procure des plénitudes senties, plaisantes, pures de toute douleur » (Philèbe, 51b 5-7).
Nous pourrions penser, un peu à la hâte, que les plaisirs mélangés, liés à un schéma de réplétion et de manque, sont uniquement les plaisirs corporels et liés à l’exercice de nos sens tandis que les plaisirs purs correspondraient aux plaisirs intellectuels, or ce n’est pas du tout le cas chez Platon, comme le montre le commentateur Gerd Van Riel. Autant il est vrai de dire que chez Platon aucun plaisir pur n’est strictement corporel, autant l’on ne peut pas dire que les plaisirs strictement intellectuels sont nécessairement purs. Ainsi, certains plaisirs purs sollicitent pour Platon autant l’âme que le corps (les sens) : par exemple le fait de sentir de bonnes odeurs, de voir de belles formes et couleurs et d’entendre de jolis sons. Certains plaisirs uniquement intellectuels ne sont de même pas des plaisirs purs, car ils sont mêlés à la peine : par exemple le fait de se souvenir après un effort.
Face à cette diversité des plaisirs, Socrate conserve toutefois la thèse de l’unité du plaisir en montrant qu’aucun plaisir, pas même pur, ne déroge à un schéma physiologique qui correspond au schéma classique du manque et de la réplétion, selon le modèle initial de la réplétion corporelle, qui est celui-ci :
« SOCRATE : La faim, par exemple, est bien une dissolution (de l’harmonie naturelle) et une douleur ?
PROTARQUE : oui.
SOCRATE : Au contraire, le manger, qui produit la réplétion, est un plaisir ?
PROTARQUE : Oui.
SOCRATE : De même la soif est une destruction et une douleur et, au contraire, l’action de l’humide remplissant ce qui a été desséché est un plaisir. De même la désagrégation et la dissolution contre nature que la chaleur produit en nous, sont une douleur, mais le retour à l’état naturel et le rafraîchissement sont un plaisir ?
PROTARQUE : Certainement » (32a).
Si les plaisirs purs ne semblent pas être précédés d’un tel manque et d’un besoin ou d’un désir, ce ne serait pas parce que le manque est véritablement absent, mais parce qu’il « n’est ni pénible ni sensible » c’est-à-dire pas douloureux, alors que la réplétion, elle, est sensible c’est-à-dire ressentie ; au contraire, dans les plaisirs mélangés, le manque comme la réplétion se font sentir et se font sensibles, selon l’hypothèse de Gerd Van Riel. Si c’est ordinairement pour combler ce manque que nous recherchons les plaisirs, les plaisirs qui viennent assouvir un manque non sensible ne sont donc pas atteints de manière intentionnelle, mais quasiment « au hasard », sans être le fruit d’une recherche pour soulager une douleur, ce qui leur donne leur caractère pur. Les plaisirs purs se distinguent donc des plaisirs mélangés en ce qu’ils n’ont aucun lien sensible avec la douleur.
Un peu plus loin, Socrate dit surtout que les plaisirs mélangés – qu’il assimilera en 52a à des plaisirs violents – sont « démesurés » alors que les plaisirs purs sont « mesurés » signifiant par là que seuls les plaisirs mélangés peuvent entrer dans la classe de l’intempérance (l’absence de maîtrise de soi) :
SOCRATE : « Maintenant que nous avons assez bien distingué et séparé les plaisirs purs et ceux qu’on pourrait, assez justement, appeler impurs, ajoutons à ce discours que les plaisirs violents sont démesurés et que ceux qui n’ont pas de violence sont, au contraire, mesurés, et disons que ceux qui sont grands et forts et qui se font sentir, tantôt souvent, tantôt rarement, se rangent dans la classe de l’infini, qui agit plus ou moins sur le corps et sur l’âme, et que les autres appartiennent à la classe du fini » (Philèbe 52c).
Au contraire, les plaisirs purs sont par nature mesurés, tempérés c’est-à-dire ne peuvent pas mener à un comportement immodéré. « Mesurés » pour Platon signifie que ces plaisirs là sont eux-mêmes la mesure et non qu’ils ont besoin d’être en telle quantité pour être ressentis. Autrement dit, ils ne sont pas susceptibles d’accroissement ou de diminution et donc de démesure et d’illimité, au contraire des plaisirs mélangés, qui sont par nature mesurables et par là peuvent devenir démesurés.
C’est en raison du caractère sensible du lien avec la douleur qu’un plaisir entre dans la classe de ce qui est quantitatif, de ce qui se mesure : l’appartenance à la catégorie de l’illimité ou de l’infini découle directement de ce caractère quantitatif des plaisirs mélangés. A l’inverse, les plaisirs purs, parce qu’ils sont purement qualitatifs, « appartiennent à la classe du fini », de ce qui ne peut devenir illimité.
Or cette notion d’illimité semble permettre d’appréhender ce qui est au cœur de la définition de l’addiction, à savoir la perte de contrôle. L’hypothèse que l’on va proposer est donc la suivante : la distinction entre les plaisirs purs et les plaisirs mélangés permet de repenser la thèse initiale de départ selon laquelle « tout ce qui procure du plaisir peut provoquer une addiction » en la remplaçant par la thèse suivante : « tout ce qui procure du plaisir mélangé peut provoquer une addiction ».
Redéfinition de la thèse initiale : tout ce qui procure un plaisir mélangé peut mener à une addiction
Afin d’établir la validité de cette thèse remaniée, voici ce que nous voulons démontrer : les addictions sont caractérisées par une perte de contrôle, qui est la conséquence du caractère illimité ou infini des plaisirs en jeu ; le caractère quantitatif de ces plaisirs est la condition de possibilité de ce caractère infini. En conséquence, les plaisirs susceptibles de créer une addiction ne peuvent donc être que des plaisirs mélangés, c’est-à-dire des plaisirs qui viennent remplir un manque et à l’occasion desquels ce manque est sensible : ce qui est fondamental dans l’addiction, c’est le fait que les plaisirs concernés aient un lien intrinsèque avec une souffrance.
Reprenons par étape. L’addiction est donc avant tout une situation à l’occasion de laquelle on atteint l’illimité, qui marque l’échec de la tentative de contrôle sur le comportement. Un fort sentiment d’impuissance face aux envies d’effectuer le comportement addictif est constant chez les individus addicts : la perte de contrôle est expliquée par la compulsion ou le désir impétueux, l‘envie irrépressible d’effectuer le comportement en question. S’il n’y a pas de définition unanime de la compulsion, toutes s’accordent cependant sur l’idée qu’elle signale quelque chose d’irrésistible, quelque chose que l’on ne pourrait pas ne pas effectuer. La cinquième et dernière version du DSM rapporte la perte de contrôle à la fois à la « quantité » et au « temps dédié à la prise de substance » (ou à l’activité, faudrait-il rajouter). On peut ainsi concevoir la perte de contrôle dans une dimension temporelle fondamentale dans la mesure où elle est comprise comme une double difficulté : ne pas commencer un comportement (la « perte de la liberté de s’abstenir » selon Fouquet) et le finir. Appliqué au jeu pathologique, cela correspond au fait de ne pas pouvoir résister à l’appel du jeu et au fait de se laisser entraîner à dépenser plus que ce que l’on avait prévu au départ, ne pas pouvoir arrêter le comportement. On sort de la définition de ce que doit être le jeu ‘normal’ selon Huizenga c’est-à-dire une activité « accomplie dans certaines limites fixées de temps et d’argent » : la perte de contrôle a pour conséquence majeure l’absence d’inscription temporelle claire et voulue. Reste que l’illimité est d’emblée une potentialité du plaisir du jeu. Alors qu’il y a des choses pour lesquelles l’expérience de la temporalité n’est pas douloureuse parce que le plaisir peut perdurer au-delà du comportement lui-même, comme lorsque nous apprenons une bonne nouvelle par exemple, nous achevons au contraire à regret certaines activités plaisantes, car la fin de celle-ci marque la fin du plaisir, et c’est le cas des comportements potentiellement addictifs. Trouver de plus en plus difficile de se restreindre, de se sentir rassasié après une quantité « normale », est une constante chez les patients addicts chez qui se joue un véritable combat intérieur pour ne pas dépasser une certaine quantité, pour se restreindre. Pour que l’on puisse parler d’addiction, il faut qu’il y ait conflit entre ce que l’on fait et ce que l’on voudrait faire. Un des critères majeurs de l’addiction dans le DSM-V est ainsi celui du « désir ou des efforts persistants pour diminuer les doses ou l’activité ». L’expérience de l’addiction nous donne l’impression que l’on n’en a jamais assez : on voudrait toujours plus, plus de plaisir. On retrouve ainsi le lien que nous avions identifié entre le caractère illimité et le caractère quantitatif d’un plaisir.
Si le plaisir se produit quand le besoin ou le désir est satisfait, cela signifie qu’il y a un seuil à partir duquel le manque est comblé. La satisfaction d’un manque inscrit d’emblée le plaisir dans la catégorie de ce qui est quantitatif, comme le montre France Farago dans son analyse de la notion de plaisir :
« Nous sommes repus, dans tous les domaines, quand nous avons obtenu notre dose, qui vient combler le vide laissé par nos attentes. Le désir est alors apparenté au besoin, naturel ou artificiel, et le plaisir est la satisfaction d’un besoin. Mais ceci fait alors tendre le plaisir vers la satisfaction quantitative et non pas qualitative, car le besoin ignore la qualité et ne connaît que la quantité ».
Le plaisir que cherche à atteindre l’addict est bien un plaisir quantifiable: ce qui compte, c’est la quantité de plaisir qu’on peut obtenir et qui nous suffira à soulager le manque, c’est d’atteindre un certain seuil de plaisir sachant que ce seuil peut évoluer, augmenter de plus en plus comme cela est manifeste avec le phénomène de tolérance dans l’addiction. S’il existe aussi des plaisirs purs, dont le manque n’est pas sensible et dont la réplétion advient ainsi à l’improviste, ‘en plus’, sans que l’on le recherchait ou l’attendait, alors ceux-ci seraient plutôt de l’ordre de la qualité et non de celui de la quantité. A cet égard, lors d’une consultation en addictologie, j’ai été frappée par les mots d’un patient : il racontait qu’il avait du mal à se restreindre à quatre verres par soir, mais que c’était plus facile quand c’était du bon vin ; qu’il avait alors une sensation de plaisir qui apparaissait plus vite, sensation de plaisir liée à un sentiment de satiété : « la qualité remplace la quantité », déclarait-il au médecin que j’accompagnais alors en consultation. Entendant ces mots, j’avais l’impression que l’on pouvait ainsi identifier face au plaisir procuré par le vin deux rapports fondamentalement différents : l’un, qualitatif, marqué par le fait d’apprécier ce que l’on consomme et l’idée que la qualité du produit en rend une certaine quantité suffisante, voire que, dans ce cas là, il n’est pas question de quantité ; et l’autre, quantitatif, marqué par l’absence d’appréciation et par un caractère insatiable. Là où en temps normal on peut éprouver un apaisement du désir pendant un certain temps, un temps où l’objet même du plaisir peut produire de l’aversion et du dégoût, avec les plaisirs qui peuvent mener à l’addiction se produit ce que Michel Reynaud appelle la « perte de la modulation naturelle » qui se traduit par le fait que « cette période réfractaire n’apparaît pas avec les drogues qui peuvent répéter le plaisir à chaque prise et maintenir indéfiniment la tension du désir ; avec les drogues, l’apaisement, la satiété n’apparaissent pas ».
Le désir de consommer une substance ou d’effectuer un comportement renaît de plus en plus vite, voire ne meurt jamais : le caractère quantitatif du plaisir mélangé rend bien le désir potentiellement infini, insatiable, compulsif.
Si notre raisonnement est correct, alors les plaisirs susceptibles de mener à l’addiction seraient des plaisirs mélangés donc par définition et d’emblée fondamentalement liés à la douleur. Cette idée peut entrer en contradiction avec une thèse courante selon laquelle, au moins chez certaines personnes et dans certains cas, la souffrance et le manque ne sont pas présents d’emblée dans l’addiction. Cette thèse stipule que l’addiction interviendrait seulement à partir du moment où les conséquences négatives dépassent le plaisir et les bénéfices et que l’on ne peut arrêter ce comportement alors qu’on le voudrait. Cette position est résumée ainsi par Michel Reynaud :
«La dépendance se définit comme le stade où l’envie est devenue besoin et l’addiction apparaît lorsque la souffrance prend le pas sur le plaisir ».
Une position alternative consiste à défendre l’idée selon laquelle la souffrance est antécédente au plaisir et à l’addiction. Soit cette thèse vaut pour certaines addictions seulement, ce qui remet dans une certaine mesure en cause l’unité de la notion d’addiction. Soit elle est étendue à toutes les addictions, qui sont alors comprises comme le symptômes de difficultés sous-jacentes, l’addiction pouvant alors être comprise soit comme une forme d’automédication, soit comme une forme particulière de résilience etc. Nous ne pensons pas pour autant que l’addiction doive être considérée dès le départ comme une stratégie consciente et intentionnelle pour remplir telle fonction, pour soulager telle souffrance. Le manque n’est pas forcément ressenti ou très douloureux dès le départ car il pouvait ne même pas être soupçonné. L’addiction est possible à partir du moment où on trouve le plaisir adapté à ce qui nous manque, celui qui colmaterait, de manière insidieuse, la souffrance et les problèmes sous-jacents. Une image fameuse dans l’addictologie est celle de la « lune de miel » lors de la première rencontre avec un produit ou un comportement, comprise comme la production d’effets tellement positifs qu’on reproduirait le comportement pour atteindre de nouveau ces effets. On pourrait relire cette image et l’interpréter comme le fait de trouver, au moment adéquat, le produit ou le comportement adéquat qui remplirait une fonction dans notre vie, que nous pouvions ne même pas être en train de rechercher. C’est, il nous semble, une interprétation possible des mots célèbres de Claude Olievenstein : « La toxicomanie, c’est la rencontre d’un être humain, d’un produit donné, à un moment donné ».
Le plaisir initial peut souvent occulter la fonction essentielle remplie par le produit ou le comportement. On peut supposer que si les personnes ne parviennent pas à quitter un comportement quand elles commencent à le vouloir, c’est-à-dire rentrent dans l’addiction proprement dite, c’est parce que ce comportement remplit un manque fondamental et douloureux dans l’existence de ces personnes, dont elles deviennent alors conscientes.
En définitive, les plaisirs qui mènent à l’addiction semblent bien suivre le même schéma que les plaisirs mélangés tels qu’ils sont présentés par Platon : ce sont des plaisirs qui sont susceptibles d’une extension infinie ou illimitée, en raison de leur caractère quantitatif, ce dernier découlant quant à lui du lien sensible avec la souffrance qui définit la nature des plaisirs mélangés.
Si cette équivalence est vraie, alors cela signifie que seuls les plaisirs purs, qui n’ont pas de lien sensible avec la souffrance, sont susceptibles de ne jamais mener à l’addiction, à savoir les plaisirs suivants pour Platon: le fait de voir de belles formes géométriques, d’entendre de jolis sons, de sentir une bonne odeur, le fait d’accroître sa connaissance et le fait de se souvenir sans effort.
On pourrait donc répondre de façon assurée à la question initiale : « non, tout ce qui est objet de plaisir ne peut pas devenir une addiction ». Tout ce qui est objet d’un plaisir pur en l’occurrence ne le peut pas. On pourrait peut-être penser que cette restriction est en définitive assez faible, puisque beaucoup de comportements semblent encore être concernés ; Platon le remarquait déjà : les plaisirs purs sont assez peu nombreux en comparaison des plaisirs mélangés. Mais ce qui m’intéresse fondamentalement, c’est l’implication que l’on peut en tirer. En effet, soutenir la thèse selon laquelle tout ce qui est objet de plaisir peut potentiellement mener à une addiction implique corrélativement que le plaisir est à la base de l’addiction, une de ses causes si ce n’est la seule. Même si les auteurs qui soutiennent cette thèse sont très loin de tous appeler à un retour à une conception morale, cette réponse semble impliquer que dans la plupart des addictions, ce qui est premier, c’est le plaisir, et que l’addiction survient au moment où le plaisir cesse ou est dominé, supplanté par la souffrance et les « mauvaises conséquences ». Au contraire, dans notre hypothèse, c’est la souffrance qui est première et qui est colmatée par des plaisirs, qui ne sont ressentis pleinement que parce qu’ils viennent combler quelque chose de fondamental qui manquait, dont on pouvait ne pas avoir forcément conscience.
Conclusion
Les catégories de plaisir et de souffrance ont souvent été conçues comme les deux pôles extrêmes entre lesquels se jouent toutes les activités de la nature humaine (Bentham). Cela n’a donc rien de surprenant de définir l’addiction par rapport à l’un ou l’autre de ces pôles (l’addiction consisterait dans la recherche du plaisir ou dans l’évitement de la souffrance) ou bien par rapport aux deux, en refusant la thèse de l’unité de la notion d’addiction (certaines addictions seraient plaisantes, les autres sédatives). Proposer l’hypothèse selon laquelle l’addiction serait intrinsèquement liée à des plaisirs mélangés à la douleur, serait une manière de déconstruire cette dichotomie et de montrer que, par-delà le plaisir, c’est toujours un manque – conscient ou non – qui est assouvi, toujours une souffrance qui est colmatée, une fonction qui est remplie par le plaisir. L’indissociabilité des sensations de plaisir et de douleur serait la marque de fabrique de l’addiction.
Il y a donc des objets qui procurent du plaisir qui ne peuvent pas mener à l’addiction et cette restriction permet de mettre un terme à une extension indéfinie de la notion d’addiction : ce sont seulement les plaisirs mélangés qui peuvent conduire à l’addiction et non pas les plaisirs purs. Même si les plaisirs mélangés constituent une grande majorité des plaisirs, soutenir cette thèse mène à soutenir une thèse unique quant à la nature de l’addiction : entendue non pas comme exacerbation des plaisirs, contrebalancée par des conséquences de plus en plus néfastes, mais comme découverte du plaisir qui correspond exactement à une douleur sous-jacente, intrinsèque à notre être, faisant de l’arrêt de l’addiction quelque chose d’extrêmement difficile, non seulement à cause des symptômes physiques comme le stress et l’angoisse dans le cas particulier des addictions comportementales, mais encore parce que cela signe là le renoncement à quelque chose qui améliorait notre existence, qui construisait notre identité.
Bibliographie
Dangaix, Denis, 2008. Tout Objet de Plaisir Peut Devenir Une Addiction : Entretien Avec Michael Stora. La santé de l’homme (396) : 4-6. http://irepsorspaysdelaloire.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=4883.
Elster Jon. 1999. Gambling and Addiction. Pp. 208-234 in Getting hooked : rationality and addiction, édité par Jon Elster et Ole-Jørgen Skog. Cambridge University Press.
Elster, Jon. 1999. Strong Feelings: Emotion, Addiction, and Human Behavior. Cambridge, Mass., [etc.]: MIT Press,
Farago, France. 2012. Le plaisir. Prépas commerciales. Paris : Armand Collin.
Huizinga, Johan, 1988. Homo ludens. Paris: Gallimard.
Peele, Stanton, « L’addiction au XXIème siècle » Psychotropes, 2009/4 Vol. 15.
Entre corps et psyché : les addictions. Sous la direction de Dominique Dupa, Michel Reynaud, Vladimir Marinov et François Pommier. EDP Sciences. Collection : Pluriels de la Psyché – 2010
Varescon, Isabelle. 2009. Les addictions comportementales, aspects cliniques et psychopathologiques. Wavre: Mardaga,
Valleur, Marc, and Dan Véléa. 2002. Les Addictions sans Drogue. Toxibase, no. 6.