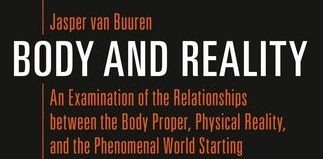Qu’est-ce qu’un objet ordinaire? (2/2)
Grégoire Lefftz, doctorant à l’université Paris-IV au sein de l’équipe « Sciences, Normes, Décision ».
Réflexion sur le problème du multiple
Cet article est la deuxième partie d’un article publié le 7/06/17.
III. Un autre concept d’objet
a) Un objet est la composition d’un fond ontique et d’une silhouette
Un objet ordinaire doit être délimité : l’idée d’un objet qui ne le serait en aucune façon est à peu près aussi inintelligible que celle d’un cercle carré. Pour être un objet complet, bien formé, il doit l’être dans cinq dimensions. Les trois dimensions spatiales tout d’abord : ainsi les organes de Tibbles font-ils bien partie de lui (ils sont inclus dans sa délimitation spatiale), tandis que ceux d’un autre chat, ou la tour Eiffel, n’en font pas partie. Une dimension temporelle, ensuite : Tibbles existait il y a cinq minutes, mais n’existait pas il y a deux mille ans, parce que sa délimitation temporelle passe entre les deux. Une dimension modale, enfin : dans la plupart des contextes, on aura envie de dire que Tibbles aurait pu avoir quelques poils de moins, mais n’aurait pas pu être un œuf poché. Dans chacune de ces dimensions, cette délimitation peut être plus ou moins épaisse, c’est-à-dire qu’elle peut admettre un certain vague. La délimitation temporelle qui marque le début de l’existence de Tibbles, par exemple, passe-t-elle au moment de sa naissance, à celui de sa conception, ou quelque part entre les deux ? Cela peut ne pas être déterminé (la délimitation peut être suffisamment épaisse pour recouvrir tous ces moments à la fois) ; il ne s’ensuit pas pour autant que cette délimitation n’existe pas. Je propose d’appeler silhouette cette délimitation quinqua-dimensionnelle et plus ou moins épaisse des objets.
Qu’un objet possède une silhouette n’est pas une thèse bien substantielle. Ce n’est au fond qu’une manière plus précise de formuler l’idée selon laquelle il doit toujours avoir une identité. La querelle peut naître en revanche de différentes manières de concevoir la fondation métaphysique de ces silhouettes, qui sont autant de façons de penser le concept d’identité individuelle (e.g. les attributions de silhouettes ont-elles des vérifacteurs ? Si oui, lesquels ? Si non, pourquoi ?).
Avant d’en venir là, remarquons toutefois qu’une silhouette ne suffit pas encore à faire un objet. Elle n’est, en elle-même, qu’une délimitation vide, qui exige de recevoir un contenu. Ce contenu est donné par la réalité. C’est, pour le dire de manière intuitive et informelle, la portion de monde que délimite et « capture » la silhouette. On appellera ce contenu « fond ontique », parce que son rôle métaphysique est de fonder l’existence de l’objet[1]. L’Everest existe bel et bien quelque part sur la frontière entre le Népal et la Chine, et n’existe pas au milieu de l’Océan Atlantique, parce que le fond ontique de cet objet, la portion de monde qui satisfait les conditions d’application associées au terme « Everest », la matière arrangée « en forme d’Everest » (Everest-wise, comme dit la terminologie en cours dans la littérature) ne se trouve qu’au premier de ces lieux. Par ailleurs, l’objet qui existe en tel lieu, à tel moment et dans tel monde possible a-t-il telle ou telle propriété (est-il rouge, en bois, intelligent) ? Informellement encore, la seule considération d’une silhouette ne peut nous donner la réponse : seule le peut celle du monde en question. Ainsi, toutes les propriétés viennent du monde ; mais quant à savoir si l’une d’elles appartient ou non à un certain objet, ou si celui-ci pourrait ou non la perdre (sans cesser d’exister), cela dépend de sa silhouette. En s’appuyant sur ces préliminaires intuitifs, il est alors possible de donner une caractérisation plus rigoureuse de notre concept : le fond ontique d’un objet est constitué par les instances de toutes les propriétés intrinsèques que cet objet doit posséder étant donné ce qu’est le monde, une fois que sa silhouette a été fixée.
Ces deux concepts étant acquis, il est à présent possible de s’en servir pour définir le concept d’objet ordinaire : un objet ordinaire est la composition d’un fond ontique et d’une silhouette. En tant que tel, ce concept est peu substantiel, et invite au consensus : il est clair qu’un objet doit être (plus ou moins nettement) délimité, et il est clair que ce qui est ainsi délimité doit être une portion du monde (par opposition à la fantasmagorie d’un penseur). Le désaccord peut naître, en revanche, de différentes manières de préciser ces concepts de silhouette et de fond ontique eux-mêmes. C’est ce risque qu’il faut prendre à présent.
b) Le fond ontique est donné, la silhouette ne l’est pas
Dire que le fond ontique d’un objet est une « portion de monde », c’est dire qu’il est donné, entièrement et sans reste. Nous ne créons pas par nos décisions, nos stipulations ou nos choix sémantiques la texture de cette couverture ni le bois de cette table. Ils auraient existé même si personne n’avait été là pour les voir. Nous ne stipulons pas non plus les faits d’instanciation : Tibbles aurait été un chat même si aucun penseur n’avait été là pour concevoir le concept de chat, parce que le monde est tel que le fond ontique de l’individu que nous appelons Tibbles possède les propriétés nécessaires à la satisfaction des conditions d’application de ce qui est, de fait, notre concept de chat. Si ce fond ontique des objets ne nous était pas donné, nous aurions le pouvoir de créer ex nihilo, par le seul pouvoir de notre pensée, des objets matériels. Le point de savoir ce qui existe ou non dans le monde dépendrait de nos choix, et cette pensée révolte aussi bien le sens commun que la plupart des philosophes. En ce sens, il est parfaitement vrai que nous ne décidons pas de ce qui existe dans le monde.
Mais du fond ontique il faut distinguer la silhouette, qui concentre toutes les difficultés du couple. Cette notion nous impose en effet de tenir une ligne de crête, en rejetant dos à dos deux positions extrêmes.
La première, selon laquelle les silhouettes des objets nous seraient tout simplement données. Mais deux types de situations obligent immédiatement à congédier cette idée. Les premières regroupent les cas de délimitation vague, tels que celui exposé par Feynman. Vague signifie en somme réalisabilité multiple : la silhouette de la table pourrait être précisée pour inclure tel atome a et exclure tel atome b ; mais elle pourrait également l’être de manière à inclure b et exclure a. Autrement dit, la silhouette de la table pourrait être « réalisée » de différentes manières. De fait, toute silhouette ne singularise pas un objet : il y en a qui ne s’appliquent pas. On dit ainsi que le père Noël n’existe pas, parce qu’il n’y a en fait aucune portion de monde, aucun fond ontique, qui réalise sa silhouette, qui lui donne corps, la matérialise : ses conditions d’application ne sont pas remplies. Une silhouette ne se suffit donc pas à elle-même, elle a besoin d’être réalisée. Mais nous rencontrons parfois des cas de réalisabilité multiple (à chaque fois que nous sommes confrontés à un objet vague), et ce sont autant de cas où le monde ne nous oblige pas à tracer une silhouette d’une certaine manière plutôt que d’une autre. Autrement dit, autant de cas où elle ne nous est pas donnée. La deuxième sorte de situation, symétrique de la première, regroupe les cas de constructibilité multiple. Soit une certaine portion de monde. Elle doit déjà être minimalement délimitée (sans quoi ce ne serait pas une portion du tout), mais elle peut ne l’être que dans une dimension, par exemple spatiale. On considère donc une certaine étendue de matière. Cette même portion de monde peut recevoir différentes silhouettes, aussi bien dans la dimension temporelle que modale (autrement dit : on peut construire à partir d’elle différents objet). C’est ainsi que du même morceau de matière, on peut construire à la fois une motte d’argile, en lui ajoutant une certaine délimitation temporelle (« elle cessera d’exister à l’instant t, lorsqu’elle sera dissoute dans l’acide »), et une délimitation modale (« elle cesserait d’exister si elle était dissoute dans l’acide, ou réduite en miettes et dispersée aux quatre coins du globe, ou… ») ; et une statue, en lui ajoutant une autre délimitation temporelle (« elle cessera d’exister à t-1, lorsqu’elle sera écrasée ») et une autre délimitation modale (« elle cesserait d’exister si elle était écrasée, ou si elle était fondue, ou… »). S’il est possible de donner différentes silhouettes à la même étendue, à la même portion de monde, c’est bien que le monde ne nous donne pas les silhouettes.
Mais il se peut qu’il contraigne nos choix en la matière. Le monde, en effet, n’est pas un continuum neutre et homogène. La matière y est diversement répandue. C’est précisément pourquoi les silhouettes ne peuvent pas non plus y être tracées de manière arbitraire : telle est la seconde position extrême qu’il nous faut donc rejeter. Certaines portions de monde se prêtent mieux que d’autres à être délimitées comme des objets : un être vivant est, en effet, un être plus intégré, plus solidaire, plus naturel qu’un tas de sable. Dire que le monde ne nous donne pas de silhouettes n’est pas dire que toutes se valent ; ce n’est pas dire non plus qu’il ne nous incite pas, parfois, à les tracer d’une certaine manière plutôt que d’une autre. Autrement dit, le tracé des silhouettes se fait sous certaines contraintes, qui semblent être de nature à la fois pragmatique (e.g. classifier les objets du monde en utilisant des concepts sauvagement disjonctifs serait incroyablement malcommode), et contextuelle (comme le montre la citation de Lewis sur Hubert Humphrey).
L’identité des objets nous est-elle ou non donnée ? On voit à présent que la question est mal posée. Un objet est la composition d’un fond ontique et d’une silhouette. Les fonds ontiques nous sont donnés. Les silhouettes ne sont ni données, ni arbitraires : dans les cas litigieux, elles font l’objet d’un jugement. De cette manière, il semble possible de respecter l’intuition qui soutenait le présupposé commun au paradoxe du multiple et à ses solutions nihiliste et essentialiste : quelque chose dans l’identité des objets doit nous être donné, ceux-ci sont en un sens important indépendants de nous, nous ne les créons pas par le seul pouvoir de notre volonté. Mais il est possible, également, de rejeter ce présupposé, du moins sous sa forme brute : tout dans l’identité des objets ne nous est pas donné. Il s’agit à présent d’examiner comment ces précisions nous permettent d’échapper à l’aporie.
IV. Retour au paradoxe du multiple
L’apparition du paradoxe du multiple a été expliquée ainsi : (i) l’on commence par supposer que toute délimitation véritable doit nous être imposée par le monde ; (ii) l’on ajoute qu’en toute rigueur, plusieurs délimitations différentes d’un même objet sont permises par le monde; (iii) l’on conclut finalement que toutes les délimitations possibles de l’objet, ayant « un titre égal » à le constituer, en sont autant de délimitations actuelles (contrairement au nihiliste, qui préfère quant à lui conclure qu’aucune n’en est une délimitation actuelle).
Mais évidemment, si l’on accepte le concept d’objet qui a été ici proposé, alors il faut rejeter (i). Lorsque Tibbles est en train de perdre ses poils, il y a plusieurs manières possibles de tracer sa silhouette. Mais cela ne signifie en aucun cas qu’il y a plusieurs Tibbles ! Cela signifie seulement que sa silhouette est vague, ou épaisse : nous n’avons pas ressenti le besoin de la tracer plus précisément. Dès lors, nous avons deux possibilités. La première, qui est sans doute la plus sensée, est de s’en tenir là. La silhouette de Tibbles est vague, celle de l’Everest l’est aussi : cela ne signifie ni que l’Everest n’existe pas, ni qu’il y a plusieurs sommets distincts qui sont le plus haut sommet du monde. Nous vivons entourés d’objets vagues, et cela ne pose aucun problème. La deuxième possibilité se présenterait si un philosophe trop insistant voulait savoir quelle est plus précisément la silhouette de Tibbles. L’on ferait alors ce qu’il est toujours possible de faire avec une notion vague : la préciser ou la raffiner, c’est-à-dire, rendre un peu plus fine sa silhouette épaisse, en décidant ou en stipulant que tel poil y est inclus (ou exclu au contraire).
Rappelons que la genèse du problème du multiple a été analysée à deux niveaux distincts. À un niveau général, la prémisse qui engendrait le paradoxe, et que celui-ci partageait avec ses solutions putatives, était que la délimitation des objets nous est imposée par le monde, complètement et sans reste. Les faits de réalisabilité et de constructibilité multiples permettent de comprendre en quoi cette thèse est fausse dans le cas des objets ordinaires. Mais à un niveau plus particulier, le problème naissait lui-même d’une certaine manière d’interpréter ce principe, selon laquelle à chaque délimitation spatiale distincte correspond un objet distinct. On voit à présent pourquoi les faits de réalisabilité et de constructibilité multiples des silhouettes d’objets ordinaires obligent a fortiori à rejeter ce principe. La silhouette d’un même objet peut être réalisée de différentes manières (quoique pas de n’importe laquelle) sans que cet objet cesse d’être numériquement le même, c’est-à-dire sans qu’il perde son identité. En 1870, la France fut amputée d’une partie considérable de son territoire, ce qui signifie que sa silhouette spatiale fut modifiée ; mais elle ne devint pas un autre objet, numériquement distinct du premier. C’était toujours la France. De même, lorsque Tibbles perd un poil, il ne devient pas un autre objet, numériquement distinct du premier. Il est certes vrai qu’à chaque délimitation spatiale correspond une unique délimitation spatiale ; comme il est vrai qu’à chaque ramassis hétéroclite d’objets correspond un unique ensemble, une classe définie extensionnellement. Mais il est ici question d’objets ordinaires, et c’est ce qu’il ne faut pas perdre de vue. Il est simplement faux qu’à chaque délimitation spatiale corresponde un objet ordinaire distinct ; sauf à stipuler un sens ad hoc de ce concept, distinct de celui que nous employons ordinairement. Mais dans ce cas, le problème du multiple ne menacerait que ce concept aberrant, et pourrait être calmement dédaigné.
Pour comprendre plus précisément le fonctionnement de cette solution, revenons aux deux formulations du paradoxe données en première partie. Considérons-en d’abord la première version :
Le paradoxe des mille et un chats – 1
(1) Il y a un unique chat sur le tapis : Tibbles.
(2) Un chat qui possède un certain poil, et un chat semblable en tout point au premier à ceci près qu’il ne possède pas ce poil, sont deux chats distincts.
(3) Lorsque Tibbles perd un poil, cela ne fait ni apparaître ni disparaître aucun chat.
C’est évidemment la proposition (2) qui est niée. Les deux parties de Tibbles, celle qui inclut et celle qui exclut le poil p1, ne sont pas deux chats distincts : ce sont deux manières possibles de préciser, ou d’affiner, la silhouette épaisse de Tibbles. Mais avant cet affinement, il n’y a qu’une silhouette (épaisse), qui délimite un unique chat ; et après cet affinement, s’il a lieu, il n’y a encore qu’une seule silhouette (moins épaisse), qui ne délimite encore qu’un unique chat (plus précis). Pour cette raison, les propositions (1) et (3) sont quant à elle conservées, ce qui est souhaitable : la résolution d’un paradoxe est d’autant meilleure qu’elle permet de conserver un plus grand nombre de propositions plausibles – et qu’elle parvient à montrer que la proposition rejetée, après tout, ne l’était pas. On notera d’ailleurs que cette formulation du paradoxe est ici résolue sans recourir, contrairement à ce que propose Lewis, à la notion de partie temporelle, et peut donc demeurer neutre quant à la querelle de l’endurantisme et du perdurantisme, ce qui la renforce d’autant.
Considérons à présent la deuxième formulation du paradoxe, suggérée par Lewis :
Le paradoxe des mille et un chats – 2
(1) Il y a un unique chat sur le tapis : Tibbles.
(2) Un chat qui possède un certain poil, et un chat semblable en tout point au premier à ceci près qu’il ne possède pas ce poil, sont deux chats distincts.
(3’) Il y a sur le tapis, pour chaque poil de Tibbles, une partie (propre ou non) de Tibbles qui le possède et une autre qui ne le possède pas, et chacune de ces parties est un chat.
Ici encore, évidemment, (1) est conservée et (2) est rejetée. Si (3’) était conservée cela serait, pour la raison qui vient d’être évoquée, un avantage. Qu’en est-il ? Chacun des chats ici évoqués correspond à une manière possible d’affiner la silhouette vague de Tibbles. Dire que ces chats sont tous des individus distincts serait admettre (2), et ne pourrait être accepté ; mais ce n’est précisément pas ce que dit (3’). En tant que telle, cette proposition peut très bien (et doit) être interprétée comme signifiant que tous ces chats sont, en l’occurrence, le même chat, c’est-à-dire qu’il s’agit dans tous les cas de Tibbles. Si je ne lui arrache aucun poil, c’est Tibbles ; si je lui en arrache un, ce n’est pas un autre chat, c’est encore Tibbles (justement parce que sa silhouette n’est pas assez fine pour inclure ce poil de manière déterminée). (3’) ne dit pas autre chose, et peut donc être conservée.
On voit donc comment le paradoxe du multiple naissait d’un concept d’objet inadéquat. Il présupposait en effet que toute portion du monde constitue un objet : Tibbles en est un, mais comment la partie propre de Tibbles à laquelle il manque un poil n’en serait-elle pas un au même titre ? Il présupposait, en d’autres termes, que la constitution est l’identité : comment deux composés méréologiquement distincts feraient-ils alors un unique objet ? Toutefois, une portion de monde ne suffit pas encore à faire un objet : il y faut encore une délimitation. De même, un chevauchement matériel, une identité de « fonds ontiques » ne suffit pas encore à faire une identité entre deux objets : il y faut encore une identité de silhouettes. Bien sûr, Tib possède une délimitation, qui est en l’occurrence spatiale. Mais une portion du monde délimitée dans une seule dimension ne suffit pas à faire un objet complet et bien formé : il lui manque pour cela une silhouette tridimensionnelle. Sans quoi nous ne tenons qu’une ébauche d’objet : une simple région de l’espace, une abstraction opérée sur un objet complet, une chose imparfaitement délimitée. Tib est bien les trois à la fois : une région, une abstraction, et une chose. Mais il n’est pas un objet, et affirmer ou nier son identité avec Tibbles relève seulement d’une mauvaise grammaire. Il pourrait certes devenir un objet, si l’on complétait sa silhouette dans les dimensions temporelle et modale ; mais c’est la proposition selon laquelle il y a un seul chat sur le tapis qui deviendrait fausse (y compris du point de vue du sens commun lui-même), puisque compléter sa silhouette signifierait rigoureusement le considérer comme un nouvel objet à part entière. Le paradoxe ne reparaîtrait pas.
V. Objections
Les considérations qui précèdent ne peuvent manquer de soulever au moins deux objections, toutes deux très fortes, mais vouées, en dernière analyse, à ne pas emporter la décision. La première se fonde sur une reconstruction du paradoxe des mille et un chats qui ne recoure plus à la comparaison de Tibbles, notre chat vague et familier, avec Tib, la partie propre nettement délimitée de Tibbles à laquelle il manque un certain poil. Dans ce dernier cas, il était en effet possible de dire que, Tibbles étant vague, il ne possède pas de manière déterminée le poil que Tib exclut de manière déterminée, de sorte que l’on ne peut conclure, en contraposant la Loi de Leibniz, à leur distinction. Cette reconstruction choisit donc de se fonder plutôt sur la comparaison de deux objets précis : Tib1, le chat qui inclut de manière déterminée le poil fatidique, et Tib2 le chat qui l’exclut de manière déterminée. Il semble impossible de dire que Tib1 et Tib2 ne sont pas distincts. Puisque ce sont tous deux des chats, nous avons à nouveau plusieurs chats où nous avions cru n’en avoir qu’un. Le paradoxe est retrouvé, sur de nouvelles bases.
Cette objection rencontre en fait un dilemme qui lui est fatal. Par Tib1 et Tib2, il faut en effet que l’on entende, soit de simples délimitations spatiales, soit des chats, qui sont des objets ordinaires possédant chacun une silhouette spatiale, mais aussi temporelle et modale. Dans le premier cas, l’objection est sans portée ; dans le second, elle constitue au mieux une pétition de principe, au pire une erreur. (i) Si Tib1 et Tib2 sont de simples délimitations spatiales, et non des objets ordinaires complets et quinqua-dimensionnels, alors il est clair qu’il faut conclure à leur distinction, en vertu de la Loi de Leibniz : car l’une possède (de manière déterminée) une propriété que l’autre ne possède pas (de manière déterminée). Ce sont simplement deux zones distinctes. Mais dans ce cas, nous n’avons pas encore mille et un chats : nous avons seulement un chat unique, dans lequel il est possible de découper (par abstraction) une infinité de délimitations spatiales distinctes. Cette conclusion n’est aucunement paradoxale : au contraire, c’est sa négation qui le serait. (ii) Pour que l’objection soit décisive, il faut donc que Tib1 et Tib2 soient des chats. Mais c’est ce que l’objecteur ne peut affirmer sans commettre, soit une erreur, soit une pétition de principe. (a) L’objecteur se trompe en effet en supposant évident que Tib1 et Tib2 sont tous deux des chats. Tout comme je suis un être humain mais ma main ne l’est pas (elle n’est qu’une partie de mon corps), il est au moins concevable que Tib1 soit un chat sans que Tib2, qui n’en est qu’une partie propre, en soit un également. Auquel cas l’objecteur commettrait tout bonnement une erreur : nous n’aurions pas deux chats, mais un chat et l’une de ses parties propres, ce qui ne constitue assurément pas un paradoxe. (b) Supposons toutefois que Tib1 et Tib2 soient bel et bien des chats. Pour que l’argument fonctionne, il faut encore que ces chats soient distincts, et ce de manière déterminée. Or si l’on admet le concept d’objet défendu dans cet article, on ne peut conclure de la distinction des délimitations spatiales à la distinction numérique des objets qu’elles délimitent (songeons à la France avec l’Alsace-Lorraine, et à la France sans ce territoire). Affirmer que Tib1 et Tib2 sont numériquement distincts suppose donc d’adopter, à la racine, un autre concept d’objet que celui défendu ici. Cela suppose d’adopter un concept qui permette de dire qu’à chaque délimitation spatiale correspond un objet distinct. Dès lors, il ne s’agit plus d’une objection à notre solution au problème du multiple, mais bien d’une pétition de principe à son encontre. Ce n’est pas un argument, mais une pure et simple négation de ce qui est ici affirmé. En tant que telle, celle-ci peut donc être congédiée.
Cette réponse pourrait toutefois susciter un doute : si choisir d’employer le concept d’objet d’après lequel il est vrai qu’il y a « 1001 » objets sur le tapis (et qui correspond en fait à celui de somme méréologique) constitue une pétition de principe contre la position selon laquelle il vaut mieux, au contraire, employer le concept d’objet d’après lequel il n’y en a qu’un seul (et qui correspond à celui d’objet ordinaire), l’inverse n’est-il pas vrai également ? N’y a-t-il pas une simple opposition frontale entre ces deux positions, aucune n’étant plus justifiée que l’autre ? Pour répondre à ce souci, on remarquera d’abord que la multiplication des chats n’est possible que si l’on compte les objets en sommes méréologiques, mais elle ne pose de problème que si on les compte en objets ordinaires. Ainsi, pour notre usage habituel (pré-philosophique) du terme d’objet, il n’y a qu’un seul chat, et donc pas de paradoxe. De même, pour notre usage méréologique du concept, il y a de nombreux objets, mais toujours pas de paradoxe. Le paradoxe n’apparaît que lorsque l’on attribue au concept d’objet ordinaire les caractères du concept d’objet extraordinaire (c’est-à-dire exclusivement philosophique) qu’est celui de somme méréologique. Il y a donc un sens auquel il est vrai que chaque concept d’objet est légitime, pourvu qu’il soit bien distingué de l’autre. Mais il n’est pas vrai que ces deux concepts soient également légitimes pour parler des chats. De même qu’un chat est un objet ordinaire, une partie arbitraire de chat est une somme méréologique. Parler des chats comme si l’on parlait de sommes méréologiques engendre le paradoxe du multiple – mais c’est pour autant qu’il s’agit là du mauvais concept d’objet. En matière d’objets ordinaires, tels que les chats, l’un des deux concepts d’objet est bien préférable à l’autre : à savoir, celui d’objet ordinaire.
La seconde objection consiste quant à elle à demander, avec quelque incrédulité, s’il est vraiment question ici d’objets réels, plutôt que de pures fantasmagories. Lorsque l’on dit que l’identité des objets dépend d’un jugement, parle-t-on d’identité ontique ou épistémique ? Ce n’est après tout qu’au premier sens que la thèse serait substantielle ; mais ce n’est qu’au second sens qu’elle serait acceptable.
Cette objection est considérable, dans la mesure où elle consiste au fond à réaffirmer le concept d’objet ici contesté, selon lequel un objet ordinaire n’est véritable que lorsque rien en lui ne dépend de notre esprit ou de nos décisions, mais en recentrant le propos sur ce qui nous pousse à accepter cette notion : à savoir, que ce qui existe dans le monde ne dépend pas de nous. Cette intuition recèle beaucoup plus qu’un fond de vérité, et il est donc crucial de pouvoir y faire droit. Pour ce faire, il convient d’abord de formuler clairement les données du problème auquel elle nous confronte. Le ressort de l’objection est en somme de nous confronter à l’alternative de deux conceptions générales incompatibles de ce qu’est un objet ordinaire. (α) Selon la première, il ne peut rien y avoir dans un tel objet qui dépende de nos décisions. Son identité est absolument, et complètement, déterminée par le monde. Il est toutefois clair que ce principe, s’il est interprété littéralement, est révisionniste, au sens où il ne correspond pas à notre concept habituel d’objet ordinaire. Il nous oblige en effet à compter comme inexistants des objets qui, selon le sens commun, existent, à l’instar de la chaise dont parle Feynman. Cet objet n’est pas complètement déterminé par le monde : nous jouissons d’une latitude, certes infime mais irréductible, dès lors qu’il s’agit de tracer sa délimitation exacte. Il s’ensuit que, selon ce premier concept d’objet ordinaire, cette chaise n’est pas un tel objet. On dira alors, soit qu’il y a en fait autant de chaises que de manière possible d’en délimiter une (ce qui revient à poser le problème du multiple), soit que la chaise n’existe pas (ce qui en est la variante nihiliste). (β) Selon l’autre conception générale des objets ordinaires, dont relève le concept qui en est ici défendu, il est toutefois possible qu’un tel objet dépende dans une certaine mesure de nos choix et de nos décisions, et dans une autre mesure n’en dépende pas. C’est bien sûr le second terme de ce doublon qui nous intéresse ici : car lui seul permet de faire droit à l’idée que nous ne créons pas ces objets ex nihilo, ou que nous ne décidons pas purement et simplement de ce qu’il y a dans le monde. Évidemment, c’est le concept de fond ontique qui a ici à charge de remplir ce rôle. La proposition selon laquelle « il y a une chaise dans cette pièce » ne peut pas être rendue vraie ou fausse par une simple stipulation : elle est rendue vraie ou fausse par le monde, selon qu’il y a ou non, dans cette pièce, de la matière arrangée « en forme de chaise ». Il y a donc un sens très fort auquel ce qu’il y a dans le monde ne dépend pas du tout de nos décisions. Mais il y a également un autre sens, complémentaire du premier, auquel cela en dépend. Le concept de chaise n’est pas d’une précision absolue : on sait bien que les stylistes contemporains peuvent en distordre l’idée ou en déstructurer la forme, au point que l’on puisse se demander d’un objet s’il est encore, ou non, une chaise. En d’autres termes, le concept de chaise admet des cas-limite. Dès lors, le point de savoir s’il y a ou non une chaise dans cette pièce pourra dépendre de nos décisions concernant le concept de chaise. En ce sens, et en ce sens seulement, le point de savoir ce qu’il y a dans le monde dépend de nous. Mais le réalisme métaphysique pourrait-il encore s’en trouver offusqué ?
Conclusion : Une conception de la métaphysique ?
Les apories auxquelles donne lieu un concept erroné d’objet ordinaire sont peut-être le plus clairement révélées par les mésaventures de la notion d’objet vague. Timothy Williamson (2003, 690) écrit : « Lorsque j’enlève mes lunettes, le monde semble flou. Lorsque je les remets, il semble net (‘sharp-edged’). Je ne crois pas que le monde était réellement flou ; je sais que ce qui a changé est ma relation aux objets physiques distants, non ces objets eux-mêmes. Je suis plus enclin à croire que le monde était et est réellement net. » Williamson exprime ici une conception représentationnelle du vague : celui-ci ne pourrait exister que dans notre esprit, du fait de l’imprécision de nos concepts ou de notre ignorance, et non dans le monde lui-même. Il ne pourrait être un vague ontique. L’idée d’un objet qui serait vague en soi semble n’avoir aucun sens : les objets ne sont après tout que ce qu’ils sont. Parce que le vague ne peut être ontique, il doit être représentationnel ; parce que nos termes ne peuvent référer de façon univoque à des objets vagues, on doit considérer qu’ils réfèrent de façon ambigüe à plusieurs objets précis.
Mais cette inférence suppose qu’entre ces deux interprétations du vague, le tiers est exclu. C’est précisément ce dont il y a lieu de douter. Si l’Everest est un objet vague, c’est probablement parce que notre idée de l’Everest n’est pas assez précise (comme le prouve le fait qu’il est possible de la raffiner) ; il n’en demeure pas moins que c’est bien l’Everest dont la délimitation est vague. Autrement dit, l’alternative des vagues ontique et sémantique suppose une certaine séparation des objets, qui relèveraient du monde lui-même, et de nos concepts, qui n’auraient à charge que de le refléter. Cette alternative structure la métaphysique ; c’est elle que l’on a vue à l’œuvre dans le problème du multiple, dans la thèse nihiliste et dans la thèse essentialiste. Mais c’est une fausse alternative. Comme l’écrit Sainsbury (1994, §7), elle suggère
que nous avons le choix entre deux images. D’après l’une, notre monde, avant que nous ne le trouvions, est une bouillie indifférenciée. En le trouvant, nous le divisons. Si nous le divisons avec des outils vagues, nous voyons le monde comme contenant des objets vagues […] mais l’explication s’en trouve en nous et dans les outils que nous utilisons, et non dans le monde. D’après l’autre image, le monde est constitué d’une certaine manière avant que nous ne le trouvions. Notre travail est de façonner des concepts qui le reflètent. Parce qu’il contient des objets vagues, nous trouvons des objets vagues […] Je doute que l’une ou l’autre de ces images soit intelligible […] Nous ne pouvons pas concevoir le monde, excepté à travers nos concepts.
Ce qui est donc en cause, c’est un certain concept d’objet, qui serait totalement absorbé par le monde – ou à l’inverse, et non moins invraisemblablement, par nos concepts. Faire de l’objet la composition d’un fond ontique et d’une silhouette, et considérer que si le fond ontique est donné, la silhouette ne l’est pas, c’est rejeter cette alternative. Un objet est un composé de concept et de monde. Ainsi l’objectivité ne paraît-elle pas exclure toute conceptualisation – bien au contraire.
Ce qui se joue dans cette notion d’objet, c’est une conception de la métaphysique qui échappe à la fois au verbalisme carnapien et au réalisme néo-quinien. Elle échappe au premier parce qu’elle se garde d’admettre que parler des concepts, c’est parler d’autre chose que du monde. Elle échappe au second parce qu’elle omet de concevoir la métaphysique sur le modèle de la recherche scientifique, qui aurait pour objet de découvrir des faits indépendants de l’esprit. Y a-t-il mille et un chats sur mon tapis ? Les nombres existent-ils ? Les mondes possibles sont-ils des réalités concrètes situées dans une autre réalité spatio-temporelle que la nôtre ? Les métaphysiciens ont tendance à traiter de ces questions comme si elles pouvaient être tranchées par la découverte d’un fait caché quelque part. Cette démarche étant vouée à l’échec, l’exclamation se fait régulièrement entendre que la métaphysique n’est, après tout, qu’un jeu trivial. En refusant cette pure et simple séparation des concepts et du monde, il se pourrait donc que le concept d’objet proposé ici ait une portée qui excède la résolution du paradoxe de Geach. Il se pourrait que l’on s’enhardisse jusqu’à y voir l’enjeu d’une conception de la métaphysique, et de sa méthode : une méthode selon laquelle le monde ne pourrait être étudié indépendamment du langage ou du schème conceptuel par lequel nous l’appréhendons, mais aussi selon laquelle étudier ce schème n’est pas étudier autre chose que les objets mêmes qu’il permet de conceptualiser.
Bibliographie
Armstrong, D. (1978). Nominalism and Realism. Cambridge: Cambridge University Press.
Ellis, B. (2001). Scientific Essentialism. Cambridge: Cambridge University Press.
Feynman, R. (1964). Lectures on Physics, vol. I. Réed., New York: Basic Books.
Geach, P.T. (1980). Reference and Generality. 3rd edn., Ithaca: Cornell University Press.
LaPorte, J. (2004). Natural Kinds and Conceptual Change. Cambridge: Cambridge University Press.
Lewis, D. (1986). On the Plurality of Worlds. Oxford: Blackwell.
Lewis, D. (1999). Many, but Almost One. In D. Lewis, Papers in Metaphysics and Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press, 164-182.
Rea, M.C. (1997). Introduction. In M.C. Rea (éd.), Material Constitution, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, xv-lvii.
Sainsbury, R.M. (1994). Why the World Cannot be Vague. The Southern Journal of Philosophy 33, suppl.: 63-81.
Schaffer, J. (2009). On What Grounds What. In D. Manley, D.J. Chalmers & Ryan Wasserman (éds.), Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology. Oxford: Oxford University Press, 347-383.
Sosa, E. (2003). Ontological and Conceptual Relativity and the Self. In M.J. Loux & D.W. Zimmerman, The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford: Oxford University Press, 665-689.
Unger, P. (1979). There Are no Ordinary Things. Synthese, 41: 117-54.
Unger, P. (1980). The Problem of the Many. Midwest Studies in Philosophy, 5: 411-67.
van Inwagen, P. (1990). Material Beings. Ithaca, NY : Cornell University Press.
Williamson, T. (2003). Vagueness in Reality. In M.J. Loux & D.W. Zimmerman, The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford: Oxford University Press, 690-715.
[1] Au sens d’une relation de grounding, telle que la littérature récente l’a caractérisée. Voir par exemple J. Schaffer, 2009.