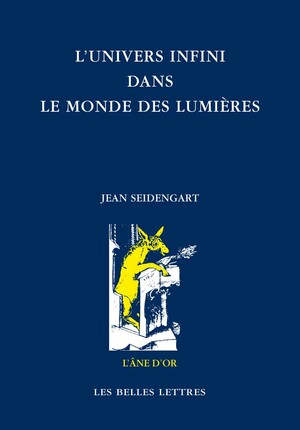Affordances et sublimités architecturales
Affordances et sublimités architecturales*
Affordances and architectural sublimities
Jérôme Dokic. Philosophe, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, rattaché à l’Institut Jean-Nicod (EHESS-ENS-CNRS)
Anne Tüscher. Architecte, philosophe, maître de conférences à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (HESAM Université), rattachée au laboratoire MAP-Maacc (CNRS-MC)
Dossier « Repenser l’interdisciplinarité entre esthétique et neurosciences cognitives », coordonné par Donna Jung et Bruno Trentini.
Résumé
Dans cet article, nous examinons le rôle de la perception des affordances dans l’expérience esthétique de l’architecture. Selon J. J. Gibson, la perception d’une affordance est instrumentale : l’objet perçu est appréhendé essentiellement comme une occasion d’agir ou de réagir dans l’environnement du sujet. Selon une thèse traditionnelle, d’origine kantienne, l’expérience esthétique n’est pas de nature instrumentale, et ne peut donc pas être conçue sur le modèle de la perception d’une affordance. Nous distinguons deux versions de cette thèse, selon que l’expérience esthétique est jugée compatible ou non avec la perception d’affordance. Nous montrons que l’expérience esthétique d’un objet architectural se nourrit typiquement des affordances qu’il réalise. L’expérience esthétique est compatible avec la représentation d’un objet comme une affordance et même, dans certains cas, la requiert. Enfin, nous nous tournons vers d’autres formes d’expérience esthétique, dont certaines sont liées au sublime, et qui pourraient bien, par leur dimension synoptique ou holistique, être incompatibles avec la perception d’affordances discrètes.
Mots-clés : affordance, architecture, expérience esthétique, beauté, sublime
In this paper, we examine the role of affordance perception in the aesthetic experience of architecture. According to J. J. Gibson, affordance perception is instrumental; the perceived object is apprehended essentially as an opportunity to act or react in the subject’s environment. A traditional Kantian thesis entails that the aesthetic experience is not instrumental, and thus cannot be conceived on the model of affordance perception. We distinguish two versions of this thesis, depending on whether the aesthetic experience is claimed to be compatible or not with affordance perception. We show that the aesthetic experience of an architectural object typically feeds itself into the affordances that it realizes. The aesthetic experience is compatible with the apprehension of some object as an affordance and even requires it in some cases. Finally, we turn to other varieties of the aesthetic experience of architecture, some of which being linked to the sublime, suggesting that their synoptic or holistic character might well make them incompatible with the perception of discrete affordances.
Keywords: affordance, architecture, aesthetic experience, beauty, sublime
Introduction
Il y a plus de quarante ans, le psychologue James J. Gibson écrivait : « L’architecture et le design n’ont pas de bases théoriques satisfaisantes. […] Une approche écologique de la psychologie de la perception et du comportement peut-elle leur en fournir[1] ? » La notion clé de l’approche écologique de Gibson est sans doute celle qu’il désigne sous le terme d’« affordance[2] ». Succinctement, car nous y reviendrons, une affordance est une occasion d’agir ou de réagir qui, selon Gibson, se présente directement dans le champ de la perception. Par exemple, une canopée est perçue comme une occasion de s’abriter, une plante vénéneuse comme une occasion de garder ses distances, ou une porte comme une occasion de quitter la pièce. Depuis quelques années, la notion d’affordance est reprise par certains théoriciens de l’architecture, et même certains praticiens (voir l’agence néerlandaise raaaf, pour « Rietveld Architecture-Art-Affordances », co-dirigée par le philosophe Erik Rietveld), intéressés par la possibilité d’une architecture « scientifiquement fondée ». Cette possibilité, transformée en outil promotionnel dans sa version la plus large et la plus forte, s’est récemment dotée d’une terminologie ad hoc : la « neuroarchitecture ». S’il est sans doute nécessaire – mais peut-être trop facile – de faire une critique argumentée de ce mouvement, reprenant dans ses grandes lignes les arguments opposés à la neuroesthétique[3], il convient néanmoins de lui reconnaître un mérite, à savoir celui de chercher à refonder l’architecture sur de meilleures connaissances des interactions entre l’homme et son environnement, en particulier construit.
 Dans cet article, nous nous proposons d’analyser, à partir de considérations philosophiques et scientifiques, une sous-partie de l’expérience architecturale, à savoir celle que l’on qualifierait plus volontiers d’« esthétique ». Nous commencerons par rappeler la manière traditionnelle dont la notion d’expérience esthétique est introduite, par le biais d’un contraste avec la perception instrumentale du monde. Reprise dans un vocabulaire contemporain, la thèse négative qui nous intéresse ici est que l’expérience esthétique ne doit pas être conçue sur le modèle de la perception d’une affordance.
Dans cet article, nous nous proposons d’analyser, à partir de considérations philosophiques et scientifiques, une sous-partie de l’expérience architecturale, à savoir celle que l’on qualifierait plus volontiers d’« esthétique ». Nous commencerons par rappeler la manière traditionnelle dont la notion d’expérience esthétique est introduite, par le biais d’un contraste avec la perception instrumentale du monde. Reprise dans un vocabulaire contemporain, la thèse négative qui nous intéresse ici est que l’expérience esthétique ne doit pas être conçue sur le modèle de la perception d’une affordance.
Nous distinguerons deux interprétations, forte et faible, de cette thèse, selon que l’expérience esthétique est supposée être compatible ou non avec la perception d’affordances. Puis nous montrerons par quelques illustrations que l’appréciation esthétique de l’architecture repose souvent sur l’identification d’affordances diverses, positives ou négatives. Si l’intérêt esthétique pour un objet architectural n’est pas lui-même de nature instrumentale, force est de constater qu’il se nourrit des affordances réalisées par cet objet. L’expérience esthétique est compatible avec la représentation de l’objet comme une affordance et même, dans certains cas, requiert une telle représentation.
Dans la dernière partie de l’article, nous nous tournerons vers d’autres formes d’expérience esthétique, dont la nature est telle qu’elles pourraient bien être incompatibles avec l’appréhension de l’objet architectural comme une affordance. Sans entrer dans les débats complexes autour du thème vénérable de la sublimité, nous suggérerons que l’expérience du sublime, notamment en architecture, exclut l’appréhension simultanée d’affordances discrètes.
I. L’expérience esthétique contre la perception instrumentale
Selon une conception traditionnelle, l’expérience esthétique se définit par contraste avec la perception ordinaire du monde. Si celle-ci est essentiellement instrumentale, celle-là nécessite une prise de distance pragmatique vis-à-vis de son objet. Kant parle de l’expérience de la beauté comme occupant les facultés de connaître « sans autre intention[4] ». L’expérience de la beauté est « désintéressée », non pas au sens où nous ne portons aucun intérêt à l’objet beau, mais au sens où l’intérêt que nous lui portons ne dérive pas d’un but quelconque que nous nous serions fixés par ailleurs. Lorsque le marchand d’art s’intéresse à une œuvre parce qu’il envisage un bon placement, son expérience n’est pas désintéressée au sens kantien, et ne saurait être une expérience esthétique. L’objet esthétique est appréhendé comme une fin en soi, et non comme un moyen en vue d’une action possible. Dans le même esprit (et malgré ce qui le sépare de Kant par ailleurs), Schopenhauer oppose l’expérience de « l’homme ordinaire », qui « ne peut porter son attention sur les choses que dans la mesure où elles ont un certain rapport avec sa propre volonté » et l’« aperception complètement désintéressée à tous égards qui constitue à proprement parler la contemplation », et qui est la marque de l’expérience esthétique[5].
Sans prétendre faire ici l’exégèse de la position de Kant ou de celle de Schopenhauer, il nous semble qu’une intuition centrale de la conception traditionnelle peut être reformulée au moyen de la notion d’affordance[6]. La perception est instrumentale quand elle appréhende son objet comme une affordance, c’est-à-dire comme une occasion d’agir ou de réagir d’une certaine façon. Gibson a proposé plusieurs définitions générales de la notion d’affordance, dont voici deux instances caractéristiques :
Qu’entend-on par « affordance » ? Une définition s’impose, d’autant que le mot ne figure dans aucun dictionnaire. Sous réserve de modification, je suggère qu’une affordance est une combinaison spécifique de propriétés des substances et des surfaces considérées en référence à un animal[7].
Les affordances de l’environnement sont ce qu’il offre à l’animal, ce qu’il supplée ou fournit, que ce soit bon ou mauvais[8].
Par exemple, une source d’eau peut être perçue comme une occasion de s’abreuver, un précipice comme une occasion de s’éloigner de son bord, un marteau comme une occasion d’enfoncer un clou, etc. La notion d’affordance peut être rapportée à des découvertes plus récentes dans le domaine des neurosciences. Le cortex prémoteur, dont le rôle premier est de planifier et d’organiser les mouvements corporels, héberge des neurones visuo-moteurs, appelés « neurones canoniques[9] ». Ces neurones associent des programmes moteurs spécifiques à certains objets perçus, et réagissent aussi bien à la simple observation de ces objets (par exemple, un marteau) qu’à l’exécution des mouvements corporels les utilisant (par exemple, l’action de saisir le marteau pour enfoncer un clou). Susan Hurley décrit justement les neurones canoniques comme des « neurones d’affordances[10] ». Certains cas de perception d’affordance seraient donc réalisés dans le cortex prémoteur, même si les outils ne constituent qu’un sous-ensemble des affordances (qui ne concernent pas toujours des objets littéralement manipulables, comme le jour et la nuit, qui pour maintes espèces réalisent des affordances vitales différentes).
Distinguons à présent deux versions de la conception traditionnelle. Selon la version forte, l’expérience esthétique exclut l’appréhension de son objet comme une affordance. Il est impossible d’avoir une expérience esthétique à l’égard d’un objet appréhendé simultanément comme une affordance. Selon la version faible, l’expérience esthétique ne doit pas être conçue sur le modèle de la perception instrumentale, mais elle est compatible avec l’appréhension indépendante et simultanée de l’objet esthétique comme une affordance.
À première vue, la version forte est peu plausible en tant que théorie générale de l’expérience esthétique. Il est difficile de ne pas voir le Porte-bouteille de Marcel Duchamp (1914) comme une affordance, en l’occurrence une structure destinée à accueillir des bouteilles vides. Il est d’ailleurs probable (mais c’est une simple spéculation) que la perception du porte-bouteille active de manière quasi-automatique un schéma moteur spécifique, dont l’exécution permettrait de ranger une bouteille sur l’une des tiges métalliques de la structure. Pourtant, il est aussi possible d’avoir une expérience esthétique du porte-bouteille (du moins en tant que la présentation de cet objet s’inscrit dans un contexte artistique déterminé[11]). Dans ce cas, bien que l’expérience esthétique n’appréhende pas le porte-bouteille comme une affordance, elle est compatible avec une telle appréhension. À vrai dire, il est même probable que la première présuppose la seconde, au sens où l’expérience esthétique du porte-bouteille dépend d’une manière ou d’une autre de la prise de conscience de l’affordance ordinaire qu’il réalise.
Dans la suite de cet article, nous souhaitons développer deux hypothèses. Premièrement, nous tenterons d’illustrer par quelques exemples la prégnance théorique de la notion d’affordance et de ses déclinaisons pour rendre compte de l’expérience esthétique de l’architecture. Puis nous suggérerons que si la thèse forte ne saurait convenir à l’expérience esthétique dans son ensemble, elle a une application limitée à certaines formes d’expérience esthétique, notamment celles que la tradition a rangé sous la rubrique du sublime.
II. Affordances architecturales
La thèse forte selon laquelle l’expérience esthétique exclut l’appréhension de l’objet comme une affordance paraît peu plausible dans les domaines où, intuitivement, la relation entre la forme et la fonction est cruciale. C’est le cas au moins pour le design et l’architecture. Lorsque nous trouvons une chaise de Marcel Breuer esthétiquement réussie et donc jugée « belle », notre expérience ne se résume certes pas à l’appréhension de la chaise comme une affordance, en l’occurrence comme l’occasion de s’y asseoir confortablement. Mais la première dépend étroitement de la seconde, au sens où nous apprécions la manière dont la chaise a été construite dans les limites de sa fonction prévue. Notre évaluation esthétique positive de la chaise est donc fonction de son appréhension comme une affordance spécifique. Il en va parfois autrement, et des objets difficilement utilisables mais dont la fonction reste apparente, comme les « objets inconfortables » de l’architecte et artiste Katerina Kamprani (une chaise sur laquelle il est impossible de s’asseoir, des escaliers sans issue, ou encore un parapluie en béton), peuvent susciter une expérience esthétique, qui joue justement sur la relation entre la forme et la fonction, ou plutôt s’en joue.
Qu’en est-il de l’architecture ? Il y a plus de deux mille ans, Vitruve, architecte romain, soutenait que les trois qualités principales d’une œuvre architecturale doivent être la solidité, l’utilité et la beauté. Cette triade vitruvienne, à la base de toute l’architecture classique, a prévalu jusqu’au début du XXe siècle, où la relation entre le deuxième et le troisième membre de la triade est devenue source de discussions, voire de polémiques. Alors que l’esthétique architecturale avait été jusque-là un sujet digne d’une attention soutenue, au titre d’une croyance partagée selon laquelle les qualités esthétiques d’un bâtiment exercent une influence significative sur l’expérience humaine, la question de la beauté architecturale s’est trouvée reléguée au rang de produit dérivé, tant au niveau des pratiques de conception architecturale que de l’investigation théorique. Le slogan manifeste de l’architecture moderne – « la forme suit la fonction » – a conduit de nombreux architectes à délaisser les qualités esthétiques au profit des aspects plus quantifiables de l’environnement construit.
Depuis une trentaine d’années, grâce à des études menées avec l’appareil méthodologique développé par les sciences cognitives[12], nous prenons peu à peu la mesure de l’impact de ces qualités esthétiques négligées sur l’humeur, le fonctionnement cognitif, le comportement, voire la santé mentale des utilisateurs des bâtiments que nous sommes toutes et tous puisque, pour la plupart d’entre nous, nous y passons la grande majorité de notre vie.
L’architecture peut induire, au-delà d’une simple préférence, des états psychologiques profonds et variés. L’appréhension d’un objet architectural provoque des réponses sensorielles et émotionnelles complexes : excitation, apaisement, réconfort, contemplation, voire majesté. Ces dimensions fondamentales de l’expérience de l’architecture dépendent probablement, au moins indirectement, de l’évolution biologique de mécanismes adaptifs. Par exemple, la recherche ancestrale d’un abri sûr, protégé des intempéries comme des prédateurs, a sans doute conditionné, au moins en partie, nos réponses spontanées à la perception d’un artefact architectural. Comme le rappellent Alex Coburn et ses collaborateurs[13], les théoriciens de l’architecture distinguent depuis longtemps deux modes de l’expérience architecturale : penser versus ressentir[14]. Les réponses évaluatives et émotionnelles pour l’architecture impliquent des circuits cérébraux distincts. Ainsi, on suppose que ce qu’un usager pense au sujet d’un bâtiment pourrait être différent de son ressenti lorsqu’il l’occupe. Ces deux dimensions pourraient s’influencer mutuellement. L’appréciation esthétique d’un bâtiment peut être modifiée par les attentes et les connaissances qu’une personne possède à son sujet. Par exemple, la connaissance de la fonction générale prévue pour un bâtiment influence notre expérience esthétique. Les jugements de beauté pour l’architecture varient suivant l’activité de certaines régions cérébrales. L’activation du cortex préfrontal suggère que l’analyse consciente et le raisonnement jouent un rôle significatif dans le jugement esthétique, tandis que l’activation parahippocampique montre la probable influence des souvenirs générés par l’éducation ou l’expérience passée.
Les gens habitent les espaces architecturaux et cet engagement corporel avec l’espace diffère de l’engagement avec la plupart des autres formes d’art. Ainsi que le souligne l’architecte finlandais Juhani Pallasmaa, « il y a une invitation à agir inhérente aux images d’architecture, le moment de la rencontre active, ou “une promesse de fonction” et de but. […] C’est cette possibilité d’action qui distingue l’architecture des autres arts[15]. » Les rencontres architecturales se prolongent et se multiplient temporellement de manières très différentes par rapport aux œuvres d’art qui dépendent souvent d’une visite au musée ou d’une performance in situ.
La notion d’affordance n’est pas courante en architecture ; en revanche celle de fonction est en usage depuis longtemps, même si elle a été entendue sous différentes acceptions, en particulier au XXe siècle[16]. Néanmoins, depuis que certains architectes voient dans la science, et en particulier les neurosciences, un moyen de justifier leurs décisions en matière de conception, la notion d’affordance commence à trouver son public, notamment dans quelques écoles d’architecture, voire dans des agences (telles que raaaf, déjà mentionnée) lorsqu’elle est utilisée comme outil de conception[17]. La théorie des affordances permet de décrire l’environnement à un niveau qui peut s’avérer pertinent, également pour la conception des espaces publics. Cette architecture basée sur la théorie des affordances revendique une émancipation des catégories traditionnelles souvent galvaudées de « forme » et de « fonction », ainsi que de leur relation compliquée et souvent doctrinale. Ainsi, une architecture des affordances se fonde sur les usages perçus et exploités de l’environnement créé par l’architecte. Les bâtiments ne sont plus conçus comme des objets mais comme des environnements offrant des possibilités aux usagers. Cette architecture se veut plus humaine car centrée sur la sensibilité et les capacités propres de l’usager et non plus sur une abstraction formelle dérivée d’une fonction idéalisée (ou à tout le moins standardisée)[18].
La question du concept théorique le plus adapté à l’architecture a souvent été débattue, oscillant entre les partisans de la forme et les adeptes de la fonction. Alors que la théorie de Gibson est descriptive, dans la mesure où elle se borne à décrire la manière dont une espèce perçoit son environnement, certains théoriciens ont cherché à en faire une théorie prescriptive, pour le design d’abord[19], pour l’architecture plus tard[20]. Par exemple, une fenêtre permet la transmission de la lumière et par conséquent l’éclairage d’un environnement intérieur ainsi que la vue de l’environnement extérieur. Dans certains cas, elle permet également d’assurer une ventilation naturelle par un échange d’air entre extérieur et intérieur. Dans de plus rares cas, elle permet de s’échapper d’un bâtiment en flammes, voire de se défenestrer.
Dans le cadre de l’architecture, Jonathan Maier et ses collaborateurs[21] soutiennent que la notion d’affordance peut être reprise comme base conceptuelle permettant d’unifier les idées vitruviennes de forme et de fonction (au lieu de les hiérarchiser), et qu’elle peut s’appliquer à des échelles très différentes, de la poignée de porte à l’ensemble urbain. Cela dit, les affordances ne sont pas nécessairement positives. Il peut y avoir un décalage entre l’intention du concepteur et le comportement des usagers. Une différence importante entre la conception basée sur les affordances et d’autres manières de voir le processus de conception réside dans l’identification formelle des choses auxquelles l’objet ne doit pas inviter (et pas uniquement celles auxquelles il invite).
Comme nous l’avons déjà fait observer plus haut, l’expérience esthétique peut résulter d’une manipulation (plus ou moins intentionnelle) de la relation entre forme et fonction. Un type de manipulation repose sur la sollicitation d’expériences d’affordances illusoires. Par exemple, les poignées extérieures des portes d’entrée de la Cooper Library à l’université de Clemson invitaient initialement à tirer et à pousser alors que les portes ne s’ouvraient que vers l’intérieur. L’usager avait tendance à faire l’expérience d’une affordance relative à un schéma moteur spécifique alors que l’affordance se rapportait effectivement à un schéma moteur inversé. L’expérience de l’usager était donc illusoire. Dans le cas précis, le résultat n’a pas été probant. Pour remédier à la consternation des personnes essayant sans succès de tirer sur les portes, le signe « Pousser » a été gravé sur les poignées. Mais la forme des poignées invitant à tirer étant manifestement une affordance bien plus grande que le signe gravé invitant à pousser, il a fallu finalement remplacer les poignées initiales par des poignées dont l’affordance d’usage était directe. Le signe « Pousser » a été maintenu, mais il est devenu redondant car les poignées ne peuvent qu’inviter à pousser (et plus à tirer). En dehors de l’architecture, la Roue de bicyclette de Duchamp (1913) est un autre exemple de manipulation des affordances. La roue de bicyclette et le tabouret en bois sur laquelle elle est fixée évoquent séparément deux affordances familières (pédaler et s’asseoir), mais le sujet prend également conscience qu’aucune des deux n’est réalisable. L’expérience qu’il a de ces affordances est donc illusoire.
D’autres types de manipulation à des fins éventuellement esthétiques exploitent le fait que notre expérience d’affordances est souvent partielle. Convenons qu’une affordance réalise une relation instrumentale : elle met en relation un moyen (un schéma corporel, comme l’action d’ouvrir une porte) et une fin (la porte est ouverte et le passage dégagé). La perception d’une affordance implique donc au moins l’identification d’une relation instrumentale spécifique. Or dans certains cas, cette perception est partielle ou incomplète : nous identifions un moyen sans le relier à une fin, ou nous identifions une fin sans être en mesure de déterminer le moyen. Dans un bâtiment, nous repérons des passages, ou des couloirs, sans savoir où ils mènent ; nous tentons d’actionner des interrupteurs avant d’identifier les éclairages qu’ils commandent, etc. Nous faisons l’expérience d’un moyen possible vers un but qui reste incertain. La situation inverse est possible, lorsque nous identifions un but, tel qu’une destination au sein d’un bâtiment, avant de comprendre comment y parvenir. Par exemple, certains anciens jardins chinois mettent en scène d’apparentes incompatibilités entre accessibilité visuelle et accessibilité physique. Dans le but de dynamiser la promenade, le jardinier-concepteur associe délibérément continuité de la vision et discontinuité de l’accès, offrant des perspectives vers des objets architecturaux (belvédères, kiosques) tout en masquant par des masses végétales les sentiers, détournés et sinueux, pour y parvenir[22]. Considérant de manière générale que l’objet d’une expérience esthétique est tel qu’il « résiste à la familiarisation[23] », le recours à des affordances surprenantes, inattendues, étranges ou (littéralement) déroutantes fait à l’évidence partie de la panoplie habituelle de l’architecte ou du designer.
Les quelques exemples qui viennent d’être donnés suffisent à montrer que le cas de l’architecture n’est pas très différent de celui du design pour ce qui concerne le rôle central de la notion d’affordance. À l’instar d’un objet de design, l’expérience esthétique d’un objet architectural repose typiquement sur l’identification des affordances positives ou négatives qu’il réalise. La thèse forte selon laquelle l’expérience esthétique d’un objet est incompatible avec la conscience qu’il réalise une ou plusieurs affordances doit donc être rejetée. Cette thèse dénature en particulier notre appréciation des objets architecturaux, en tant que celle-ci repose, au moins partiellement, sur une évaluation de l’articulation entre forme et fonction.
III. Au-delà des affordances : sublimités architecturales
Si certaines expériences esthétiques sont compatibles, voire requièrent l’appréhension d’affordances, faut-il pour autant rejeter l’idée d’une forme d’expérience esthétique incompatible avec une perception instrumentale du monde ? Avant de conclure, nous souhaitons avancer quelques éléments en faveur d’une réponse négative à cette question. D’autres expériences esthétiques, notamment dans le domaine de l’architecture, sont telles qu’elles exigent de notre part que nous nous détournions des affordances de notre environnement.
Considérons notre expérience perceptive d’un paysage à la campagne, appréhendé à partir d’un point de vue situé un peu en hauteur, par exemple sur une colline. Elle peut prendre deux formes différentes. Nous pouvons percevoir le paysage à la manière d’un promeneur réel ou virtuel, en identifiant en son sein des affordances pertinentes : des chemins à emprunter, des collines à contourner, des rivières à franchir, des sources d’eau pour se désaltérer. Mais nous pouvons aussi percevoir le paysage comme un tout, indépendamment des affordances qu’il contient. La seconde forme, synoptique, d’expérience du paysage exclut-elle la perception simultanée d’affordances ? Le paysage lui-même est appréhendé comme un tout et non pas comme un moyen de parvenir à quelque fin. Mais qu’en est-il de ses parties, des différents éléments qui le composent ? À tout le moins, ils n’ont pas à être appréhendés comme des affordances, mais seulement comme des éléments d’un tout. Mais il y a un sens dans lequel l’expérience synoptique doit s’affranchir des affordances de la perception ordinaire pour tenter de saisir la réalité en tant que telle, ou plutôt telle qu’elle nous apparaît. Dans l’expérience synoptique, les parties ne sont pas mises en relation les unes avec les autres selon leur valeur pragmatique. Elles sont perçues seulement comme éléments du tout.
L’expérience synoptique du paysage ne prend peut-être pas toujours la forme d’une expérience esthétique, mais elle peut en constituer un élément essentiel. Nous pouvons apprécier esthétiquement le paysage comme un tout, plutôt que chacune de ses parties prises séparément. Dans ce cas, l’objet de notre expérience ne doit pas être conçu comme réalisant une affordance. Certaines expériences esthétiques impliquent donc que nous mettions entre parenthèses, au moins temporairement, les affordances de notre environnement.
L’expérience synoptique du paysage peut être calme et paisible, mais d’autres expériences esthétiques globalisantes sont plus éprouvantes. La tradition philosophique, notamment chez Edmund Burke et plus tard Emmanuel Kant, a établi une distinction entre deux formes d’expérience esthétique, qu’elle a rapporté respectivement au beau et au sublime[24]. Si l’expérience de la beauté engage principalement des émotions positives, l’expérience du sublime est celle d’une grandeur ou puissance considérable, qui submerge et envahit le sujet, et à ce titre le bouleverse, parce qu’elle touche aux limites de ce qu’il est capable d’appréhender.
Si l’expérience du sublime a été rapportée principalement à des scènes naturelles (les Alpes, l’immensité de l’océan, les phénomènes météorologiques intenses, etc.), l’architecture, en particulier in situ, est souvent mentionnée comme pouvant également susciter une telle expérience. Des réalisations grandioses telles que les Pyramides d’Égypte, la Grande Muraille de Chine, Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres (deux exemples cités par Schopenhauer) ou encore le bâtiment de la cctv à Pékin (réalisé par Rem Koolhaas) sont parfois citées comme des exemples de sublimité. Comme l’expérience synoptique, l’expérience du sublime est celle d’un tout. Dans l’une des rares discussions récentes en français du sublime en architecture, Jacques Lucan écrit : « Le sublime est produit par un bâtiment qui se donne comme un tout immédiatement appréhendable[25] ». Comme dans l’exemple du paysage donné plus haut, ce tout peut être complexe, mais alors ses éléments ne sont appréhendés qu’en tant qu’ils participent de la totalité. Sur ce point, nous serions plus nuancés que l’auteur quand il écrit que « le sublime ne peut pas être produit par un bâtiment fait de (petites) parties qui se composent ou s’assemblent[26] ». Une chaîne de montagnes peut susciter une expérience de sublimité tout en étant appréhendée comme une entité complexe ; chaque cime individuellement ne provoquera pas une telle expérience, mais participe dans notre conscience à l’expérience d’une totalité sublime.
L’expérience du sublime se différencie de l’expérience synoptique d’un paysage par son caractère d’expérience-limite. C’est une expérience immersive, dans laquelle le sujet, confronté à une entité dont il ne parvient à mesurer l’échelle grandiose, éprouve le sentiment d’être absorbé dans un tout plutôt que d’être en lien avec un objet séparé. Dans l’expérience synoptique, le paysage peut être appréhendé comme une partie d’un tout encore plus vaste, à l’horizon de la perception. En revanche, l’expérience du sublime est celle d’un tout qui ne saurait faire partie d’une totalité plus englobante. Lorsqu’une entité capable de susciter une expérience de sublimité dans certains contextes est appréhendée comme étant englobée par une autre entité, le sentiment de sublime cessera de s’y attacher. L’installation Promenade de Richard Serra a toutes les qualités de grandiosité pour susciter à elle seule, dans un contexte favorable, une telle expérience, mais lorsqu’elle est insérée dans un espace architectural plus large, comme dans la nef du Grand Palais à Paris (Monumenta 2008), elle est plus difficilement appréhendable comme sublime.
Plus encore que l’expérience synoptique, l’expérience du sublime apparaît donc comme incompatible avec le découpage de la scène perçue en affordances discrètes, indépendamment de leur relation aux autres parties du tout. Que nous apprennent les sciences cognitives à ce sujet ? Si les études expérimentales se sont penchées surtout sur l’expérience de la beauté, il existe au moins une étude neuroscientifique sur l’expérience du sublime, dont la base a consisté dans la présentation d’images de scènes naturelles réputées sublimes (comme le Grand Canyon) à des sujets sous imagerie cérébrale[27]. Pour ce qui nous concerne, l’un des résultats les plus intéressants de cette étude est que les régions cérébrales liées à la référence et à la représentation de soi sont sous-activées lors d’expériences de sublimité. Ces mêmes régions semblent être au contraire particulièrement sollicitées lors d’expériences intenses de beauté[28]. Cette différence peut s’expliquer par le caractère immersif de l’expérience du sublime, qui abolit la frontière phénoménale entre le sujet et le reste du monde. La représentation de soi est diminuée voire supprimée au profit d’une expérience englobante du monde, dans laquelle le dualisme sujet-objet a disparu.
Il existe encore peu d’études expérimentales sur l’expérience du sublime en rapport avec l’architecture. Les quelques études existantes tendent à confirmer l’hypothèse d’une incompatibilité entre cette expérience et celle d’affordances discrètes. Par exemple, Yannick Joye et Siegfried Dewitte[29] ont montré que l’exposition à des images de grands bâtiments (lesquels sont associés à une intensification du sentiment que les anglophones appellent « awe », à savoir un mélange entre sidération et admiration) induisait une certaine immobilité et une réponse plus lente à certaines tâches manuelles (de type « cliquage ») que l’exposition à des images de bâtiments bas. Ces résultats suggèrent que nos évaluations esthétiques de stimuli architecturaux peuvent inhiber (dans le cas de la sublimité) ou, au contraire, soutenir (dans le cas de la beauté) une activité motrice et influencer ainsi certaines qualités de l’expérience du spectateur au détriment d’autres.
Conclusion
La notion d’affordance peut servir de cadre conceptuel pour comprendre la relation entre l’environnement bâti et ses occupants, particulièrement au regard des notions nettement plus courantes en théorie architecturale, mais dont l’usage varié a rendu l’extension parfois difficile à déterminer avec précision, que sont la forme et la fonction. Des travaux récents dans le domaine des neurosciences et de la psychologie écologique accréditent la thèse selon laquelle les affordances peuvent être appréhendées dans l’expérience consciente comme des relations instrumentales spécifiques. Nous avons suggéré qu’une caractérisation théoriquement et empiriquement adéquate de notre relation esthétique à l’architecture fait essentiellement intervenir l’objet architectural comme source d’affordances accessibles à la perception (véridique ou illusoire, partielle ou complète).
Comme nous l’avons vu, l’expérience esthétique ne devient pas elle-même instrumentale dès lors qu’elle repose sur l’identification d’affordances. La conception traditionnelle de cette expérience comme étant essentiellement « désintéressée » peut donc être maintenue. Toutefois, nous avons proposé que d’autres modalités de l’expérience esthétique pouvaient exclure l’identification simultanée d’affordances. Parmi ces modalités figure l’expérience du sublime. Notre hypothèse de travail est que si l’expérience de la beauté architecturale (dont il a été principalement question dans les sections I et II ci-dessus) implique un lien direct avec le soi par l’intermédiaire de l’appréciation et de l’évaluation des affordances (relation entre forme et fonction), l’expérience de la sublimité architecturale (abordée dans la section III) se rapproche davantage d’un choc corporel et physique dans lequel l’appréciation en termes d’affordances n’est pas encore thématisée. De notre point de vue, ce « dualisme esthétique » permet de fournir un tableau plus complet, et mieux établi sur le plan empirique, de la phénoménologie de l’expérience architecturale.
À la fin du siècle dernier, le neuroscientifique Semir Zeki déclarait qu’« aucune théorie de l’esthétique ne sera complète, encore moins profonde, à moins d’être basée sur une compréhension du fonctionnement du cerveau[30] ». Il avait sans doute raison, même si la notion d’une théorie « complète » n’est ni limpide ni utile d’un point de vue épistémologique. Force est de constater, cependant, que les neurosciences ne sauraient constituer une approche autonome, même partielle, des phénomènes esthétiques. Les neurosciences permettent dans certains cas de conforter des hypothèses déjà établies, et dans le meilleur des cas de nous orienter vers des pistes théoriques négligées. Ce n’est guère surprenant, après tout, tant la théorie esthétique mobilise des niveaux variés de description, de compréhension et d’explication. C’est donc dans une perspective essentiellement interdisciplinaire, au sein de laquelle la philosophie garde toute sa place, qu’il faut envisager l’étude des phénomènes esthétiques, en architecture comme dans d’autres domaines.
*Nous avons bénéficié, pour la rédaction finale de cet article, des remarques précieuses de deux lecteurs, que nous remercions ici.
[1]James J. Gibson, “The theory of affordances and the design of the environment”, Symposium on Perception in Architecture, American Society for Esthetics, Toronto, octobre 1976. Republié dans Edward S. Reed & Rebecca Jones (dir.), Reasons for realism : selected essays of James J. Gibson, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, 1982, p. 413.
[2]Voir en français son ouvrage Approche écologique de la perception visuelle, Bellevaux, Éditions Dehors, 2014 (paru en anglais en 1979). Nous reprenons ici le néologisme anglais « affordance », que le traducteur Olivier Putois rend par « invite ».
[3]Voir par exemple certaines des contributions critiques réunies dans Gregory Currie, Matthew Kieran, Aaron Meskin & Jon Robson (dir.), Aesthetics and the Sciences of the Mind, Oxford, Oxford University Press, 2014.
[4]Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, Gallimard, 1985, § 12n, p. 154.
[5]Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation,Paris, PUF, 1989, p. 242.
[6]Comme nous le fait observer l’un de nos lecteurs, la notion kantienne de désintéressement est sans doute plus générale, et ne se résume pas à la seule indépendance par rapport à l’affordance. Elle se comprend comme un « libre jeu des facultés » qui s’affranchit non pas seulement de questions d’utilité, mais aussi de morale, de connaissance et de survie.
[7]James J. Gibson, “The theory of affordances”, in Robert E. Shaw & John Bransford (dir.), Perceiving, acting, and knowing : Toward an ecological psychology (p. 67–82), Hillsdale (NJ), Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1977, p. 67.
[8]James J. Gibson, Approche écologique de la perception visuelle, op. cit., p. 211 (« affordances » remplace « invites »).
[9]Les neurones canoniques se distinguent d’une autre famille de neurones visuo-moteurs également logés dans le cortex pré-moteur, à savoir les « neurones miroirs ». Pour une synthèse des travaux de l’École de Parme, qui a attiré l’attention de la communauté scientifique sur ces deux types de neurones, voir Giacomo Rizzolatti & Corrado Sinigaglia, Les Neurones miroirs, Paris, Odile Jacob, 2008.
[10]Susan Hurley, “Active perception and perceiving action. The shared circuits model”, in Tamar S. Gendler & John Hawthorne (dir.), Perceptual Experience, Oxford, Clarendon Press, 2006, p. 235.
[11]En effet, si nous considérons l’expérience esthétique comme un mode d’attention spécifique à un objet, dont la finalité n’est autre que son propre maintien, alors en principe n’importe quel objet peut être la cible d’une expérience esthétique (cf. Jean-Marie Schaeffer, L’Expérience esthétique, Paris, Gallimard, 2015). Dans le cas du Porte-bouteille, l’expérience esthétique sera typiquement (mais pas nécessairement) induite par la prise de conscience du contexte artistique qui « transfigure » l’objet ordinaire.
[12]Voir par exemple les travaux du psychologue Stephen Kaplan dans les années 1980, ou ceux récents du psychogéographe Colin Ellard.
[13]Alex Coburn, Oshin Vartanian et Anjan Chatterjee, “Building, Beauty, and the Brain : A Neuroscience of Architectural Experience”, Journal of Cognitive Neuroscience, 26 : 3, 2017.
[14]Voir à ce sujet le débat à l’université d’Harvard en 1982 entre deux éminents théoriciens de l’architecture, Christopher Alexander et Peter Eisenman, retranscrit dans Katarxis no 3, [http://www.katarxis3.com/Alexander_Eisenman_Debate.htm], consulté le 2 décembre 2014.
[15]Juhani Pallasmaa, Le Regard des sens, Paris, Éditions du Linteau, 2005, p. 69. La notion de « promesse de fonction » fut proposée par le sculpteur américain Horatio Greenough au milieu du xixe siècle.
[16]Pour un résumé éclairant, voir l’entrée “Function”, inAdrian Forty, Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, Londres, Thames & Hudson, 2000, p. 174-195. Si une affordance peut éventuellement être analysée en termes de fonction, notamment instrumentale (par exemple, la fonction d’une poignée de porte est d’ouvrir ou de fermer une porte), la notion de fonction est plus générale : par exemple, la forme du toit d’un chalet peut avoir la fonction de répartir le poids de la neige, mais cette fonction ne correspond à aucune relation instrumentale, et n’est donc pas une affordance.
[17]Voir par exemple le récent symposium organisé en mars 2019 par l’anfa (Academy of Neuroscience for Architecture) à la Kansas State University, intitulé “Affordances and the Potential for Architecture”.
[18]L’article de Djebbara et al. “Sensory-motor brain dynamics reflect architectural affordances”, 2019, [https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/131047/1/Djebbara-etal-2019_bioRxiv_Neuroarchitecture.pdf], consulté le 2 décembre 2019, mentionne dans son « Significance Statement » la pertinence de prendre en compte les affordances dans la conception architecturale.
[19]Donald A. Norman, The Design of Everyday Things, New York, Currency Doubleday, 1988.
[20]Par exemple Chris Tweed, “Highlighting the affordances of designs : mutual realities and vicarious environments”, inBauke de Vries, Jos van Leeuwen et Henri Achten (dir.), Computer Aided Architectural Design Futures 2001, Dordrect, Kluwer, 2001, p. 681-696 et Alexander Koutamanis, “Buildings and affordances”, in John S. Gero (dir.), Design Computing and Cognition 06, New York, Springer, 2006, p. 345-364.
[21]Jonathan R. A. Maier, Georges M. Fadel et Dina G. Battisto, “An affordance-based approach to architectural theory, design, and practice”, Design Studies, 30 : 4, 2009, p. 393-414.
[22]Voir par exemple Ji Cheng, Yuanye : le traité du jardin (1634), Paris, Éditions de l’Imprimeur, 1997, analysé dans le mémoire de Master (non publié) de Franck Li, Processus de conception des Jardins de Suzhou. Le cas du jardin du simple politicien, ensaplv, 2017.
[23]Voir Jérôme Dokic, “Aesthetic Experience as a Metacognitive Feeling? A Dual-Aspect View”, Proceedings of the Aristotelian Society, 116 : 1, 2016, p. 69-88.
[24]Pour une histoire et une analyse du concept de sublime, voir Baldine Saint-Girons, Le Sublime : De l’Antiquité à nos jours, Paris, Desjonquères, 2005.
[25]Jacques Lucan, Précisions sur un état présent de l’architecture, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015, p. 198. Comme l’un de nos lecteurs nous le fait observer, cette affirmation évoque le propos de Kant (au § 26 de la Critique de la Faculté de juger), au sujet de la distance qu’il est nécessaire de prendre face aux Pyramides d’Égypte pour que l’imagination puisse les appréhender comme un tout.
[26]Ibidem.
[27]Tomohiro Ishizu et Semir Zeki, “A neurobiological enquiry into the origins of our experience of the sublime and beautiful”, Frontiers in human neuroscience, 8 : 891, 2014.
[28]Edward A. Vessel, G. Gabrielle Starr et Nava Rubin, “The brain on art : intense aesthetic experience activates the default mode network”, Frontiers in Human Neuroscience, 6 : 66, 2012.
[29]Yannick Joye et Siegfried Dewitte, “Up speed you down. Awe-evoking monumental buildings trigger behavioral and perceived freezing”, Journal of Environmental Psychology, 47, 2016, p. 112-125.
[30]Semir Zeki, “Art and the Brain”, Journal of Consciousness Studies, 6 : 6-7, 1999.